Les routes de l’esclavage : histoire d’un très grand « dérangement »
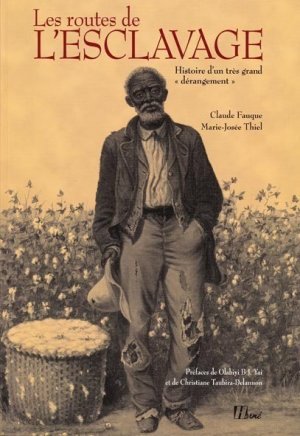
Les routes de l’esclavage : histoire d’un très grand "dérangement", de Claude Fauque et Marie-Josée Thiel, est un livre très accessible au grand public qui offre un panorama de l’histoire de l’esclavage et de la traite transatlantique. Le livre est préfacé par Olabiyi B. J. Yäi, ambassadeur délégué permanent de la République du Bénin à l’UNESCO et Christiane Taubira-Delannon, députée de la Guyane française et auteure de la loi française numéro 1297, qui a défini la traite transatlantique comme crime contre l’humanité. Publié en 2004, année internationale de commémoration de la lutte contre l’esclavage et de son abolition, l’ouvrage couvre presque un demi-siècle d’histoire tout en étant écrit dans un langage de compréhension aisée. Le livre comprend des extraits de quelques documents importants de l’époque, des reproductions de peintures, de dessins et de gravures sur l’esclavage ainsi que des photographies de sites liés à la traite. Ce matériel iconographique est sans l’ombre d’un doute l’aspect le plus remarquable de l’ouvrage, en attestant à quel point la traite transatlantique et l’esclavage étaient ancrés dans la vie sociale des Européens et des Américains depuis le XVIe siècle.
En ce qui concerne les auteures du livre, il est important de rappeler que Claude Fauque, au départ journaliste, a publié de nombreux ouvrages et s’intéresse surtout au tourisme. D’ailleurs, elle est experte auprès de l’Institut européen des itinéraires culturels, et consultante en muséologie pour des expositions et la création de musées patrimoniaux. Marie-Josée Thiel, quant à elle, œuvre à l’Unesco depuis 1981, où elle est actuellement chargée des projets du programme « La route de l’esclave » dans l’Océan indien et en Europe.
L’ouvrage est divisé en deux grandes parties, intitulées respectivement Les routes de la traite et Les chemins du quotidien : la première vise à expliquer les dynamiques du commerce transatlantique, tandis que la seconde développe les différents aspects de la vie quotidienne des esclaves, principalement dans les Amériques. Le commerce triangulaire constitue ainsi la première version de l’économie mondialisée que nous connaissons aujourd’hui ; pratiquement toutes les puissances européennes, dont la Grande-Bretagne, le Portugal, la France, la Hollande, le Danemark et même la Suisse, y participèrent à l’époque. Si les Lumières nous ont légué la Déclaration universelle des droits de l’homme et du citoyen, celle-ci ne concerna que les hommes blancs, en laissant intacte la traite qui ne sera abolie en France qu’à l’époque de la Convention. En outre, on explique que le Code noir établissait que l’esclave africain était un bien meuble. Non seulement les navires étaient assurés, mais aussi la « marchandise » qu’ils transportaient, les voyages étant financés par les différentes compagnies de navigation européennes. On énumère les divers arguments utilisés à l’époque pour justifier la traite, dont la nécessité d’évangéliser les peuples païens. Bien que l’on montre que l’esclavage n’est pas du tout dissocié de l’idée de la supériorité d’une race sur une autre, on insiste sur le fait que la seule vraie justification était de nature économique. Le livre reproduit des extraits d’ouvrages anciens dont Fragments d’un voyage en Afrique fait durant les années 1785, 1786 et 1787 de Meinrad Xavier Golberry, qui se manifesta clairement contre l’abolition de l’esclavage. En outre, on situe les principaux comptoirs africains de la période de la traite, en n’oubliant pas de montrer certains sites, comme la maison des esclaves à Gorée au Sénégal et le fort portugais d’Elmina au Ghana, qui constituent aujourd’hui d’importants lieux de mémoire de l’esclavage. Une attention particulière est donnée à la traite à partir de la Côte des esclaves, région qui comprend la côte de l’actuelle République du Bénin jusqu’au Ghana. Même s’il s’agit d’un livre destiné au grand public, écrit par des auteurs qui ne sont pas des spécialistes des études sur l’esclavage, on note un souci d’expliquer comment le commerce se faisait dans les régions plus excentrées, comme l’Afrique orientale. On explique qu’au début, avant de négocier avec les royaumes locaux, les Portugais allaient eux-mêmes chercher des hommes, dont parfois des colons installés sur les terres pour ensuite les vendre comme esclaves.
La deuxième partie de l’ouvrage évoque la vie quotidienne en situation d’esclavage, en montrant les conditions de travail dans les plantations américaines, le quotidien des esclaves domestiques ainsi que les méthodes de châtiment corporel appliquées. Mais les esclaves ne sont pas passifs, après leur arrivée dans les Amériques et dans les îles de l’Océan indien, ils ont organisé des rébellions, des révoltes, des fuites et ont fait du marronnage, en constituant ainsi des villages indépendants et autogérés. Le lecteur peut comprendre alors comment l’esclavage et le commerce triangulaire préparent le terrain pour la colonisation qui débutera à la fin du XIXe siècle, après la débâcle des armées des différents royaumes africains. Cependant, malgré la préface de Olabiyi B. J. Yäi, dans certains passages du livre, le rôle des royaumes africains en tant que fournisseurs de captifs pour la traite est minimisé. On explique que même s’il y avait de l’esclavage en Afrique, il s’agissait d’esclaves domestiques qui pouvaient côtoyer des hommes libres et obtenir leur affranchissement. Or, la situation était un peu plus complexe que cela. D’une part, dans certains royaumes comme celui d’Abomey (dans l’actuel Bénin) nombre d’esclaves étaient destinés aux sacrifices humains. D’autre part, la situation n’était pas si différente dans des pays comme le Brésil, où les esclaves menaient une vie très proche de celle de leurs maîtres et des hommes libres, principalement dans les villes. En outre, il était assez commun pour les esclaves brésiliens d’acheter leur affranchissement après plusieurs années de travail. Le texte présente souvent les négriers africains comme des victimes innocentes et inconscientes de leurs attitudes, incapables de distinguer le bien du mal. Il aurait été bon alors de mettre un peu plus en valeur les débats récents concernant les demandes de réparation des certaines nations africaines à l’égard des pays européens ayant participé à la traite, ainsi que les revendications des Afro-descendants américains, question d’ailleurs traitée courageusement par l’historien béninois Félix Iroko dans un tout petit ouvrage, intitulé La Côte des Esclaves et la traite atlantique. Les faits et le jugement de l’histoire, publié en 2003 à Cotonou, avec un budget très modeste. Certes, les auteures mentionnent un événement ayant eu lieu récemment au Sénégal, où des évêques africains se sont réunis avec l’objectif de demander « le pardon de l’Afrique à l’Afrique » (73), mais on oublie pourtant d’insister sur le soutien apporté par l’Église catholique à ce commerce infâme. Malgré la valeur indéniable du livre, Claude Fauque et Marie-Josée Thiel auraient pu se dégager un peu de cette approche officielle - ce qui d’ailleurs conduit le lecteur à penser que le livre a été commandé par l’Unesco - pour s’aventurer dans une analyse plus critique et audacieuse. Dans cette perspective, il aurait été important de faire appel davantage aux travaux des historiens africains ou même de leur confier certains chapitres. La bibliographie compte un nombre réduit de références pour un ouvrage qui se propose à traiter un sujet de si grande envergure. D’ailleurs, l’absence de références techniques complètes des images reproduites, d’un glossaire et d’un index des noms propres, rend difficile l’utilisation du livre comme ouvrage de référence dans un contexte académique.
Fauque, Claude et Marie-Josée Thiel. Les routes de l’esclavage. Histoire d’un très grand "dérangement". Paris, Hermé, 2004. 206 p.
14 réactions à cet article
Ajouter une réaction
Pour réagir, identifiez-vous avec votre login / mot de passe, en haut à droite de cette page
Si vous n'avez pas de login / mot de passe, vous devez vous inscrire ici.
FAIRE UN DON







 . Pour les deux autres traites, les chiffres sont difficiles.
La descendances dans la traite arabo-musulmane est assez limitée car les esclaves n’avaient pas droit d’avoir de femme, quant ils n’étaient pas « castré ».
Les conditions dans les plantations variaient suivant les pays, et suivant les maitres. J’ai récupéré des chiffres qui montrent ce phénomène, et qui explique que la mortalité était plus importante la 1er année d’arrivée. Sur le transport, la mortalité était similaire à celle de l’équipage (chiffre concernant la traite « réguliaire »)et variait entre 7 et 12%, suivant la longueur du voyage et des conditions météo.....
L’esclavage noire fut surtout pragmatique. C’était le personnel qui résistait bien aux conditions climatiques des plantations.
Ne pas oublier dans ses plantations que certaines catégories de « blancs » n’étaient pas plus enviable que les esclaves noirs, les engagés. Ils devaient un nombre d’année pour le paiement de leur voyage à leur patrons. Beaucoup ne résistait pas et mourrait avant d’avoir fait les 3 Ou 5 ans qu’ils devaient.
Je ne suis pas sure que les serfs avaient de meilleures conditions, mais ils n’étaient transplantés dans un autre lieu sans connaitre qui que ce soit.
. Pour les deux autres traites, les chiffres sont difficiles.
La descendances dans la traite arabo-musulmane est assez limitée car les esclaves n’avaient pas droit d’avoir de femme, quant ils n’étaient pas « castré ».
Les conditions dans les plantations variaient suivant les pays, et suivant les maitres. J’ai récupéré des chiffres qui montrent ce phénomène, et qui explique que la mortalité était plus importante la 1er année d’arrivée. Sur le transport, la mortalité était similaire à celle de l’équipage (chiffre concernant la traite « réguliaire »)et variait entre 7 et 12%, suivant la longueur du voyage et des conditions météo.....
L’esclavage noire fut surtout pragmatique. C’était le personnel qui résistait bien aux conditions climatiques des plantations.
Ne pas oublier dans ses plantations que certaines catégories de « blancs » n’étaient pas plus enviable que les esclaves noirs, les engagés. Ils devaient un nombre d’année pour le paiement de leur voyage à leur patrons. Beaucoup ne résistait pas et mourrait avant d’avoir fait les 3 Ou 5 ans qu’ils devaient.
Je ne suis pas sure que les serfs avaient de meilleures conditions, mais ils n’étaient transplantés dans un autre lieu sans connaitre qui que ce soit.
