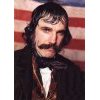Modiano à la télévision
Des gens qui passent – et si l’essentiel ne passait pas ?
Le monde se divise en deux : il y a les fans de Patrick Modiano, et les autres, ceux pour qui ses romans, dès les premières pages, suintent un ennui profond. Me situant résolument dans la première catégorie, j’ai cru comprendre que ceux de la deuxième reprochaient à l’auteur non pas tant son écriture, ni même les thèmes récurrents, mais l’imprécision de l’histoire, comme s’il manquait les indices permettant de savoir qui fait quoi, et comment cela se termine.
De toute évidence dans l’adaptation télévisée d’Un cirque passe (Gallimard, 1992), réintitulée Des gens qui passent (Alain Nahum, 2009) et diffusée vendredi 20 novembre sur France 2, on a essayé de réconcilier les deux groupes.
Pour résumer cette histoire tragique : On est en 1961 - un très jeune homme et une jeune fille au passé trouble, tous deux surveillés par la police et environnés de personnages louches, tentent de quitter Paris pour (re)faire leur vie à Rome. Le jour du départ, la mort de la jeune femme met fin au rêve.
On ne peut que saluer les qualités de ce film. Tout d’abord, le choix des interprètes. Laura Smet est la parfaite héroïne modianesque, suffisamment passe-muraille dans son imperméable ajusté pour habiter le discret Paris des beaux quartiers des années ’60 (sauf qu’il n’y avait pas de fard à paupières à l’époque...), assez piquante pour jouer les femmes fatales, vulnérable et décisive en même temps, dissimulant jalousement un passé que l’on suppose vénal, tournant quelques phrases bien ciselées et naturelles en même temps avec juste l’émotion qu’il faut. Plus spectaculaire encore, la prestation du jeune Théo Frilet. Les héros de Modiano conjuguent timidité, maladresse et un entêtement qui peut les entraîner aux marges du danger et parfois, en un ultime sursaut, les en sortir. Un courage qui n’est bien souvent que l’inconscience de l’adolescence, d’autant plus émouvant que ce type de garçon récurrent est abandonné de ses parents, et singulièrement de son père, dans un monde d’escrocs et de petits truands qui lui témoignent une certaine bienveillance.
Quant aux lieux, d’une importance capitale dans ces récits qui imposent aux protagonistes des errances dans les quartiers cossus mais fanés du Paris 1960, c’est une réussite. Pour tout fan de Modiano, aimant à se rendre sur les lieux consacrés par tant de petits événements à travers son oeuvre, reconnaître l’immeuble du quai de Conti, balayé par les feux des bâteaux-mouches, où vécut (et est né) le jeune Modiano, ou bien le Cirque d’Hiver à côté duquel se trouve le café de l’ami de Pierre Ansart dans Un cirque passe, est jubilatoire.
C’est bien pour cela que la déception est à la mesure de toutes ces qualités. Des gens qui passent se présente comme un polar. L’associé du père du héros, Grabley (excellent Hippolyte Girardot), se suicide ; les « amis » truands de l’héroïne, Pierre Ansart et Jacques de Bavière, se servent du jeune héros pour enlever brutalement le client d’un restaurant. La police qui rôde, elle non plus, n’inspire pas confiance. On est à l’époque des barbouzes, de l’OAS : politique, affaires, prostitution, les dangers qui guettent le couple sont nombreux. Et quand Marie périt dans l’explosion de sa voiture, le spectateur, pour peiné qu’il soit, n’est pas vraiment surpris, même s’il n’apprendra jamais qui, des anciens ’protecteurs’ de Marie, de son mari, des ennemis du père du héros, ou même de la police, en est responsable. Le harcèlement par coups de fil incessants, les coups sur les portes, les ombres menaçantes, tout nous prépare à l’issue tragique.
C’est trop vague, cependant, pour un polar ; en revanche, c’est trop explicite, trop convenu, pour une fidèle adaptation d’Un cirque passe. Et c’est dommage, car sous les détails modifiés à dessein par le scénariste se cache le sens profond du roman.
Alors que progresse le récit, au gré des mystérieux déplacements de l’héroïne (Gisèle dans le roman, Marie dans le film) on s’interroge, en effet, sur les truands qu’elle fréquente, n’osant espérer qu’ils la laisseront partir en Italie en compagnie de son « frère » (son jeune amant Lucien/Jean). Quant à celui-ci, on sait que la police s’intéresse à lui, qu’il est mineur, que son père et Grabley sont mêlés à de sombres trafics. Et qu’il s’offre le luxe d’envoyer promener le flic qui l’informe du passé sulfureux et de la véritable identité de Gisèle/Marie.
A la grande surpise, au soulagement incrédule du lecteur d’Un cirque passe, on comprend, fugitivement, que les deux amoureux n’intéressent pas suffisamment petits truands et flics pour que ceux-çi se donnent la peine de les arrêter. C’est le hasard, bête et méchant, un accident de la route, qui brise leur rêve (dans le film, Marie emporte la carte de l’hôtel où elle a trouvé refuge avec Jean, sans que cela ne serve à rien ; dans le livre, c’est cette carte qui permet de prévenir le jeune homme de la mort de son amie, à l’issue de longues heures d’attente). Certes, rien dans le livre – dont la perspective est exclusivement celle du narrateur – n’exclut que la voiture ait été piégée. Rompant avec cette subjectivité, le film nous donne à voir une séquence de rue avec deux passants qui jettent quelque chose dans le coffre. Mais nous savions déjà, dans le livre, que Gisèle était une conductrice imprudente.
A mon sens, cette absurdité, le banal accident de la route, comme ceux qui ont coûté la vie, à la même époque, à Camus et son éditeur, à Roger Nimier et sa blonde Sunsiaré de Larcône, bête et tragique comme la (vraie) vie, est bien plus efficace que l’intervention de méchants non-identifiés, que tous les spectateurs (et lecteurs) redoutent depuis le début.
On peut s’interroger aussi sur le parti-pris de forcer le trait dans le sens d’une plus grande brutalité. Jacques de Bavière se comporte en proxénète jaloux vis-à-vis de Marie (dans le livre, il est lisse, (trop) sympathique) ; Marie a un mari brutal (dans le livre il est absent, parti en tournée avec le cirque) ; l’enlèvement à Neuilly est violent (et illogique, car il se déroule devant un restaurant ; dans le livre, la victime entre de son plein gré dans la voiture ) ; la DS pilotée par Marie explose dans la rue, à quelques mètres de l’hôtel (dans le livre, l’accident a lieu près du pont de Puteaux). Mais les spécificités de l’écriture cinématographique, surtout en matière de polar, imposaient sans doute des contrastes plus tranchés.
Discutable aussi, la modification apportée à la visite que le jeune homme effectue, peu avant l’issue tragique, dans le café de la rue Amelot. Il doit demander des nouvelles de Pierre Ansart au patron et celui-ci, élégant, d’une « voix juvénile qui me rappelait celle de l’acteur Jean Marais », l’éconduit poliment en lui opposant un sourire lisse et la phrase « Ils sont partis mais ils vont certainement revenir ». Dix ans plus tard, le narrateur retourne dans ce café ; le patron vieilli et négligé (tel qu’on le voit dans le film) est prêt à tout raconter sur Ansart, sur la « jeune fille »que le narrateur reconnaît sur une photo accrochée au mur en compagnie de tout le personnel du Cirque. Les années ont passé, les « affaires » d’antan aussi. Mais quand le patron lui demande, innocemment, s’il voit encore la jeune fille, le narrateur s’enfuit du café en sanglotant « bêtement ». Sur le coup, en apprenant la nouvelle de sa mort, il avait surtout ressenti, dans la rue, que « tout était léger, clair, indifférent, comme le ciel de janvier quand il est bleu ». Il me semble que la scène du café, avec ce chagrin différé, dix ans après, telle qu’elle figure dans le livre, eût été plus efficace que la dernière séquence du film.
La mort de Gisèle, dans Un cirque passe, est comme la chute d’Icare dans le célèbre tableau de Brueghel, la tragédie des uns est une affaire sans importance pour le ciel, la terre, les autres.
Malgré les libertés que le scénariste, Jacques Santamaria, a prises avec le texte, Modiano aurait apprécié cette adaptation. Il est un fait que l’étoffement du personnage de Grabley, le choix de la vieille caméra Super 8 pour rendre compte des obsessionnels souvenirs d’enfance du héros et témoigner du père absent sont des innovations efficaces. C’est un beau téléfilm, et l’atmosphère si particulière de l’univers de Modiano est rendue comme jamais auparavant.
Mais on a perdu au passage le vrai message de cette histoire bouleversante – l’absurdité tragique de tant d’existences au lieu que le téléfilm se contente d’illustrer un fait-divers criminel. Mais à contenter les fans de Modiano ne risquait-on pas de désespérer les autres ?
9 réactions à cet article
Ajouter une réaction
Pour réagir, identifiez-vous avec votre login / mot de passe, en haut à droite de cette page
Si vous n'avez pas de login / mot de passe, vous devez vous inscrire ici.
FAIRE UN DON