Pour une nouvelle ancienne vague
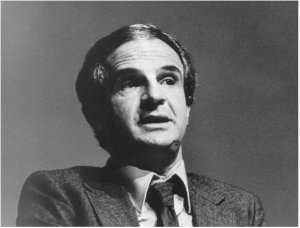
Parler de la place du cinéma en France revient souvent à aligner des chiffres et des pourcentages.
Suivant l’humeur du moment et l’envie d’étayer telle ou telle thèse on évoque le nombre de films produits, la part de marché obtenue, le nombre d’entrées en salle ou le taux d’amortissement des films.
Cette « chiffrophilie » qui confine souvent à la « chiffropathie » est sans doute un reflet des temps modernes ; si Socrate vivait de nos jours, on lui demanderait certainement d’exprimer en centimètres sa fameuse « mesure de soi même ».
Il ne viendrait à l’idée de personne, tout au moins je l’espère, d’estimer la taille des toiles, le poids des statues ou le nombre de notes pour évaluer la place de la peinture, de la sculpture ou de la musique dans notre pays.
Mais si cette fascination pour les chiffres découle pour une grande part de l’imbécillité économistique ambiante il n’en reste pas moins qu’elle témoigne aussi d’un fait réel. Permettez moi de défoncer d’un coup d’épaule une porte grande ouverte : le cinéma n’est pas qu’un art, c’est aussi une industrie.
En effet, pour fabriquer ces rubans de celluloïd qui correctement placés dans un projecteur se révèlent en images animées sur un écran, il faut de l’argent, beaucoup d’argent et parfois beaucoup, beaucoup d’argent. Et cet argent n’est pas du mécénat mais relève comme dans de nombreux secteurs industriels de l’investissement dont on attend de confortables bénéfices. Les millions d’euros nécessaires à la production d’un film de cinéma seraient sans doute tout aussi bien employés à un projet d’usine ou de développement d’un nouveau produit, mais l’industrie artistique est toujours à même d’attirer de nombreux investisseurs.
Or, à moins de considérer que le désodorisant WC est l’expression ébouriffante d’une volonté artistique il va de soi que « industrie artistique » est un oxymore. Ces deux mots se battent l’un contre l’autre jusqu’à épuisement du sens.
Le cinéma est il une industrie ?
La question de l’argent mise à part et malgré tout ce que voudraient nous faire croire les studios d’Hollywood ainsi que certains professionnels du secteur, malgré la cohorte d’emplois dérivés nécessaires qui font du cinéma un secteur économique à part entière, la réponse est clairement négative.
Supposons qu’en vacances un petit malin tombe par hasard sur une Tourte de La Mûre particulièrement goûteuse (j’écris d’un village d’à côté). La première des choses que fera le malin en question sera de se procurer la recette utilisée par l’artisan pour confectionner ce chef d’œuvre et la protègera, par brevet ou cachette, afin d’éviter une future concurrence. Puis il imaginera une possible production industrielle, remplaçant au passage les ingrédients naturels onéreux par des ersatz à bas prix, c’est ce que l’on appelle « rationaliser ».
Enfin il concoctera un procès de production, c’est à dire une suite de tâches, effectuées le plus possible par des machines, qui garantiront non seulement l’élaboration d’une quantité élevée de Tourtes mais aussi une qualité égale : toutes auront exactement même aspect et même goût.
Il suffira à notre malin de convaincre un financier pour lancer l’industrie et, je n’en doute pas, gagner beaucoup d’argent. Ce qui est le but de l’effort engagé.
Le problème avec le cinéma est qu’il se refuse à toute force de rentrer dans le même cadre. Aucun producteur, même le plus dénué de scrupule, n’imagine livrer au public exactement le même film tous les mercredis. Ce serait d’évidence tout à fait absurde. Et si c’est absurde alors adieu procès de fabrication et économie d’échelle. Exit l’idée de traiter le cinéma comme une industrie.
Les Tourtes de La Mûre sont faites de pâtés de viande, elles n’auront jamais un goût de framboise.
Le cinéma est-il un art ?
Là j’ai bien conscience de me heurter à une difficulté qui dépasse de loin mes facultés philosophiques. Qu’est ce qu’un art, bon sang ?
Rien que l’idée de devoir répondre à cette question m’afflige d’une inextinguible toux caverneuse tout en me vrillant l’estomac de douleurs fulgurantes. Je me revois en train de passer mon baccalauréat et de suer sur un sujet fumeux comparable.
Non désolé il ne faut pas compter sur moi pour tremper le gros orteil dans une mer aussi piégeuse…
Je vais donc me contenter d’une assertion plus ou moins problématique :
- Un art témoigne d’une démarche de création personnelle unique.
Bon ça me paraît assez valable pour l’intégralité des arts reconnus comme tels, sauf contradiction pertinente. En tout cas, en ce qui concerne littérature, musique, peinture etc… ça fonctionne. Mais pas pour le cinéma.
Il suffit d’avoir la patience de rester assis dans son fauteuil et d’ingurgiter l’interminable liste de noms du générique de fin d’un film pour avoir une idée de la réalité de cette fameuse « création personnelle ».
Par ailleurs si nous nous penchons sur la définition juridique d’un film, nous nous heurtons au même genre de problème. Je cite notre bonne vieille SACD, société des auteurs et compositeurs dramatiques :
« En droit français, l'œuvre audiovisuelle est considérée comme une œuvre de collaboration, c'est à dire une œuvre à la création de laquelle ont concouru plusieurs auteurs. La qualité d'auteur est reconnue aux personnes physiques (co-auteurs) ayant créé l'œuvre : auteur du scénario, des dialogues, de l'adaptation, de la composition musicale, de l'œuvre préexistante adaptée, et réalisateur (art. L113-7).
Aux Etats-Unis, les œuvres audiovisuelles sont considérées comme des « works made for hire » (œuvres réalisées dans le cadre d'un contrat de louage d'ouvrages ou de service), notion qui peut être assimilée à celle d'œuvre de commande. L'auteur d'une œuvre est le producteur, qu'il s'agisse d'une personne physique ou d'une personne morale (société de production). Ainsi, l'auteur d'un film change au gré de la vente des catalogues. »
On pourrait se demander pourquoi les décorateurs, costumiers, chefs opérateurs ne sont pas considérés comme des auteurs. Ce serait un débat intéressant...
Le cinéma n’est donc pas non plus un art, tout au moins pas au sens habituel du terme. Si le cinéma était un art, il ne pourrait être qu’art collectif.
Pourtant, pour contourner cette objection, il suffirait qu’un être humain surdoué puisse cumuler tous les talents susnommés.
Si quelqu’un était capable d’écrire, de réaliser, de jouer le personnage principal (pour ne pas dépendre des aléas d’une interprétation), de composer la musique et de produire le film (afin de ne subir aucune contrainte), alors il serait un artiste de cinéma au sens plein du terme.
J’en suis réduit à modifier ma conclusion qui s’énoncera désormais comme suit : le cinéma n’est pas un art à l’exception de Charlie Chaplin… et sans doute de quelques rares autres…
Le cinéma n’est donc au sens strict, ni un art, ni une industrie.
Pourtant vu d’Hollywood, tout se passe comme s’il s’agissait d’une industrie tout à fait comparable à celle, florissante, de l’armement. Et dans notre pays, à hauteur des « cahiers du cinéma », il ne peut s’agit que d’un art bougrement artistique ne connaissant qu’une seule politique, qu’une seule vérité celle de l’Auteur Unique, le Réalisateur.
Comment se fait-il qu’une activité qui n’est foncièrement ni un art, ni une industrie, puisse passer pour l’un et l’autre ?
Aux Etats Unis, le problème a reçu une solution drastique. Mettons nous deux secondes à la place des studios.
Il faut absolument convaincre les financiers d’investir massivement dans les films tout en étant totalement incapable de garantir les retours sur investissement. En l’absence d’une possibilité quelconque d’imaginer un procès industriel, il fallait trouver une astuce pour éviter le risque absolu. Impossible en effet de convaincre un banquier de miser des millions de dollars en lui disant : « Mais si, ça va marcher, pariez donc sur ce saltimbanque ! ».
En ces temps troublés, chacun a bien conscience que si les financiers arguent du risque pour justifier des bénéfices colossaux ils ont en fait une sainte horreur et prennent toutes les dispositions possibles pour s’en débarrasser.
Quand on veut minimiser les risques sur un film de cinéma, il n’y a pas grand chose à faire, mais on peut tout de même agir vigoureusement sur quelques postes nécessaires.
Si chaque film reste une proposition unique, s’il est impossible de mettre au point une véritable production industrielle, on peut essayer de trouver une recette du succès qui appliquée scrupuleusement serait susceptible de réduire l’impondérable.
Evidemment ces cuisiniers d’un genre spécial, qui se grillent les neurones à chercher des « constantes », des « ficelles », des « savoir faire » communs aux grand succès du box office ressemblent à s’y méprendre à des alchimistes lancés à la recherche de la pierre philosophale.
De ce côté ci de l’atlantique, on adore se moquer de ces pauvres hères qui consacrent leur temps à une quête vouée à l’échec. Et on a bien raison.
La recette du blockbuster n’existe pas, bien sûr. Car le succès d’un film est une magie dépendant de tellement de paramètres que la complexité qui en découle ramène au théorème de Gödel : il est entièrement imprévisible.
Mais il n’en reste pas moins que la recherche de l’impossible n’est jamais stérile ; c’est en visant les étoiles qu’on finit par arriver sur la lune.
Et ce qu’ont fini par comprendre les ingénieurs américains du cinéma, c’est qu’en l’absence de recette on pouvait tout au moins apporter un soin particulier à la fabrication du film. Le choix du sujet et de l’histoire, bien sûr, mais surtout de l’écriture du scénario.
Le script écrit par un ou plusieurs scénaristes est non seulement l’histoire que le film racontera, mais surtout la façon de raconter cette histoire. L’unité narrative du scénario est la scène, sorte de brique dramaturgique, qui insérée au milieu des autres créera du sens et imprimera le rythme du récit. Le scénario utilise de nombreuses techniques proprement cinématographiques pour mettre en avant des personnages humains caractérisés confrontés à des conflits qui leur sont propres.
Le dialogue viendra par la suite préciser toutes les intentions et donner les informations nécessaires à la compréhension de l’histoire et de la psychologie des personnages. Une écriture bien menée est susceptible de :
- Maintenir en éveil l’attention du spectateur.
- Surprendre et intéresser par l’exploitation cohérente de caractères humains quel que soit le genre du film produit (drame, comédie, mélo, western, SF etc…)
- Donner à réfléchir par la façon d’exploiter un sujet donné et en exprimant un point de vue, un film de cinéma étant toujours l’expression d’un regard sur une société donnée.
- Inventer une forme de narration filmique qui soit en parfaite cohésion avec le sujet, les personnages traités et le fond du projet.
Tout se passe comme si, ayant évacué toute prétention narcissique en confiant au seul producteur le titre d’auteur, le cinéma américain pouvait se concentrer sur ce qui est de nature à rassurer les financiers.
Au premier chef donc, un scénario travaillé mettant en scène des personnages cohérents dotés de caractères tranchés.
Ensuite un casting de stars.
Puisant dans un immense vivier de prétendants, Hollywood peut se féliciter de posséder les meilleurs comédiens du monde occidental. Ce n’est pas parce que des gênes américains particuliers seraient favorables à l’émergence de talents. Simplement, pour réussir à s’imposer en tant qu’acteur il ne suffit certes pas d’avoir une jolie frimousse ou de présenter la météo sur une chaine câblée. Il faut travailler, faire preuve d’humilité face aux personnages que l’on est censé interpréter et prendre son métier au sérieux.
Enfin un marketing surpuissant.
Chaque film américain actuellement sur nos écrans a coûté plus cher en publicité qu’en production…
Tiens je m’aperçois que dans mon panoramique subjectif du cinéma américain, j’ai totalement oublié le réalisateur…
Donc, après avoir monté un projet de film sur un script et un casting, le producteur américain choisit un réalisateur qui sera chargé de diriger le tournage sous sa surveillance, la décision du montage final étant du ressort du producteur, c’est ce qu’on appelle le final cut.
Loin de moi l’envie de minimiser l’importance du réalisateur dans l’élaboration d’une œuvre filmique. Mais il est vrai que sa responsabilité n’est engagée, dans le format hollywoodien classique, que dans le cadre de son travail sur le tournage. Ni en amont, ni en aval.
Que le seul auteur d’un film hollywoodien soit le producteur peut paraître folklorique aux yeux d’un européen. Cette façon de voir les choses a pourtant un avantage que la domination totale du cinéma américain sur le reste du monde prouve un peu plus tous les jours : dés que le projet est lancé, tout le monde travaille dans le même sens. Du scénariste au monteur en passant par tous les autres corps de métier tous les intervenants mettent leur talent et leur habileté professionnelle à élaborer le meilleur film possible.
En France, sans vouloir refaire un historique du cinéma dans le pays qui l’a vu naître, les choses se sont passées peu ou prou de la même façon jusqu’aux années 1950. Même si le producteur n’a jamais été considéré comme auteur du film, le processus était en gros le même. On partait d’un projet que l’on faisait écrire puis réaliser pour les vedettes du moment.
Et c’est alors que surgissent les « jeunes gens de la nouvelle vague ».
Il faut bien avoir conscience que la prise de pouvoir des Truffaut/Godard sur le cinéma français est d’abord une affaire de conflit de génération. La haine du fameux « cinéma de papa » tant raillé dans les colonnes des « Cahiers du cinéma » témoignait avant toute chose d’un complexe d’oedipe non résolu et de l’envie brûlante de réaliser des films sans attendre d’avoir appris le métier.
Il y a sans doute des raisons sociologiques à cela. La crise de jeunisme ambiante alors s’est aussi attaquée à la littérature avec le « nouveau roman » et également à la musique classique.
Mais si dans ces deux derniers arts les « révolutions » n’ont jamais eu la prétention d’exercer un pouvoir absolu et se sont avérées n’être que des tentatives sans lendemain, en ce qui concerne le cinéma le putsch réussit à merveille.
S’appuyant sur l’appareil théorique d’un critique à la vive intelligence mort prématurément, André Bazin et sa fameuse « caméra stylo », les premiers films de la nouvelle vague vont connaître un vrai succès public. Des producteurs s’étant alors rendu compte qu’on pouvait gagner beaucoup d’argent en misant sur ces « jeunes turcs » (des films qui ne coûtent rien à produire et qui rencontrent un vaste public) la vague a pris l’ampleur d’un raz de marée.
Evidemment je simplifie à l’extrême. Le cinéma « traditionnel » n’a pas capitulé du jour au lendemain. Quelques auteurs du « cinéma de papa » ont tout de même réussi à survivre, d’autres comme Philippe de Broca, ayant commencé avec Truffaut, se sont réfugiés dans la comédie populaire où ils excellent malgré le mépris dans lequel les confine l’intelligentsia.
Pour être honnête il faut reconnaître que cette vague là a fait souffler dans le cinéma un grand vent de fraicheur. La saga d’Antoine Doisnel de Truffaut alliait fantaisie à liberté, les premiers films de Godard révélaient au public le talent de Jean-Paul Belmondo, Chabrol commençait à gratter les croûtes d’aigreur rancie de la bourgeoisie de province etc…
Le destin de la nouvelle vague aurait dû évoluer à l’image de la carrière de François Truffaut, si quelque chose n’avait pas grippé la mécanique. C’est à dire passer lentement des « 400 coups » au « Dernier métro », de la fougue révolutionnaire à la facture ultra classique.
Hélas, la secte hébergée par les « Cahiers du cinéma » veillait au grain et peu à peu elle s’employait à diffuser ses miasmes dans tous les organismes officiels du cinéma français.
Quand je parle d’infection, je ne veux pas dire que tous ces bonnes gens adorateurs perpétuels de la « nouvelle vague » ne sont que remugles de culs de basses fosses, pas du tout. Nous avons affaires en général à de très gentilles personnes, bien mises, bien élevées et tout à fait respectables. Rien ni personne, et surtout pas moi, n’a le droit d’interdire l’expression d’un goût et d’imposer son avis sur le cinéma.
Mais ce qu’a de mortifère à mon sens l’idéologie de la nouvelle vague c’est qu’elle a détruit la notion même d’apprentissage et de métier.
On l’a vu, à l’origine pour les « jeunes gens pressés » il s’agissait de réaliser des films sans passer par le lourd système des studios donc sans avoir à apprendre, de façon fastidieuse, le métier de réalisateur.
De cette façon de voir les choses il découle tout un tas de présupposés au parfum plus ou moins nauséeux.
On naît réalisateur, on ne le devient pas.
On naît scénariste, on ne le devient pas.
On naît comédien, on ne le devient pas…
Le mythe du génie instantané, du talent inné, de la prédestination, de la génétique triomphante est à la base de cette pensée là. En creusant un peu plus, on arrive tout près de la « race des seigneurs »…
Pas étonnant alors si à l’exception notable de JL Godard, la grande majorité des autres « jeunes gens » ont communié dans une position politique droitière allant du dandysme méprisant à la détestation de la démocratie.
En se diffusant peu à peu dans les tissus officiels, (le centre national de la cinématographie, l’université etc…) la politique de l’auteur unique, celle du réalisateur sanctifié, s’est imposée en maîtresse du jeu et colporte ses fariboles en dehors même de toute validation de ses thèses par la réalité. En cela elle est très proche de l’idéologie néo-libérale ; elle existe au delà des faits et l’absence criant de résultat la renforce.
Si n’importe qui aujourd’hui peut réaliser un film (à condition de disposer des bonnes relations) le résultat obtenu est souvent n’importe quoi, ce qui paraît logique.
Afin de pallier à ce léger soucis, les grands prêtres du dogme réunis en synode ont décidé de créer une école, un grand séminaire tout entier dévolu à l’enseignement des mantras de la sainte parole : la Fémis est née sur les cendres de l’Idehc.
Une école ? Oui une école, mais n’exagérons rien, à la Fémis il n’est pas question d’apprentissage réel mais de mettre à la disposition de génies de 20 ans les moyens techniques pour qu’ils puissent épanouir leur art inné. A la différence des écoles des Beaux arts ou des conservatoires de musique, il est hors de question de faire suer ces petites merveilles en les faisant travailler sur des gammes issues des maîtres anciens.
Mais ce qui semble une facilité extraordinaire pour eux s’avère être un piège infernal.
Que demande t-on à un élève de la Fémis à la sortie de ses études ? D’écrire et de réaliser un film, bien sûr, mais pas n’importe lequel.
Il s’agit de se montrer à la hauteur des attentes que l’on a mises en vous. Donc il vous faut, à 25 ans, réussir un film qui témoigne : d’une écriture à la fois aboutie et novatrice, d’une compréhension de la vie digne d’un vieux philosophe, d’un regard décalé et intelligent sur la société, d’un sens esthétique remarquable, d’une maîtrise consommée dans la direction d’acteur etc…
Autant dire qu’il s’agit en fait d’envoyer ces jeunes gens au casse pipe. Ce qui explique que le cinéma français est le champion du monde des premiers films… Qui ne seront que rarement suivis par un deuxième.
Comment parvenir à gagner un pari pareil ? Déjà qu’il est assez ardu de maîtriser la réalisation, il faut de plus que ces gens se montrent scénaristes d’expérience… Et tout le monde n’est pas doué pour ça. De malheureux étudiants qui auraient pu devenir de très bons réalisateurs voient leur carrière stoppée dés le départ parce qu’ils se sont montrés médiocres écrivains. Sous le contrôle des ayatollahs des cahiers ou de leurs sbires, la Femis est devenu en quelques années le plus grand hachoir à talents du monde, et le plus onéreux.
Le pire étant que les pauvres diables au « film unique » traîneront toute leur vie un échec qui n’est pas le leur. Culpabilisés par « leur faute », ils sont incapables de s’apercevoir qu’ils auraient fait de très bons professionnels si on leur avait laissé le temps d’apprendre et de réfléchir.
Même quand la machine à claques débusque un élément prometteur les dangers qui guettent le miraculé ne sont pas moindres.
On peut pour illustrer ce dernier cas prendre l’exemple de Leos Carax, pourtant indemne de toute Femis. Voilà un jeune homme qui signe un premier film intéressant, pas fantastique mais tout à fait au dessus de la moyenne, suivi d’un deuxième dans le même goût. Enfin ! semblent se dire d’un commun accord la critique des cahiers et les cahiers des officiels. Notre politique de l’Auteur Unique est validée ! Et les voilà tous ensemble qui se jettent sur cet os comme des morts de faim. Monsieur Carax est promu génial génie en chef.
La suite, tout le monde hélas la connaît : la pompe a égo ayant fait son œuvre, le pauvre Léos qui a déjà de la peine à marcher en raison de ses chevilles enflées se lance dans « Les amants du Pont-neuf ». Et le voilà qui se démène et donne la mesure de sa suffisance. Résultat : dépenses pharaoniques, crises de nerfs, faillite de studio et échec commercial. Le génial génie s’est employé tout seul à se brûler les ailes. Exit Léos Carax et tant pis pour les beaux film qu’il aurait pu réaliser s’il avait pu disposer d’un véritable producteur pour l’aider à combattre son plus farouche ennemi, lui même.
Car parmi les dommages collatéraux que nous ferons endosser sans trembler à la « nouvelle vague » figure aussi la déconfiture du métier de producteur.
Que faire face à l’Auteur Unique ?
Pour un producteur il n’y a qu’une alternative, produire ou ne pas produire. Pas question en effet de s’imposer face à lui, le maître, le dictateur de son royaume. L’Auteur Unique est en mesure d’imposer ses choix, ses lubies ou ses caprices. Le producteur n’ayant au fond que celui de limiter le budget. Pour ce pauvre diable, les ennuis commencent déjà à l’écriture du scénario. Il va de soi que l’Auteur Unique est aussi le scénariste, sinon il ne serait pas unique.
Depuis la « nouvelle vague » on sait que le scénario n’a aucune importance, ce qui compte réellement c’est ce qu’en fera le réalisateur sur le plateau. Donc point n’est besoin de s’embêter avec si peu, une écriture rudimentaire suffira et le reste s’arrangera au tournage, sans doute par intervention de la « main invisible », la même que celle qui équilibre si bien les marchés.
Le producteur trouve-t-il le scénario puéril ? Il ne connait rien à la fraicheur. Le considère-t-il incohérent ? Ce ne sont qu’audaces afin de casser la narration linéaire etc…
Bref, du début à la fin de la production, le pauvre bougre en est réduit à faire une absolue confiance au réalisateur. En gros, ça passe ou ça casse !
Dans ces conditions le métier de producteur consiste seulement à draguer les réalisateurs les plus en vue, les comédiens les plus « bankable » et à rechercher les fonds nécessaires. Mais la part proprement artistique de son travail n’existe plus, il en a de toute façon perdu les compétences. Les producteurs qui aujourd’hui sont capables de donner un avis technique intéressant sur un scénario se comptent sur les doigts de la main… Et il faut bien le dire, c’est une catastrophe.
Le bilan de la « nouvelle vague », plus de cinquante ans après son émergence, est celui d’un appauvrissement général.
Réduction du niveau moyen des films, perte du savoir faire et des compétences scénaristiques, raréfaction des comédiens de talent, remplacés qu’ils sont par des « natures » ou des « modèles » à la mode de Robert Bresson.
Il n’est pas étonnant que bien que la France produise chaque année un très grand nombre de films, la part du cinéma français dans la fréquentation en salle reste minoritaire. Et ce malgré la présence, à côté des films à auteur unique, des grosses productions à stars et à budget éléphantesque qui raflent la plupart des succès populaires, de Luc Besson aux « ch’tis »… S’il fallait compter uniquement sur les films à auteur unique pour « faire des entrées », le cinéma français serait réduit à l’état de traces.
Cet état des choses, tout le monde le constate. La politique de l’Auteur Unique a triomphé à tel point que « cinéma français » est devenu un genre, à l’égal du mélodrame ou du western ! Genre qui se définit par le thème : « errance d’un(e) jeune bourgeois(e) confronté(e) aux sentiments », l’absence de rebondissements, l’irruption de scènes « décalées », l’incohérence des personnages. Avec un tel programme, bonjour les comédies pas drôles, les drames stupides, les polars sans tension… Des films français vous dis je !
Aujourd’hui le grand écart entre films à auteur unique souffreteux produits grâce aux subventions du CNC et des régions et grosses cavaleries des comédies à casting de stars s’élargit à tel point qu’il menace de faire craquer la couture du pantalon.
De plus en plus de voix s’élèvent pour dénoncer la disparition des films dits « du milieu », ceux qui nécessitent un véritable budget tout en restant raisonnables, coincés entre les films « à l’arrache » et les délires ruisselant d’euros des énormes superproductions.
Entre autres protestations, celle du groupe des Treize emmené par Pascale Ferran est sans aucun doute la plus intéressante.
Appuyée par un rapport argumenté sur l’état du cinéma français, Madame Ferran et ses amis avancent une suite de propositions visant aussi bien à réformer la production, victime à ses yeux de la toute puissance de la télévision, que la distribution. Certaines de ces suggestions étant pour le moins frappées au coin du bon sens.
Néanmoins ce que le groupe des treize se garde de remettre en cause est la raison même de cette décrépitude annoncée du cinéma français, c’est à dire le règne absolu de l’auteur unique. Tant que le réalisateur, et ce quelque soit sont niveau artistique et sa responsabilité dans la fabrication du film, ira plastronnant sur les plateaux de télévision et aux tribunes des festivals en revendiquant pour lui seul le travail de toute une équipe, rien ne changera jamais au pays de Voltaire.
Si l’on peut laisser de très bon cœur leur place aux « cinéastes » artistes de cinéma, à la façon Godard-Straub/Huillet, si l’on est bien forcé de supporter les énormes machineries dispendieuses à la « Astérix », il est urgent de faire revivre une façon de faire du cinéma qui ne soit ni un art, ni une industrie. C’est à dire d’ouvrir la porte à ces fameux films du milieu dont tout le monde déplore la disparition.
Car il existe bien une troisième voie entre l’art et l’industrie, celle de l’artisanat.
Entre l’autisme de l’artiste cinéaste et la filouterie du faiseur industriel, je revendique une place pour la sincérité de l’humble artisan, pour celui qui ne confondant pas son nombril avec le centre du monde se consacre à pratiquer son métier du mieux qu’il le peut, trouvant dans l’apprentissage constant et dans l’exercice un véritable sens à sa vie.
Nombre de réussites en terme de qualité du cinéma français sont en fait des œuvres d’artisans où chacun à sa place peut donner le meilleur de lui même.
J’en prendrai pour exemple le fameux « Série noire » réalisé par Alain Corneau, écrit par Georges Perec d’après un roman de Jim Thomson et interprété par un Patrick Dewaere touché par la grâce… De véritables auteurs donnant en toute confiance le meilleur d’eux même…
Ou encore l’œuvre entière d’Alain Resnais à qui nul de songerait à dénier le tire d’auteur mais qui témoigne dans ses mises en scène d’un véritable sens artisanal par sa méticulosité et son humilité. On n’a jamais surpris Monsieur Resnais à signer « un film de » mais toujours « réalisé par », sans que son statut de véritable trésor national vivant, au sens japonais de l’expression, soit menacé.
Remettre donc au goût du jour les apprentissages, le sens du travail bien fait sans que personne ne se sente dépossédé, vampirisé ou maltraité par l’ego surdimensionné d’un autre.
Une véritable révolution…
Une révolution conservatrice ? Peut-être bien. Un retour aux sources, à l’origine, au sens plus certainement. Une remise en cause totale de la politique calamiteuse de l’auteur unique en tout cas.
Laissons les vivre, ces talents incomplets au sens « cahiers du cinéma », ces réalisateurs doués incapables d’écrire, ces scénaristes heureux de leur isolement qui ne se rêvent pas dirigeant un tournage, ces producteurs qui ont le goût de faire travailler des auteurs ensemble sans avoir à se soumettre aux caprices d’un seul.
Laissons les vivre car c’est cela le cinéma : un travail collectif, plein de bruit et de fureur mais exaltant quand on a conscience que la réussite d’un film, comme la beauté d’une cathédrale, ne dépend que du talent d’une équipe qui dépasse de loin la somme des talents ajoutés.
Ajouter une réaction
Pour réagir, identifiez-vous avec votre login / mot de passe, en haut à droite de cette page
Si vous n'avez pas de login / mot de passe, vous devez vous inscrire ici.
FAIRE UN DON








