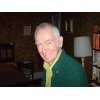Si Degas m’était conté
Comme chaque saison, l’Opéra de Paris a précédé sa soirée de ballet vendredi dernier par le traditionnel Défilé du corps de Ballet.

Je n’y ai pas « goûté un plaisir extrême ». C’était à l’Opéra-Bastille et il faut au moins les sculptures dorées de Garnier - avec tout au bout le Foyer de la danse dont on reconnaît les miroirs et les lustres, le fond de scène étant levé - pour retrouver les réminiscences de ce XIXe siècle évoquées par ce pompeux défilé sur la marche de Berlioz.
Cette présentation solennelle des 154 membres du Corps de ballet (puisqu’à Paris les solistes et les étoiles sont inclus dans l’ensemble du ballet) strictement hiérarchisée, grade par grade, chaque niveau ayant sa préséance, nous rappelle que l’Académie de danse a été fondée en 1661 par le jeune Louis XIV. C’est presque deux siècles plus tard que se déploya la suprématie française de la danse romantique avec Gisèle et La Sylphide. C’est là où nous retrouvons Degas, ses danseuses travaillant à la barre ou accompagnées de leurs protecteurs, dans ce même Foyer de la danse, point de départ du défilé. Cette lente approche du public était à cette époque le baromètre sans équivoque de la popularité des danseurs courant sur les derniers mètres saluer à l’avant-scène leurs admirateurs.
Ce temps-là est passé et bien sûr tant mieux. Il n’existe plus ces rivalités mortelles entre solistes, qui existaient encore dans les années 50 aux mercredis de la danse où les abonnés avaient à l’entracte accès au Grand Foyer.
L’arrivée de Noureev, son exigence, son goût de la perfection, a fait disparaître tout favoritisme. La haute qualité de l’Ecole de danse qu’il a contribué à former nous a procuré ces dernières années une brassée d’étoiles de plus en plus jeunes. Etre étoile à 24 ans... quelle griserie ! Avoir acquis la compétence technique permettant d’aborder les plus grands rôles et avoir vingt ans devant soi pour affiner son style et sa maîtrise... quelle ivresse !
La soirée dont je parle comportait un programme particulièrement remarquable. Tout d’abord le ballet d’opéra dans toute sa gloire, Raymonda le plus accompli des ballets de Petipa, enrichi par la reconstitution de Noureev. Suivi d’un des grands Balanchine, Les Quatre Tempéraments, net, pur, exemple de néoclassicisme. Enfin l’une des toutes récentes créations de William Forsythe, le retravail en profondeur d’un ballet de 1984, Artifact suite.
Dans ce ballet, admis à l’Opéra en 2005, Forsythe s’efforce de trouver une nouvelle façon de signifier. La première partie, sur une musique de Bach, se décompose en sections, parfois très courtes, séparées par un baisser de rideau où à chaque fois la figuration des danseurs est différente. Dans la seconde partie, sur une musique de Crossman-Hecht, les danseurs circulent entre eux en trajets sinueux et, par des claquements de mains, interfèrent avec le rythme de la musique, qu’éventuellement ils modifient. Un travail complexe et savant du plus haut intérêt.
A elle seule, cette soirée nous offrait toutes les références nécessaires à suivre l’évolution de l’art du ballet, d’apprécier ses nouveaux choix dans notre monde contemporain. Du divertissement, qui à l’origine n’était que pur prétexte à virtuosité, il devient besoin d’expression, découverte d’émotions dans le déplacement du corps dans l’espace, puis recherche de codes nouveaux et, enfin, façon nouvelle d’être spectateur.
Une distribution foisonnante d’étoiles nous a donné une exécution exemplaire, étoiles qui d’ailleurs voisinent avec des solistes dont certains paraissent presque leurs égaux. Par toutes ces qualités, en toute objectivité, le Ballet français occupe actuellement dans le monde une place privilégiée.
Ajouter une réaction
Pour réagir, identifiez-vous avec votre login / mot de passe, en haut à droite de cette page
Si vous n'avez pas de login / mot de passe, vous devez vous inscrire ici.
FAIRE UN DON