« There will be Blood » : une marée noire sanglante...
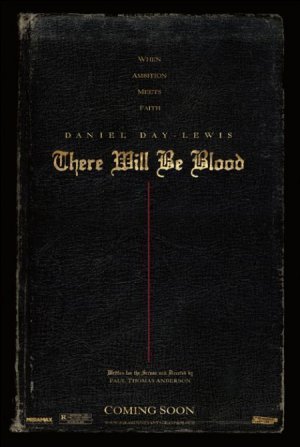
Film tendu, âpre et majestueux que ce There will be Blood (Il y aura du sang) signé Paul Thomas Anderson (PTA) et adapté du roman Oil ! (1927) d’Upton Sinclair. Du 3 étoiles sur 4 pour moi. Pas 4 car il y manque un petit supplément d’âme ou un je-ne-sais-quoi artistique de plus naturel, de moins « apprêté », qui pourrait le hisser, par exemple, au rang de chef-d’œuvre crépusculaire façon Cimino, grand cinéaste lyrique des grands espaces américains travaillés par la dualité insoluble en l’homme entre le Bien et le Mal originels. De plus, il faut bien l’avouer, le dernier PTA est un peu long. OK, il faut laisser du temps à la pellicule, quasiment embrasée ici, pour planter le décor et camper les personnages (dont un prospère prospecteur de pétrole, Daniel Plainview, et un prédicateur manipulateur, Eli Sunday), mais tout de même, 2h38, ça fait long et, par instants, la vue de certains derricks parsemant le décor aride m’a rappelé certains épisodes longuets de L’Inspecteur Derrick !
Trêve de plaisanterie, en général, dans une certaine presse institutionnelle, il est de bon ton de critiquer haut et fort ce « génie autoproclamé » du cinéma américain (PTA) en le taxant d’habile faiseur, de petit malin surfant sur la nouvelle vague du moment ou bien encore de cinéaste DJ qui aurait bien assimilé les « recettes » de ses aînés (Scorsese, les Coen...) pour nous servir un exercice de démonstration et de style un peu vain. Pourtant, force est de constater, à la vue de ses films - j’avoue avoir un faible pour son clinquant Boogie Nights (1998) se passant dans le milieu du porno mais je trouve aussi pas mal du tout son Magnolia (2000) et autres Punch-Drunk Love (2003) -, que ce jeune cinéaste américain (né en 1970) est un réalisateur ambitieux et fort talentueux. Via son dernier film, il présente quelque peu la même trajectoire qu’un David Fincher récemment, avec son impressionnant Zodiac. Voilà bien deux cinéastes hollywoodiens, taxés régulièrement et ce depuis leurs débuts de réalisateurs branchouilles pour djeunes, qui gagnent, avec leurs dernières productions filmiques, en maturité et en probité. Les voilà moins farcesques, moins happy few, moins m’as-tu-vu et plus enclins, en laissant le temps au temps et en évitant tout filmage épileptique abrutissant, à s’attarder sur leurs personnages en chair et en os, et à sonder l’âme humaine, sans fioriture et autres effets de manche plus ou moins gratuits - tant mieux.
J’ai bien accroché avec son tout dernier, There will be Blood, parce que ce film-fleuve, se déroulant en Californie de 1898 à 1927 sur fond de rêve américain, nous dresse un tableau tout en clair-obscur et sans concession du capitalisme frénétique yankee - vous savez, celui obéissant au fameux mot d’ordre « travailler plus pour gagner plus » jusqu’à en oublier le facteur humain. C’est la conquête de l’Ouest à l’ère de son expansion capitalistique tous azimuts, c’est donc une contrée carrément à l’Ouest qui nous est montrée sur un écran Cinémascope brut de décoffrage : les femmes en sont quasiment absentes, les hommes y règnent en maîtres acerbes, en bâtisseurs avides cherchant à dompter coûte que coûte Dame Nature. Ce décor planté et filmé au cordeau (la ville naissante dans un paysage désertique) m’a fait un peu penser à Il était une fois dans l’Ouest de Leone mais surtout à... Tintin en Amérique (1947) ! Eh oui, souvenez-vous de la fameuse planche 29 nous montrant un petit coin tranquille soudain envahi par des businessmen américains assoiffés de pétrole et de pognon à gogo(s). En quelques cases, on voit une ville entière se construire sous nos yeux. Dans le PTA, ça se passe au tout début du XXe siècle, au temps des cow-boys à l’âge de l’ère industrielle de l’Oncle Sam, mais ça pourrait se passer hic et nunc, dans une certaine Amérique consumériste et va-t-en-guerre actuelle ou bien dans une certaine France bling-bling d’aujourd’hui ayant cette fâcheuse tendance à placer le capital économique avant le capital humain, d’où des dommages collatéraux sociétaux laissant une traînée de poudre derrière eux. On connaît la chanson, hélas. Rien que pour cette leçon de vie, certes pas bien nouvelle (!), sur les dégâts d’un capitalisme aveuglé par le profit et la course aux billets verts (et qu’importe l’argent sale), ce film spirituel, sans être moralisateur à tire-larigot pour autant, vaut largement le détour. Il ne manque ni de souffle ni de regard pénétrant sur la société occidentale d’hier et d’aujourd’hui.
C’est un film pesant. Il est riche en sensations : Impression soleil cognant. Bienvenue au pays de l’or noir : grosse chaleur, surexposition, sensations d’étouffement, de moiteur et de sécheresse. Economie de dialogues. Aridité des lieux, des corps et des cœurs, pour la plupart en hiver. La nature n’est pas bienveillante. Il s’agit au départ de trous perdus peuplés de fermiers peinards, vivant d’élevages, de cultures, d’amour et d’eau fraîche. Le film commence par une musique stridente (superbe composition dissonante de Jonny Greenwood) pouvant faire penser à l’aube de l’humanité dans 2001, L’Odyssée de l’espace. Ici, pas de gorilles violents ou d’os se transformant en vaisseau spatial à la conquête de l’espace. On a plutôt des figures humaines hagardes s’apparentant bientôt, sous une pluie noire de pétrole (selon moi, la plus belle séquence du film), à des vampires ou à des oiseaux mazoutés, fondus au noir poisseux et puant. On dirait un chantier à ciel ouvert avec une mécanique des fluides (sang, sueur, alcool, pétrole...) fonctionnant à plein régime et transformant bientôt les braves travailleurs de l’American Dream en ombres parmi les ombres, en êtres-pour-la-mort. Des derricks dressés, par moments en feu, font penser aux territoires désolés et carbonisés d’une terre d’Irak d’aujourd’hui profondément meurtrie. Le danger rôde (explosions de gaz, poutres et armatures métalliques s’effondrant...), on pense à Breaking the Waves de Lars Von Trier. Ces puits de pétrole peuvent vite se transformer, au détour d’un plan, en guillotines ou en tombeaux. Dans cette Matrice Grand Avalou, l’humain se perd dans des trous noirs, sur fond de corruptions, de trahisons et des puissances vénéneuses du Dieu Pétrole - exit alors le sens de la communauté, les croyances, la distinction entre le Bien et le Mal et les liens familiaux (cf. la relation très complexe, d’amour-haine, entre le père et son fiston, appelé comme une machine ou un matricule, H.W.). Pas loin d’un documentaire, via le filmage sec de la prospection et de l’exploitation du pétrole (forages, pipelines, industrie florissante du pétrole), on assiste alors, en pleine fièvre de l’or noir, à un empire pétrolifère qui prolifère, tel un cancer.
Dans ce décorum misant sur la banalité du mal, on a affaire à Daniel Plainview, un simple prospecteur de pétrole (joué remarquablement par le charismatique Daniel Day-Lewis, tout dernièrement oscarisé, alléluia !) qui, petit à petit, va construire un mini-empire pétrolifère en faisant feu de tout bois et en se transformant progressivement en rapace misanthrope avide d’or noir. C’est une machine ayant pour seul carburant le white-spirit et l’esprit de compétition, il s’agit de doubler l’autre, dans tous les sens du terme. C’est un profiteur XXL, mais pas un jouisseur : il ne sait pas jouir de la vie, c’est même un handicapé de la vie. Plainview est un homme sans grande visée philosophique ou existentielle. Il fuit résolument la compagnie des hommes (il n’a pas de vie sentimentale, de femme ou d’amant), d’ailleurs, dans la bouche d’ombre de la nuit, il n’hésite pas à déclarer : « Je hais la plupart des gens, alors je veux juste gagner suffisamment d’argent pour les éloigner tous. » Et c’est d’ailleurs ce qu’il parvient à faire, implacablement. A la fin, dans son antre fantomatique aux perspectives fuyantes, rappelant aussi bien le milliardaire excentrique Howard Hughes retranché dans sa tour d’ivoire (Aviator) que la prison dorée (Xanadu) de Citizen Kane, notre magnat du pétrole est devenu un vieil Oncle Picsou solitaire proche d’une... Tatie Danielle cultivant la haine de soi et des autres. Il est dans la jouissance du Mal, n’hésitant pas à renier son fils (le seul lien qui pendant le film en fait de temps en temps un semblant d’humain, doué de sentiments) ou à dézinguer, à coups de quilles mortels, le jeune prêtre, prophète de pacotille, manipulateur devenu manipulé.
In fine, l’addition de la marée noire s’avère corsée et particulièrement... saignante. On est dans ce final (la vie comme une piste de jeu avec, à la clé, un winner et un loser ?) quasiment dans le tragi-comique, pas éloigné d’un certain burlesque d’antan se régalant dans le jeu de massacre tonitruant. D’ailleurs, le génial Daniel Day-Lewis, avec ses cheveux noirs frisés et sa moustache lui barrant le visage, n’est pas sans rappeler par moments la « soupe à la grimace » de Charlot. Oui, j’adore cette scène finale se déroulant dans une salle de jeu car, tel un geyser narratif qui explose sans crier gare, elle montre alors toute la puissance d’accélération d’un cinéaste comme PTA pouvant passer soudainement du rire aux larmes, et vice-versa. En quelques plans, il dit tout des relations étroites et complètement hypocrites entre capitalisme et Eglise cherchant, en vain, à faire bonne figure, histoire de sauver les meubles et surtout la thune. En quelques instants, le film oscille entre tragédie et farce cartoonesque : ainsi, la dualité du personnage principal - Daniel Plainview, un vrai pourri mais pas totalement antipathique à 200% - n’en est encore que plus manifeste, chapeau. Oui, voilà bien un film très intéressant à suivre car ces différents niveaux de lecture en font un bloc filmique mystérieux qui, tel un navire pétrolier sillonnant une mer d’huile, glisse quelque peu entre les doigts englués ad nauseam dans l’eau trouble...
Documents joints à cet article




3 réactions à cet article
Ajouter une réaction
Pour réagir, identifiez-vous avec votre login / mot de passe, en haut à droite de cette page
Si vous n'avez pas de login / mot de passe, vous devez vous inscrire ici.
FAIRE UN DON









