Comment voyons-nous les animaux ? Par le prisme Anthropomorphique ? Ou par celui de l’Empathie ?
Quand on pense comprendre les sentiments des animaux que l'on observe... est-ce de l’Anthropomorphisme ? ou de l’Empathie ?...
Ce sont deux concepts bien distincts, que l’on prend quand même souvent l’un pour l’autre, surtout quand on parle d’animaux. Comment est-ce possible ? Pourquoi convient-il de les distinguer ?
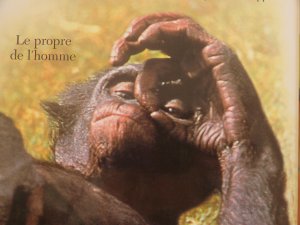
Au départ, l’Anthropomorphisme est une croyance qui attribue aux Dieux une nature semblable à celle humaine. Ainsi, on faisait des offrandes/prières aux Dieux pour apaiser leur colère, ou pour solliciter leur bienveillance.
Par extension, l’anthropomorphisme consiste aujourd’hui à attribuer des caractéristiques/ intentions / émotions humaines à des phénomènes/ événements, à des objets inanimés, à des animaux.
Ainsi, on parlera d’une mer mauvaise, d’un mur menaçant, d’un lézard amical.
L’ Empathie, c’est tout autre chose : c’est une faculté intuitive de se mettre à la place d’autrui, de percevoir ce qu’il ressent.
Quand on observe les animaux, on a souvent l’impression de comprendre certaines de leurs émotions comme la colère, la peur, la surprise, la tristesse,…
Faisons-nous confusion ? Est-ce de l’anthropomorphisme ?
Souvent non.
Marc Bekoff (1) l’exprime très bien : « …nous ne prêtons pas aux animaux quelque chose d’humain ; nous identifions des similitudes et nous utilisons le langage humain pour traduire ce que nous observons. » (2)
Je développe à présent à support de cette conviction :
A – Les principales hypothèses implicites qui influencent notre raisonnement.
B – L’homme animal spécial « parmi les autres » (et non « à part » des autres).
C – L’empathie émerge d’un substrat neuronal, et n’est pas spécifique à l’homme.
D – La sélection naturelle a aussi favorisé l’émergence de l’empathie.
E – l’empathie « passe mieux » entre espèces proches.

A – Les principales hypothèses implicites qui influencent notre raisonnement.
Le fait que l’on penche intuitivement pour un concept plutôt que pour un autre dépend des "hypothèses implicites" qui nous habitent. Ensuite, le raisonnement travaillera « à charge » et/ou « à décharge ».
Si notre histoire personnelle fait que nous avons intégré certains aspects de l’histoire socio-culturelle de la communauté qui nous a vu grandir, nous pouvons considérer que l’homme est un être spécial, et « à part ».
De ce fait, il y aurait une telle distance entre l’homme et le reste du vivant, qu’il serait absurde de supposer que certains animaux puissent ressentir des émotions similaires aux nôtres, que nous pourrions ainsi détecter par empathie. De ce fait, parler des émotions que pourraient ressentir tel ou tel animal ne pourrait être qu’Anthropomorphisme, nécessairement.
Mais, par le même cheminement de notre histoire personnelle, nous pouvons aussi considérer que l’homme est un animal spécial « parmi les autres ».
Dans ce cas, la vision du monde qui y est associée est plus complexe et plus naturelle.

B – L’homme animal spécial « parmi les autres » (et non « à part » des autres).
Cette vision se place normalement dans une perspective évolutionniste, qui considère que les structures physiques du cerveau fournissent le substrat neuronal aux émotions et aux raisonnements.
Charles Darwin expliquait qu’il existe une continuité évolutive entre les animaux, non seulement dans les structures anatomiques (pattes, cœur, dent,…) mais aussi dans le cerveau et les capacités cognitives et affectives qui lui sont associées. (3)
Sur ce même thème, Marc Bekoff souligne que « … cela ne signifie pas que les hommes et les animaux sont identiques, mais qu’ils partagent un certain nombre de traits communs, physiques et fonctionnels, que leurs capacités s’inscrivent dans un continuum. » (2)
Déjà en 1952, Paul MacLean décrivait sa vision du cerveau « triunique » (trois-en-un) des mammifères supérieurs :
- Un cerveau primitif (parfois appelé « reptilien ») que l’on retrouve chez les poissons, les amphibiens, les reptiles, les oiseaux, et les mammifères.
- Un cerveau Limbique (ou « paléomammalien »), que possèdent tous les mammifères
- Un cerveau Néocortical (ou « néomammalien »), que possèdent certains mammifères, dont les primates (et y compris donc les humains).
Tous ces éléments du cerveau, quand ils sont disponibles chez l’individu considéré, sont bien entendu interconnectés, et permettent de disposer de réactions automatiques, d’émotions primaires, d’émotions sociales, de raisonnement.
Le neurobiologiste Jean-Pierre Changeux complète le tableau en expliquant (15) que trois histoires se nouent au niveau de chaque individu :
Celle de l’évolution des espèces
Celle de l’histoire socio-culturelle de la communauté de l’individu, et
Celle de son histoire personnelle.

C – L’empathie émerge d’un substrat neuronal.
L'empathie n’est pas spécifique à l’homme.
Revenons à présent à l’aspect « empathie », qui est un sous-ensemble de ce dont nous venons de parler.
L’empathie ne surgit pas « ex-nihilo » !
Dès 2003, les travaux de la neurobiologiste Laurie Carr permettent d’affirmer que « l’empathie possède un fondement neurobiologique » (8)
En 2006, Sandra Blakeslee expliquait (4) que ce sont les neurones « miroirs » qui permettent à l’homme « … de saisir les pensées des autres , non par le biais d’un raisonnement conceptuel, mais par une simulation directe… »
Cette caractéristique humaine s’exprime en dehors de tout apprentissage. C’est une capacité innée, c’est-à-dire issue de l’évolution de l’espèce.
A la même époque, en 2006, les travaux du neurobiologiste Giacomo Rizzolatti (5) étaient cités dans le New York Times, et créaient une certaine stupéfaction : le cerveau des singes dispose aussi de neurones « miroir » !
L’Institut de renommée mondiale Max Planck (6) de Leipzig a aussi conduit nombre d’études sur de nombreuses espèces, et ont conclu que l’empathie est une caractéristique innée chez de nombreuses espèces.
Ainsi, un chimpanzé aidera son voisin à se nourrir, dans la cage voisine, si ce dernier n’a pas accès à la nourriture, alors qu’il peut lui y avoir accès pour les deux.
Aussi, un macaque cessera de s’alimenter dès qu’il se rendra compte que son voisin de cage reçoit une décharge électrique à chaque fois que lui-même se nourrit. Et d’autres tentatives amènent le macaque à se priver de nourriture durant plusieurs semaines.
Les neurones miroirs (ou d’autres neurones effectuant la même fonction) sont donc bien le support biologique d’une adaptation/ sélection naturelle.
On peut illustrer cette affirmation de sélection naturelle par les intéressants travaux de Marc Bekoff : il a travaillé durant sept ans sur les coyotes du Grand Teton National Park (Wyoming). Il a mis en évidence que « …plus de 55% des petits qui se marginalisaient avaient trouvé la mort, et qu’elle frappait moins de 20% de ceux qui restaient dans le groupe. »
En fait, l’empathie est un préalable pour vivre à l’intérieur d’une société animale : une réaction « socialement appropriée » est grandement favorisée quand on est en mesure de percevoir l’état d’esprit des autres… réaction appropriée qui permet d’éviter d’être exclu, et donc de continuer à bénéficier de la sécurité du groupe.
Marc Bekoff a bien montré, par exemple, que les jeunes coyotes qui ne respectent pas les règles du jeu entre jeunes, ne tardent pas à se retrouver seuls et rejetés quand ils tentent de rentrer à nouveau en contact « …lorsqu’il n’y a plus ni coopération ni loyauté, non seulement le jeu s’arrête, mais il devient impossible. »
L’empathie est donc bien un élément qui joue dans la sélection naturelle au niveau du groupe.

D – La sélection naturelle a aussi favorisé l’émergence de l’empathie.
L’idée de sélection naturelle chez l’homme avait germé dans plusieurs cerveaux, bien avant Darwin (10). Ainsi, le scénario de Thomas Malthus (9) incluait un ajustement à la baisse de la population (par famines et maladies), après une longue période de hausse de la population, laquelle croissait plus vite que la production alimentaire, dans son scénario. Cette idée d’un ajustement constitue un élément de sélection naturelle.
Le sélection naturelle a longtemps été perçue comme opérée principalement à travers la compétition pour l’accès aux ressources (alimentaires ou autres). D’où un sentiment d’égoïsme qui est souvent associé à l’idée de sélection naturelle.
Même Charles Darwin avait un discours plus nuancé pour l’homme (16) : « Il est possible que les communautés comportant le plus grand nombre de membres doués d’empathie soient les plus prospères et aient la progéniture la plus nombreuse ».
Charles Darwin avait aussi bien observé la présence d’actes altruistes chez les animaux. Le cas de l’attitude altruiste des abeilles ouvrières l’avait frappé. Il avait alors supposé que, dans ce cas, la sélection naturelle devait intervenir au niveau de la colonie tout entière, comme s’il s’agissait d’un animal complexe…
Poursuivant ses recherches dans cette voie, le biologiste William Hamilton (11) démontra que l’altruisme peut apparaître par sélection naturelle, s’il est dirigé vers ses proches.
Bien d’autres travaux suivirent.
Par exemple, Robert Trivers (12) explique que le partage de la nourriture dans les sociétés de chasseurs-cueilleurs (règle du partage traditionnel = altruisme réciproque) leur permet de survivre dans les périodes plus difficiles, et donc de se perpétuer. Trivers développe son propos en soutenant que, pour pouvoir établir ce partage comme pratique « standard », les émotions et les sentiments qui permettent d’adhérer individuellement au concept ont été sélectionnées naturellement. On parle ici de sentiments tels empathie/ compassion, gratitude, justice, etc etc… qui ont été sélectionnés naturellement…et qui sont parvenus jusqu’à nous.
Cela me rappelle les péripéties des jeunes coyotes, pour qui l'adhésion aux règles du groupe aident à mieux survivre…
Pour clore ce paragraphe sur l’altruisme, je propose deux citations du psychologue Nigel Barber (13) : « Les bases biologiques de l’altruisme des mammifères, humains compris, sont clairement différentes de celles des insectes, car les mammifères ont des mécanismes de contrôle de leurs attitudes qui sont orchestrées par des réactions émotives comme la peur, la colère, l’attirance du groupe. Les insectes semblent montrer des réponses automatiques dans leurs attitudes sociales. » Cependant l’altruisme est une conquête fragile : « …au final,la présence d’intérêts conflictuels minent l’altruisme. » (14)

E – l’empathie « passe mieux » entre espèces proches.
« L’homme appartient à une espèce qui fait surtout appel à la vue ; mais lorsque nous examinons d’autres animaux, nous devons prendre en compte les sons, les odeurs et les saveurs tout autant que les stimuli visuels. » (Marc bekoff) (1)
L’ethnologue Joyce Poole (7) complète ces propos en expliquant « … que les éléphants éprouvent des émotions que nous n’éprouvons pas, et vice-versa » et « …que nous en partageons beaucoup. »
« La continuité évolutive permet de conclure raisonnablement qu’il y a de fortes chances pour que ces neurones "miroir" existent chez beaucoup d’espèces différentes. Ils sont d’ailleurs certainement mobilisés par d’autres sens que la vue. De nombreux animaux communiquent leurs sentiments par le biais de sons et d’odeurs autant que par leur comportement extérieur. » … « en l’absence de langue commune, les émotions sont peut-être le moyen le plus efficace pour établir une communication entre les espèces. » (Marc Bekoff)
En Conclusion, je dirais qu’ Anthropomorphisme et Empathie sont deux réalités qui existent et coexistent… et s’entremêlent parfois, en ce sens que l’une influencera l'expression de l’autre, sans qu’il soit toujours possible de percevoir une frontière nette entre les deux.
La difficulté additionnelle est que les événements neuronaux qui nous orientent initialement vers une réalité plutôt que vers l’autre, sont inconscients.
Le fait de savoir que les deux réalités existent peuvent nous aider à regarder les animaux d’un autre œil (je pense surtout aux mammifères sauvages, mais pas seulement)… et de considérer l’hypothèse empathique avec plus de sympathie et d’humilité.
JPCiron

:: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: : NOTES :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :
..... (1) Marc Bekoff –professeur de biologie à l’université du Colorado, spécialiste du comportement animal.
….. (2) Marc Bekoff « The Emotional Lives of Animals » – 2007 / Les émotions des animaux – 2009
….. (3) Ch. Darwin : “The Expression of Emotions in Man and Animals”
….. (4) Sandra Blakeslee : “Cells that Read Minds” - 2006
….. (5) Dott. Giacomo Rizzolatti, Université de Parma.
….. (6) Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie/ Leipzig / Deutschland.
….. (7) Joyce Poole : An Exploration of Commonality Between Ourselves and Elephant s » -1998
….. (8) Laurie Carr : “Neural Mechanisms of Empathy in Humans” - 2003
….. (9) Thomas R. Malthus :“An Essay on the Principle of Population”.
….. (10) Charles Darwin : “On the origin of Species by means of Natural Selection” - 1859
….. (11) William D. Hamilton : “The Evolution of Social Behaviour” (journal of Theoretical Biology 7” - 1964
….. (12) Robert Trivers : “Evolution of Reciprocal Altruism” - 1971
….. (13) Nigel Barber : “Kindness in a Cruel World – The Evolution of Altruism” - 2004
..... (14) Nigel Barber : “ La comparaison de deux sociétés de chasseurs-cueilleurs, les ACHE du Paraguay et les HADZA d’Afrique de l’EST, est frappante et illustrative : les ACHE distribuent la viande dans une stricte égalité : le chasseur chanceux donne la même quantité à chacun, y compris lui-même. Les HADZA partagent aussi la viande, mais la distribution est toujours tendue, contestée, avec tricheries de tous bords. »
..... (15) Jean Pierre Changeux : « L’Homme Neuronal » – 1983
….. (16) Charles Darwin : « The Descent of Man and Selection in Relation to Sex »
:: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :

12 réactions à cet article
Ajouter une réaction
Pour réagir, identifiez-vous avec votre login / mot de passe, en haut à droite de cette page
Si vous n'avez pas de login / mot de passe, vous devez vous inscrire ici.
FAIRE UN DON











