Alain Damasio est un auteur de science-fiction de grand talent auquel on doit notamment La Zone du Dehors, La Horde du Contrevent, ou encore Les Furtifs. Ses écrits mêlent un travail exceptionnel sur la forme avec un fond riche et convaincant fait de réflexions sur nos sociétés de contrôle, la marchandisation du monde, mais aussi sur l’amitié, la condition humaine et les dynamiques collectives, … Ses ouvrages sont déjà des classiques pour de nombreux lecteurs compte tenu de leur originalité et la de la richesse de leur contenu.
Son nouvel essai Vallée du silicium ne fait pas exception. Bien qu’il s’agisse d’un essai écrit suite à sa visite des lieux mythiques de la Big Tech en Californie, on retrouve bien sa plume acérée et envolée. On sent qu’il se laisse emporter par les mots, leurs sons, leurs allitérations, pour porter ses réflexions sur les IA, la Silicon Valley, les GAFAM et l’impact des nouvelles technologies sur nos vies et notre condition. Les mots ont été travaillés et retravaillé, si bien que ses effets de style sont fluides et servent les idées. Ce n’est pas juste pour le plaisir de faire de jolies phrases, mais une manière d’incarner le texte. On voit bien ici que ce n’est pas Chatgpt qui écrit, ni même un esprit formaté, « machinisé », qui parle, mais bien un humain de chair et de sang. Cette dimension est essentielle pour traiter du sujet des nouvelles technologies et de cette « décorporation » de nos existences…
Avant de me laisser moi aussi porter par les mots, une dernière précision sur ce recueil : une chronique sur deux, l’auteur fait le choix de la féminisation des pluriels neutres. C’est un choix militant auquel on s’habitue très vite… comme toujours, Damasio nous rappelle par l’exemple que le langage est chose vivante, et qu’à l’instar de la technique, il n’est jamais neutre :
- Il est vertigineux de se dire qu’entre une Kirghize et une Mélanésienne, à l’autre bout du globe, la première chose qui les relie, et qu’elles partagent basiquement, ce sont des outils numériques de type smartphone et des applis qui recalibrent de façon identique leur rapport au monde. Là est désormais le Commun. Ce qu’on pourrait appeler le numiversel.
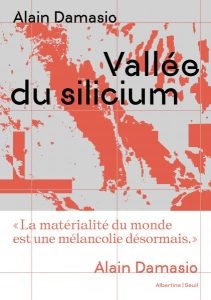
- La réalité augmentée nous dit : la réalité telle qu’elle se présente à nous à l’ordinaire est insuffisante, votre regard et votre écoute ne sont plus capables d’y nourrir une attention. L’ennui est votre destin précisément parce que le numérique vous a éduquées à être stimulées sans cesse et que hors de ces stimulations et des réactions qu’elles suscitent, hors du schème sensori-moteur qui vous tient, vous êtes devenues inaptes à agir par vous-mêmes, à contempler les choses, à observer le monde pour construire une émotion ou une réflexion. Vous devez être aidées et soutenues par une prothèse psychique, une technogreffe : un casque ouvert !
- Songez à ça quand vous prenez une course Uber – Uber partout, Uber en vous, Uber chez tous, Uber über alles. Vous alimentez un esclavage à la puissance deux.
Le premier esclavage est classique, il tient à l’économie même de la désintermédiation, qu’on a pompeusement rebaptisée la disruption alors qu’elle n’est qu’une corruption profonde du travail. Il consiste à extorquer honteusement une plus-value excessive sur le travail épuisant des chauffeurs : 30 % pour faire tourner une plateforme ? Ce n’est pas une commission, non, appelons les choses par leur nom : c’est du parasitisme et c’est du vol. Que les chauffeurs acceptent parce qu’ils n’ont guère le choix et aucun syndicat pour les défendre et amorcer, grâce à eux, le moindre rapport de force.
Le second esclavage est plus nouveau, plus subtil, plus horrible aussi. Il consiste à éduquer et à former malgré vous, en roulant, les machines qui vont voler votre emploi. Extorsion de niveau 2 : on ne vole plus simplement le produit de votre conduite, on vole votre façon de conduire, vos réflexes humains face à l’imprévu, vos cadences au volant, votre savoir-faire dans la circulation complexe. Pour vous éliminer à court terme. Et on vous les vole gratuitement.
- Poser la question en termes de sécurité est un tropisme de l’époque. Lequel tue tout débat au nid. Car la peur avale toute distance, toute pensée qui voudrait en oiseau s’envoler. Est-ce devenu si obscène de parler de liberté ? De pointer nos soumissions ? De suggérer que le cocon de paresse dans lequel le Capital fait ses œufs est à déchirer au courage et à la main ?
- La voiture autonome et connectée représente une tonne de métal et de plastique sur quatre roues capable de monter à cent cinquante kilomètres à l’heure. Doit-on écrire deux pages de science-fiction pour faire mesurer ce que ça permettra ? Faut-il être totalement niais pour ne pas imaginer une seconde ce que pirater un véhicule autonome peut engendrer ? À quel point y placer une bombe sous un siège pour guider ensuite la voiture vers une adresse ciblée sera facile ? Et même sans bombe, faut-il être Grand Prix de l’Imaginaire pour spéculer sur un taxi reprogrammé défonçant à cent à l’heure la vitrine d’un restaurant bondé, pénétrant dans un hôpital ou une cour d’école à la récré ?
On parle de sécurité routière sans envisager qu’on se dote d’une flotte de guerre qu’un hacker expérimenté – tiens, russe ou israélien, financé par son gouvernement, ou soutenu par un Daesh techno – saura très bien pirater et piloter.
- Baudrillard : « C’est un effet d’autoréférence éperdue, c’est un court-circuit qui branche immédiatement le même sur le même, et donc souligne en même temps son intensité en surface et son insignifiance en profondeur. »
« Sans ce branchement circulaire, sans ce réseau bref et instantané, qu’un cerveau, un objet, un événement, un discours créent en se branchant sur eux-mêmes (…) rien n’a de sens aujourd’hui. Le stade vidéo a remplacé le stade du miroir. C’est l’effet spécial de notre temps. »
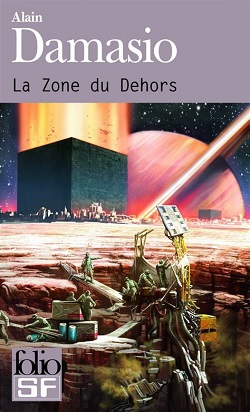
- Un jour, on comprendra peut-être qu’il n’existe pas de formule sociopolitique pour être tranquille d’avance. Une société qui espère cette sérénité se suicide comme société libre.
- « Le nombre de gens ici qui pensent seuls, qui chantent seuls, qui mangent et parlent seuls dans les rues est effarant. Pourtant ils ne s’additionnent pas. Au contraire, ils se soustraient les uns les autres, et leur ressemblance est incertaine », disait déjà Baudrillard en 1986.
- Sans doute touche-t-on là au cœur de ma technocritique : la Tech, ontologiquement, conjure l’altérité. Elle la repousse, la neutralise et la contrôle. Elle la métabolise pour en faire du même, elle réplique d’abord l’identique. Et quand l’altérité insiste, elle la fictionne.
- On ne le pointera jamais assez : les réseaux sociaux nous connectent, mais ils ne nous lient pas. Ils nous assemblent, certes, sans jamais obtenir de nous que nous soyons ensemble. Autour d’une rafle élégante, ils articulent les grains de raisin éparpillés que nous sommes devenus pour en faire des grappes suspendues, des communautés en ligne, des réseaux complices ou affins, oui. Mais ils nous unissent toujours en-tant-que-séparés. Ils nous unissent dans la distance physique. Ils nous espacent en nous mettant en contact. Ils objectent toute dimension charnelle ou corporelle, toute présence incarnée au profit des visios, des photos et des messages, bref d’un flux de datas qui contrefait le mouvement de l’échange.
- « Qu’est-ce que dessiner ? Comment y arrive-t-on ? » se demande Antonin Artaud, qui répond en ventriloque avec les mots de Van Gogh, s’adressant dans une lettre à son frère Théo : « C’est l’action de se frayer un passage à travers un mur de fer invisible, qui semble se trouver entre ce que l’on sent et ce que l’on peut. Comment doit-on traverser ce mur, car il ne sert de rien d’y frapper fort, on doit miner ce mur et le traverser à la lime, lentement et avec patience à mon sens. »
- À la fin de sa vie, Ivan Illich a eu ces mots sur l’informatique : « Cet ordinateur sur la table n’est pas un instrument. (…) Un marteau, je peux le prendre ou le laisser. Le prendre ne me transforme pas en marteau. Le marteau reste un instrument de la personne, pas du système. Dans un système, l’utilisateur (…), logiquement, c’est-à-dire en vertu de la logique du système, devient partie du système. »
- Pour Illich, un outil convivial devait répondre à trois exigences :
– il doit être générateur d’efficience sans dégrader l’autonomie personnelle. Il ne doit pas m’enlever ma capacité à faire les choses par moi-même ;
– il ne doit susciter ni esclave ni maître ;
– il doit élargir notre rayon d’action personnelle. Seul l’outil convivial s’avère « conducteur de sens, traducteur d’intentionnalité ».
Le souci est qu’Illich s’en tient (c’est aussi la marque d’une époque) à la dialectique du dominant et du dominé. Pour lui, « L’homme a besoin d’un outil avec lequel travailler, non d’un outillage qui travaille à sa place. Or il est manifeste aujourd’hui que c’est l’outil qui de l’homme fait son esclave ». Ou encore : « Conviviale est la société où l’homme contrôle l’outil. »
- Si le transhumanisme croit qu’il manque à l’homme quelque chose, quelque chose que seule la techno pourra lui apporter, j’ai la tranquille et furieuse conviction que l’être humain a en lui absolument tout ce dont il a besoin pour une vie pleine, intense et féconde. Tout est déjà en nous. Nous ne manquons que d’une chose : apprendre à aller au bout de ce qu’on peut – par nos propres facultés d’agir, de chercher, de sentir et de créer. Nous n’avons pas besoin de devenir plus-qu’humain : nous avons juste besoin de devenir plus humain. Vous en appelez au transhumain ? J’en appelle au très-humain. Ce qu’un Nietzsche bien compris appelait, lui, le surhumain.
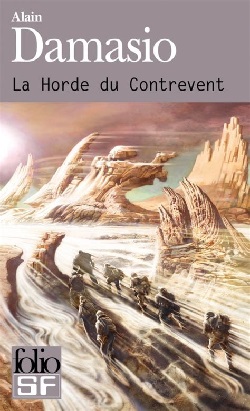
- À ces approches technocritiques, la Silicon Valley oppose souvent ce cliché qu’il convient de fusiller sans sommation et à bout portant. Il s’énonce ainsi : la technologie est neutre, son impact ne dépend au fond que du bon ou mauvais usage qu’on en fait.
C’est une idée courte, et même une idée stupide, quadruplement stupide. Il n’est jamais inutile de redire pourquoi :
1° Parce que la technique porte en elle une valeur latente : l’efficacité. Autrement formulé : la possibilité d’agir sur nos environnements de façon forte. (…) Plus profondément, la technique est une manière de dévoiler le réel comme ce qui doit être arraisonné, pointait déjà Heidegger, c’est-à-dire mis à la raison, mobilisé, exploité et mis en demeure de livrer une énergie qui puisse être extraite et accumulée. Ce qui, évidemment, n’a rien de neutre. D’autres rapports au réel étaient et demeurent possibles : la recherche d’harmonie, l’écoute, la contemplation, la symbiose…
2° Parce qu’en amont, l’innovation technologique dépend de la Recherche qui dépend elle-même des crédits de recherche ou du capital-risque investi, et donc déjà d’une forte présélection des découvertes, produits et services et qu’on juge a priori « utiles » à développer car lucratifs. La machine reste donc toujours « sociale avant d’être technique » (Deleuze), c’est-à-dire qu’elle présuppose en univers capitaliste, pour être finalement fabriquée, une attente du marché et une rentabilité. Des millions d’innovations qui amélioreraient notre condition commune ne passeront jamais le seuil de la fabrication. Aucune neutralité donc, dans la possibilité même d’exister. (…)
3° Parce qu’en aval, une technologie induit une multitude d’effets, souvent difficiles à anticiper : elle réinvente des pratiques et reformate des comportements, elle enfante parfois une culture entière (le jeu massivement multijoueur, les danses internet, les animatiques) juste par les interactions nouvelles qu’elle offre. S’en servir, c’est déjà transformer ses rapports à soi et ses relations aux autres, se ménager de nouvelles prises et consentir à de futures emprises en mutilant d’anciennes capacités qu’on sous-traite à l’appli. (…)
4° Enfin parce que toute technologie porte en elle un nouveau rapport au monde. On croit utiliser un frigo quand c’est notre façon de nous nourrir qui est révolutionnée par le stockage des aliments frais. La machine situe notre liberté et notre liberté s’exerce face à elle, en elle. Nous sommes libres de nos usages de la machine, libres même de ne pas l’utiliser, parfois. Mais c’est une liberté en situation, déjà située, un libre-arbitre qui s’exerce à l’intérieur d’un monde transformé et repotentialisé par la machine où il devient impossible de se comporter comme si elle n’existait pas. La voiture a littéralement « inventé » les routes, les parkings et les trottoirs, elle a appelé l’extraction du pétrole et intégralement refondé l’aménagement du territoire. (…)
À cette quadruple aune, croire encore en la neutralité des technologies qu’on nous propose n’est même plus de la naïveté. C’est une faute politique.
- Superintelligence ou Singularité, « mort de la mort » ou peuplement de Mars, peu importent l’énormité et le ridicule des prédictions, leur vocation n’est pas d’être réalistes. Elle est d’imposer des imaginaires dominants et d’ancrer des hyperstitions. Les Silicon leaders sont des mythocrates. Il s’agit d’assurer la convergence synchrone des attentions et de polariser le champ magnétique des pulsions, en suspension dans le réseau, autour de désirs universels : ne plus vieillir, ne plus mourir, conquérir l’espace, etc. Et d’emporter ainsi la croyance et l’adhésion par contagion affective à grande échelle. La politique populiste y a vite trouvé son vecteur idéal, d’où sa manipulation boulimique des réseaux.
- Dans nos existences urbaines où une grande part de notre rapport au réel est médiée par l’écran, où la consommation culturelle des récits, des séries et des jeux sature un vécu terne, le champ de l’imaginaire n’a plus rien de secondaire. C’est un champ de bataille en soi dans la mesure où il influence nos comportements bien plus efficacement que les anciens cadres disciplinants. L’école éduque aujourd’hui moins nos enfants, j’en suis persuadé, qu’ils ne se construisent à travers les modèles de la technoculture.
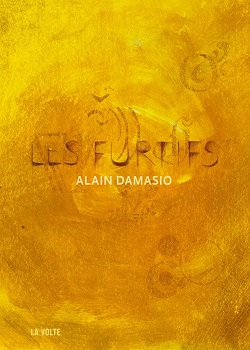
- Car l’enjeu, tout aussi bien, est de battre le technocapitalisme sur le terrain de la promesse (cette autre forme de l’espoir). Soyons lucides : que nous promet donc l’IA et son mythe ricain de la Singularité, sinon une destitution, au moins un appauvrissement de notre propre faculté à utiliser le langage ? De quoi nous fait-il rêver, sinon d’une triste sous-traitance à la silice de notre aptitude à dessiner par nous-mêmes ? Que nous promet, à l’inverse, une alliance renouvelée avec la forêt, l’océan, les champignons qu’on va aller cueillir et la rivière où l’on se baigne ? Avec les chamois qu’on surprend en passant la crête et l’empire inouï de ce qui pousse quand on en prend soin ? Sinon ce bonheur exigeant d’accorder nos attentions croisées à tout ce qui vit, dans un entrelacs de prédations et d’amour, et d’en être émerveillés, et bousculés, et nourris, de retrouver dans ces vifs des algues, des fouines ou des mousses, qui font frissonner les nôtres, ce qui nous constitue tous : une vitalité transversale que tout être sait déployer à sa manière. Manger le soleil comme un arbre, croire aux fauves, plonger en pleine mer et habiter en oiseau.
Cette promesse du biopunk, n’est-elle pas tout simplement plus exaltante qu’un énième couplage psychique avec des machines qui ne font que reproduire ce que nous disons ou chantons déjà, ce que nous calculons, en plus mal, ou ce que nous avons dorénavant « la flemme » d’assumer ?
- Le philosophe Yves Citton l’a finement exprimé : « Peu importe leur degré de fiction : les valeurs affirmées par les récits agissent sur nous par induction ou comme des prompteurs (sic), elles activent des idéaux ou des modèles qui nous incitent à faire quelque chose, à rire, à pleurer, croire, élire, acheter… Quand lire, c’est faire… » (…)
« C’est ce pouvoir de scénarisation, tel qu’il s’exerce au Journal de 20 heures ou dans la publicité, mais aussi dans nos conversations quotidiennes, qui décide du résultat des élections, des emballements boursiers, des montées du racisme, des contagions d’indignation ou de l’invention collective d’autres mondes possibles. »
- Pour le dire en rime, nos imaginaires modernes affrontent des imachinaires. Ils s’inscrivent dans un monde déjà machiné où l’on se fascine encore une fois moins pour l’intelligence animale, assez prodigieuse et même optimale dans sa niche écologique, que pour celle d’une machine à discuter, sans conscience aucune, qu’on pré-entraîne avec des téraoctets de messages triviaux à produire une simulation de dialogue. Notre art doit précisément servir à ça : décaler la sensibilité vers ce qui mérite d’être aperçu, vers ce qui appelle l’expérimentation.
Si la mythopoïèse est l’avenir du politique, comme je le crois, elle l’est parce que seul le mythe a cette faculté de fusionner affects, percepts et concepts dans une seule boule d’énergie, dans un seul soleil de la taille d’un poing où toutes nos mains se fondent. Si le peuple ne préexiste jamais, comme le disait Deleuze, c’est parce qu’il est à créer – par et sous ce soleil du mythe qui frappe le Capital au plexus.
Source : https://unmultiple.wordpress.com/2024/05/17/alain-damasio-vallee-du-silicium/











