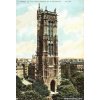La crise du Grand Jeu de Marc Thivolet
Les éditions Arma Artis publient La crise du Grand Jeu de Marc Thivolet.
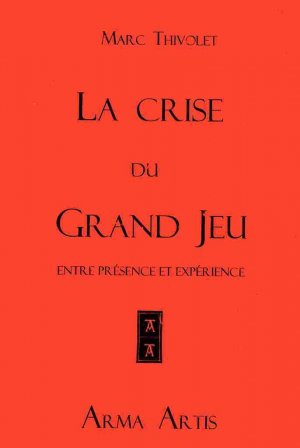
Le groupe dit du Grand Jeu s’est construit autour de René Daumal et Roger Gilbert-Lecomte, condisciples au lycée de Reims. Ce mouvement, car il s’agit bien d’un mouvement, dont l’énergie s’est épuisée dans la dynamique de la spirale, a eu une assez brève durée de vie : 1924-1934 (la revue Le Grand Jeu n’ayant connu que trois numéros, de 1928 à 1932). Né durant les années « incendiaires » du surréalisme, ce groupe, constitué de jeunes gens (Maurice Henry, Pierre Minet, Luc Dietrish, André Delons, Roger Vailland, Roland de Renéville, le peintre Josef Sima... et en lisière, Carlo Suares) s’est distingué par une implication absolue dans la recherche des états modifiés de la conscience. Ces investigations donneront naissance à un texte marquant, signé René Daumal : L’expérience fondamentale. Dans ce texte, René Daumal relate son expérience pour parvenir au point limite de la vie et de la mort. Pour ce faire, il inhale du tétrachlorure de carbone utilisé pour tuer les insectes. Par la suite, Daumal rejoindra les groupes Gurdjieff. De son côté, Roger Gilbert-Lecomte, davantage poète inspiré que théoricien, se laissera « déporter » vers les drogues. Il écrira sur ce sujet M. Morphée empoisonneur public, qui traite du rôle de la drogue, et des interdits moraux et sociaux qui veulent en régenter l’usage. « L’ horrible révélation la seule » sera l’un de ses autres textes, où la vision de notre civilisation se heurte au récif de l’innommable...
Dans son essai, Marc Thivolet (légataire testamentaire de l’œuvre de Carlo Suares et qui a, entre autres, dirigé le Cahier de l’Herne Le Grand Jeu de 1968), s’écarte des sempiternels ratiocinages de la fameuse réunion de la rue du Château (qui mit un terme à un rapprochement entre le surréalisme et le Grand Jeu) pour nous faire pénétrer dans les zones d’ombre de ce mouvement. L’auteur nous invite à en explorer les ramifications les plus subtiles. Les questions soulevées par Marc Thivolet interrogent aussi le lecteur sur la portée réelle de sa présence au monde. Son propos principal n’est pas d’apporter des réponses ayant un caractère définitif - échappant ainsi au piège du psychologisme qui ne saurait éclairer suffisamment la portée de cette aventure extrême. Comme il le souligne lui-même dans son texte d’ouverture : « Il importait d’épuiser ce que le Grand Jeu avait de déterminé et qui faisait obstacle à lui-même dans le ressassement de ses figures. Le Grand Jeu, en tant que mouvement constitué, était une hypothèque prise sur le Grand Jeu - hypothèque qu’il importait de lever en tentant d’identifier les figures qui le hantaient. Il fallait rendre le Grand Jeu à son inexpérience fondamentale. »
Comment exprimer des vérités lorsque Daumal et Gilbert-Lecomte se sont impliqués en totalité dans cette expérience, jusqu’au péril de leur, vie afin de toucher une hypothétique Vérité, une et essentielle ? René Daumal et Roger Gilbert-Lecomte (morts tous les deux à 36 ans), les deux faces d’une même médaille de feu que Marc Thivolet explore avec la distance et la prudence propres à tout auteur sincère, et sincèrement impliqué.
Un livre à lire et à méditer...
2 réactions à cet article
Ajouter une réaction
Pour réagir, identifiez-vous avec votre login / mot de passe, en haut à droite de cette page
Si vous n'avez pas de login / mot de passe, vous devez vous inscrire ici.
FAIRE UN DON