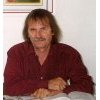1934 - 1940 - 1958 : trois avatars d’un même coup d’État
Comme nous l’avons vu : dès 1934, le schéma de la Constitution de 1958 était au point, pour l’essentiel. Il restait à le mettre en œuvre. C’est-à-dire à bouleverser le système institutionnel en fonctionnement depuis 1875 : la Troisième République.
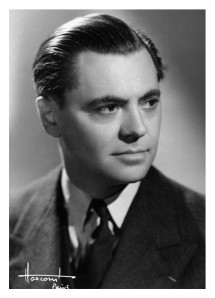
André Tardieu en était venu à la conclusion que ce basculement ne pourrait venir en aucun cas de l’intérieur même : il aurait fallu que le Parlement - Chambre des députés et Sénat - mette directement la main à son propre avilissement.
Jacques Bardoux - dont il faut redire qu’il était le grand-père du petit Valéry Giscard d’Estaing qui avait alors huit ans - partageait cet avis, tout en souhaitant voir André Tardieu se porter à la tête des partisans du coup de force. En vain, comme je l’ai déjà dit.
Lorsque surviennent les événements du 6 février 1934, qui menacent très directement la Chambre des députés, les personnages capables d’introduire l’alternative constitutionnelle sont donc absents.
Mais il vaut de signaler immédiatement la présence de quatre protagonistes principaux de l’Histoire de France des années suivantes. Du côté des émeutiers, nous découvrons un certain Pierre Bénouville ainsi que le colonel Georges Groussard. Dans les couloirs de la Chambre et dans la salle des séances, nous apercevons, tour à tour, Jean Moulin et le ministre de l’Air, Pierre Cot.
Il vaut aussi la peine de signaler que, dans ses années-là, au ministère de la Guerre, le colonel Groussard faisait face, par-delà un large bureau, au lieutenant-colonel de Gaulle, occupé, par ailleurs, à mettre au point l’ouvrage qu’il publierait en cette même année 1934 : Vers l’armée de métier.
Ces deux-là avaient déjà une réputation sulfureuse, ainsi que je l’ai montré dans Quand le capital se joue du travail - Chronique d’un désastre permanent (Éditions Paroles Vives, 2012), tellement sulfureuse que Léon Blum en évoquera le spectre le 15 mars 1935 à la Chambre des députés :
« Au moment où la France commence à se dégager du danger fasciste, on a voulu lui imposer la direction militariste. Car, c’est cela, très exactement, le militarisme. C’est sa définition même. Le militarisme est une action indépendante du commandement militaire agissant en tant que corps distinct, s’efforçant d’agir directement sur l’opinion, sur la presse, sur le Parlement et essayant d’imposer ses vues à la politique gouvernementale elle-même. »
Il précisait ensuite :
« Oui, sous l’influence de quelques esprits ingénieux, hardis, brillants, attirés par l’exemple de la Reichswehr allemande, on commence dans les cercles de la haute armée, dans les journaux publiquement inféodés à l’état-major, comme l’Écho de Paris, tout le monde le sait, et dans l’opinion elle-même, à lancer cette idée de l’armée de métier, pour la constitution de laquelle on réserve très probablement ces engagements et rengagements en faveur desquels on a montré jusqu’ici si peu de zèle, l’armée « de choc et de vitesse », comme dit, je crois, M. de Gaulle, toujours prête pour les expéditions offensives et pour les coups de main, l’armée motorisée et blindée qui, si nous l’adoptions, rouvrirait simplement entre le blindage et le canon d’infanterie un duel analogue à celui auquel nous avons assisté entre la cuirasse et le canon d’artillerie. »
Le coup d’État allait-il venir des ambitieux colonels ?
En tout cas, le 6 février, aucun chef n’était apparu. Ce fascisme-là n’avait pas encore trouvé son Mussolini, et pourtant la situation avait été très chaude…
Dans une lettre qu’il adresse dès le 12 févier 1934 à ses parents, Jean Moulin écrivait :
« Je suis resté 2 heures de 6 à 8 h, sur le pont de la Concorde et j’ai pu voir avec quelle sauvagerie les "Croix de Feu" et les Camelots du Roi chargeaient les gardiens de l’ordre désarmés. C’est par dizaines qu’on emportait les blessés dans les rangs des gardes mobiles et les gardiens de la paix. Les gardes républicains à cheval étaient désarçonnés par les émeutiers qui tranchaient les jarrets des chevaux avec des lames de rasoir. J’ai vu aussi que les premiers coups de feu sont partis des émeutiers. » (Cité dans Michel J. Cuny - Françoise Petitdemange, "Fallait-il laisser mourir Jean Moulin ?", pages 51-52)
Mais, en la circonstance, Jean Moulin n’était pas simplement un vague témoin. Il était le chef de cabinet du ministre de l’Air en exercice, son ami Pierre Cot, à qui l’acharnement qu’il mettrait à défendre la République ce jour-là et en d’autres circonstances vaudrait d’être bientôt qualifié de "galopin sanglant" par l’extrême droite. Pour sa part, Jean Moulin en dit ceci à ses parents :
« Chez lui, toutes les 10 minutes, on l’appelait au téléphone pour lui lancer des menaces de mort. » (page 52)
Laissons maintenant la parole au camp d’en face, et plus particulièrement à ce Pierre Bénouville devenu plus tard - et dans le cadre de ce qui pourrait n’être qu’une opérette - le général Pierre Guillain de Bénouville, membre éminent des Compagnons de la Libération d’un De Gaulle. Il s’exprime ainsi :
« Moi, j'étais pour que ce coup d'Etat réussisse, je n'étais pas le seul, mais de cet échec dans l'Action Française est venue une autre révolte, plus profonde, et qui a été la Cagoule ! »
Or, c’est bien la Cagoule qui, à travers Pierre Bénouville et le colonel Groussard, a eu la vie de Jean Moulin en 1943, et sous l’autorité de qui ?... C’est une autre histoire (je ne puis que recommander la lecture du livre Fallait-il laisser mourir Jean Moulin ?), et c’est pourtant exactement la même.
En tout cas, au lendemain du 6 février 1934, voilà qu’arrivait le gouvernement de Gaston Doumergue, avec, parmi les ministres… Pétain et Laval. C’est-à-dire une préfiguration évidente de 1940 !... Et pourquoi pas, de 1958 ?...
13 réactions à cet article
Ajouter une réaction
Pour réagir, identifiez-vous avec votre login / mot de passe, en haut à droite de cette page
Si vous n'avez pas de login / mot de passe, vous devez vous inscrire ici.
FAIRE UN DON