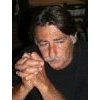A propos de l’eau

Revenant d’une mission au Tchad, où j’avais fait le tour d’une série d'ONG, j’avais dans mes bagages un projet d’irrigation qui résoudrait à jamais aussi bien la préservation d’espaces cultivés que, à travers des mécanismes de filtrages rudimentaires, celui de l’eau potable pour un bourg de trois mille habitants. Le projet, ingénieux et s’appuyant sur une technologie ancestrale utilisait le sable comme filtre et avait l’avantage d’être économe : avec 20.000 euros et un travail volontaire des villageois eux-mêmes, l’eau se retrouvait partout, les quartiers (17 points de distribution) et les champs cultivés.
De retour à Bruxelles je le proposais aux services responsables et fus très étonné de remarquer le peu d’empressement de la part des fonctionnaires pour le faire avancer. « Reviens avec un projet d’un million, et là on s’y intéressera » m’a-t-on fait comprendre. « On ne va pas passer trois mois pour faire une étude de faisabilité et de mise en place pour vingt mille euros ». J’étais outré. Durant certains voyages au Malawi en Zambie et en Tanzanie j’avais visité une bonne dizaine d’ONG locales ou européennes qui dépensaient des millions à ne rien faire (une d’elle sous louait des bureaux flambant neufs gracieusement offerts par les donateurs scandinaves), et, payé pour évaluer leurs performances, j’avais conclu dans mon rapport entre autres : « un projet pérenne et efficace est un projet humble, utilisant des moyens locaux, et ne dépendant pas sur le long terme à la perpétuation des subventions ». Inutile de dire que on trouva mes évaluations excellentes, réalistes et innovantes. Oui, en théorie c’est bien ce qu’il faut faire. Mais en pratique ? La bureaucratie doit trouver une justification à son propre existence, dépenser des millions (sinon ils ne seront pas renouvelés), construire routes, machineries et bâtiments à sa gloire et qui seront vite décrépits faute d’entretient (mais qui s’en souviendra ?). Au Mozambique, un projet mixte de la Commission et de certains pays membres se donnait comme objectif de mettre en place un système de micro - finance. Résultat ? Pour distribuer cent mille dollars par an, se mit en place une infrastructure (locaux, voitures, administration, ingénierie, ordinateurs) coûtant plus d’un million d’euros annuels…
Pour revenir au projet d’irrigation, il est terminé, fonctionne à merveille, une dizaine d’individus (dont, ironiquement, certains fonctionnaires de l’UE), ayant financé le projet à titre individuel.
Que ce soit un village au Tchad, une route afghane, un port malgache ou des cultures de substitution en Birmanie, personne ne semble se poser la question de l’efficacité, de la relation entre les objectifs et les résultats.
Au moment où un pays entier sombre dans le chaos victime des mesures prises par ses sauveurs, au moment ou des milliards de milliards sont dépensés pour sauver les banques victimes de leur gloutonnerie, il serait bon de rappeler que l’essentiel c’est de répondre aux humbles demandes des intéressés, plutôt qu’à vouloir les intégrer dans une uniformisation destructrice, à une seule vision du monde, celle où l’argent se suffit à lui-même comme seule réponse.
40 réactions à cet article
Ajouter une réaction
Pour réagir, identifiez-vous avec votre login / mot de passe, en haut à droite de cette page
Si vous n'avez pas de login / mot de passe, vous devez vous inscrire ici.
FAIRE UN DON