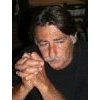Adieu Bretton Woods, bonjour l’enfer

L’empire du soleil levant qui a été depuis l’après guerre jusqu’à (presque) nos jours le modèle à imiter se retrouve avec une dette de 250% de son PIB. Le Financial Times n’hésite pas à « penser » que la prochaine Grèce se situe « à l’empire couchant ». Tandis que le Wall Street Journal titre le premier mars : « les marchés se comporteront au Japon comme en Grèce ? » Et pour cause : s’adressant à l’épargne essentiellement domestique, le Japon a échappé aux Funds mais le prix à payer est faramineux. Le marché interne - empruntant pour prêter à l’Etat à des taux intéressants (obligations) -, a collectivement (Etat - Privé) augmenté la dette de ce pays à des niveaux désormais ingérables. En conséquence, la paix sociale basée sur le consensus est en train d’éclater en morceaux nul ne doute que le système japonais a trouvé ses limites et que l’austérité programmée exigera la fin de ce consensus. D’après Kenneth Rogoff « la logique qui voudrait que les Etats rembourseront au fur et à mesure qu’ils se développent appartient désormais au passé ». Plus rien, « aucune activité, industrielle ou financière ne peut combler de tels déficits ». Dans son livre « This Time is different : Eight centuries of Financial folly », le professeur de Harvard ne parle pas « que » du Japon. Pour lui, à plus de 60% d’une dette combinée publique - privée, la croissance chute de 2%, tandis que les crises financières augmentent la dette publique - en quelques mois - de 75% en moyenne. En d’autres termes, pour être simple, l’ensemble des « pays industrialisés » fleurèteront constamment avec une croissance négative au mieux, ou sombreront, au pire, dans la récession. Steny Hamilton Hohier de la chambre des représentants et proche d’Obama n’a pas hésité de faire le parallèle des deux tours jumelles qui s’effondrent celle de la dette (plus de 12 trillions) et celle du déficit US (plus d’un trillion et demi). Elle propose une « union sacrée du monde politique et la fin des querelles politiques » sous peine d’effondrement total. « Ce qui arrive à la Grèce peut, va arriver chez nous », dit-elle. Nous y sommes : l’urgence exige la fin du politique et des débats contradictoires. Mais pour faire quoi ? Changer l’économie ou changer la politique ? Pour la première fois, l’année dernière, les entrées fiscales ont été moins importantes que les obligations et autres emprunts qui désormais se multiplient pour combler les trous noirs et préserver la paix sociale en Grande Bretagne, en France, en Espagne, au Portugal, ou, cas extrême, en Irlande (1200 % du PIB !). Pourquoi laissons nous les banques revenir (à des niveaux de plus en plus élevés) à des politiques financières de plus en plus « risquées » ? Pourquoi le minimum de fonds propres exigé lors du dernier G8 ne peut pas se mettre en place ? Pourquoi les succursales des paradis fiscaux sont toujours là et les bonus des traders ne font qu’augmenter ? Pourquoi les banques ne jouent pas le jeu d’un crédit raisonnablement bon marché ? Par ce que, tout simplement, les Etats qui leur ont prêté des trillions, qui ont donné à leurs industries phares des milliards (automobile par exemple), sont à bout de souffle. Et ne peuvent plus rien exiger, dépendants qu’ils sont du crédit. Crédit possible par ce que les banques continuent à spéculer et à prendre des risques de plus en plus grands. De leur côté, et pour cause de manque de crédit (mais pas seulement comme indiqué ci dessus) les rythmes de croissance stagnent tout comme les entrées fiscales. Enfin, l’artifice des privatisations comme moyen de renflouement a porté un coup supplémentaire aux capacités des Etats de jouer un rôle productif et industriel dominant même dans les secteurs stratégiques et infrastructurels qui sont pourtant essentiels concernant l’appel des capitaux. Ainsi, les Etats, après avoir organisé leur propre effacement au profit du marché doivent accepter les propositions de la finance qui s’exprime très clairement : The Economist sermonne de nouveau ; Il propose l’augmentation de l’âge de la retraite jusqu’à 70 ans, la limitation des dépenses sociales, la plus grande flexibilité possible, encore moins d’Etat. Toutes ces mesures (aux quels nous sommes habitués depuis vingt ans et auxquelles on croyait il y a un an que la défaillance financière allait mettre un frein) ne sont pas présentées comme des médicaments miracles pour des lendemains qui chantent. En effet The Economist prévient : ces mesures de rigueur amèneront de l’instabilité sociale, la cohésion sociale sera sérieusement perturbée, la carrière des hommes politiques dépendra du sort des obligations (sic). Seuls les « régimes forts » sortiront leur épingle du jeu. La Chine par exemple ?
Ne voulant pas sacrifier les banques et un modèle financier à la dérive, c’est donc la démocratie que l’on vise ? Ou plutôt ce qu’il en reste. Pour la doxa d’un marché qui a largement fait ses preuves d’incompétence et de gloutonnerie.
8 réactions à cet article
Ajouter une réaction
Pour réagir, identifiez-vous avec votre login / mot de passe, en haut à droite de cette page
Si vous n'avez pas de login / mot de passe, vous devez vous inscrire ici.
FAIRE UN DON