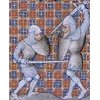Campagne présidentielle, élites mal aimées et chanson de la balance
Après les voeux du Nouvel an de Jacques Chirac, les spéculations sur son éventuelle candidature aux présidentielles de 2007 interfèrent avec la candidature de Nicolas Sarkozy, réputée majoritaire au sein de l’UMP, pendant que Ségolène Royal promet un référendum institutionnel et Francois Bayrou réclame à nouveau un changement de constitution. Les citoyens sont-ils vraiment intéressés par ce débat ? Malgré le forcing médiatique des derniers mois, il n’est pas certain que la popularité des principaux candidats soit très grande. Les Français ont voté contre le Traité constitutionnel européen, qui était soutenu par une large majorité du monde politique. Et quelle est la valeur réelle de l’être humain dans la société que ce même monde politique a façonnée ? Lorsque, au début du XXIe siècle, le droit au logement n’est pas garanti et que des SDF meurent de froid, on peut se demander si nous sommes plus prisés que des marchandises que l’on vend au poids.
D’après le journal britannique The Independent du 6 janvier, Jacques Chirac serait prêt à se présenter aux présidentielles afin de "sauver la France" de Ségolène Royal. Au même moment, Marianne formule dans un article du 6 janvier ses propositions pour une vraie rupture, avec l’avertissement : Qui que ce soit qui s’installe à l’Elysée en mai prochain (...), il n’y aura ni rupture, ni révolution, ni changement radical du système qui produit les pires injustices, inégalités, insécurités ou aberrations, système que massivement, pourtant, les électeurs rejettent. La raison en est, pour la rédaction de Marianne, non pas une mauvaise volonté ou une incompétence des candidats, mais la puissance destructrice et la brutalité régressive du bulldozer néolibéral (...) à l’échelle planétaire. Pour lui faire face, l’article réclame notamment que les clivages partisans obsolètes soient dépassés. Un mot d’ordre qu’on a beaucoup entendu ces derniers temps (mon article du 31 août), dans la logique : "Les temps sont durs et on n’y peut pas grand-chose". Tacitement, toute la classe politique demande aux Français d’être prêts à consentir des « sacrifices » pour « sauver la France ». On appelle à des formes à peine diverses d’union nationale et, comme Marianne, à ce que les citoyens (...) se sentent partie prenante, (...) se mobilisent, etc., autour de cette même classe politique qui nous gouverne, nous « gère » et nous « administre » depuis une trentaine d’années.
On voit réapparaître, dans ce type de discours, le spectre d’un prétendu neolibéralisme sauvage. Pourtant, Marianne propose, pour s’y opposer, de revenir aux fondements du libéralisme, notamment contre les situations de monopole, les abus de positions dominante... L’hebdomadaire admet donc implicitement, malgré l’emploi du mot néolibéral : a) que l’actuel fonctionnement de l’économie est parfaitement étranger à ce que fut le libéralisme à l’époque où il existait vraiment en tant que doctrine et en tant que courant économique b) que l’actuel système économique se caractérise par une domination sans précédent de la grande finance et des multinationales à l’échelle mondiale. Deux points soulignés dans mon article du 28 décembre. Mais les solutions proposées par Marianne sont-elles vraiment nouvelles par rapport aux déclarations politiques habituelles ? Tous les gouvernements disent défendre la « liberté d’entreprendre », mais dans la pratique, ils agissent depuis vingt ans dans le sens d’une « réduction des charges sociales », d’un développement de la précarité, d’un soutien sans faille à la concentration des géants financiers et industriels, d’une politique de privatisations et de délocalisations des capitaux de plus en plus accélérée... qui renforcent sans cesse le pouvoir de la grande finance internationale.
Et de quelle « participation citoyenne » nous parle maintenant une classe dirigeante, politique, gestionnaire, qui depuis les années 1970 ne cesse de se doter de toutes sortes de moyens institutionnels et législatifs lui permettant d’avoir raison à tout prix contre le « petit citoyen » ? Une « élite » qui a opéré un incroyable mélange de genres entre les coupoles politique, administrative, industrielle et financière, judiciaire... Qui pratique de plus en plus ouvertement le « mais bien sûr » pour quelques-uns, alors que la grande majorité des Français se voit opposer le passage en force et le langage raide du genre : « C’est comme ça, et il va falloir vous y plier, et d’ailleurs le Conseil (X), le rapport (Y) et telle instance nous donnent raison. Adressez-vous à qui vous voudrez, nous aurons toujours raison. » Après plus de vingt ans de « gestion des Français » par la politique unique, par les réseaux de la pensée unique et par la prétendue « évidence » fabriquée avec l’aide des idéologues attitrés du système, ce sont les mêmes qui, pour les élections de 2007, nous assènent un énorme tapage médiatique à base de « rupture », de « participation », etc. Où veulent-ils en venir ?
Je ne crois pas aux sondages, ne m’y prête jamais. Mais il semblerait que les « élites » aient mal pris un "Top 50" diffusé par le Journal du Dimanche du 31 décembre, où Zinedine Zidane et Yannick Noah figurent en tête du classement et où les vedettes politiques se retrouvent à des places que certains ont l’air de juger injustes : Ségolène Royal à 23e place, Simone Veil à la 25e, Bernard Kouchner à la 40e, Nicolas Sarkozy à la 42e, alors que le possible candidat aux présidentielles Nicolas Hulot figure en troisième position. Il s’agit d’un sondage où les interviewés ont eu à choisir, parmi celles qu’ils connaissent, les dix personnalités qui comptent le plus pour eux ou qu’ils aiment le mieux. Après un tel résultat, on crie, semble-t-il, au danger du populisme... Sauf que, lors de la dernière Coupe du monde de football, toute la classe politique a participé à la grande mise en scène (voir, pour rappel, mon article du 10 juillet), et ce n’est qu’un exemple de l’instrumentalisation permanente de ce type de célébrités par les milieux dirigeants. Faut-il chercher ailleurs la raison du classement de Zidane et d’autres sportifs, chanteurs... ? Le monde des décideurs français a d’ailleurs la solide réputation de fonctionner par copinage, dont témoigne par exemple l’article du 25 juin, de Ross Tieman, publié par The Observer à propos d’Airbus et EADS. Pourtant, le spectre du populisme semble hanter "nos élites".
Cela fait une bonne vingtaine d’années que les intellectuels préférés des cercles de décideurs, soutenus par les maisons d’édition et les médias audiovisuels, mènent campagne contre le populisme. Faut-il en conclure que ça ne prend pas ? Et qu’est-ce que le populisme, un terme auquel on cherche à assimiler tout et son contraire ? A lire certains penseurs, ce serait une propagande irrationnelle et démagogique cherchant à ameuter les foules. Des idées proches sont répandues dans des sites théoriquement citoyens. On peut lire à ce jour sur Wikipédia la définition suivante du populisme : Un courant politique favorable aux classes défavorisées, et souvent hostile aux élites, suivie d’un article consacré au populisme politique où il est écrit notamment : Le populisme (...) suppose l’existence d’une démocratie représentative à laquelle il s’oppose (...) [Il] dit que l’élite ou des petits groupes d’intérêt particulier de la société trahissent les intérêts de la plus grande partie de la population, et qu’il y aurait donc lieu de retirer l’appareil d’État des mains de cette élite égoïste voire criminelle pour le mettre au service du peuple tout entier. Afin de remédier à cette situation, le leader populiste propose des solutions simplistes, ignorant les réalités de la décision politique... On passe très vite de la notion de défense des classes défavorisées à des références pouvant être apparentées à ce que l’on appelle les "dictatures".
Mais déjà en 1996, Serge Halimi dénonçait dans Le Monde diplomatique l’usage démagogique du mot populisme : Lorsqu’un mouvement né il y a un peu plus d’un siècle aux Etats-Unis, à la fois progressiste, de tradition rurale et structuré par un programme de transformation économique ambitieux et précis, se métamorphose en une épithète informe apposée au tout-venant (le Ku Klux Klan et M. Ross Perot, Arletty et Bruce Springsteen, les généraux Peron et Boulanger, Tolstoï et Frantz Fanon, l’historien humaniste Jules Michelet et M. Jean-Marie Le Pen...), chacun devrait avoir compris la fonction idéologique de l’amalgame : dissimuler les vrais rapports de pouvoir en fabriquant une catégorie qui fait diversion, substituer l’étude d’analogies de style à l’analyse des clientèles sociales et des programmes. Ici comme souvent, le consensus se nourrit du relâchement intellectuel et de l’inculture historique. C’est ainsi que, tel un virus, l’adjectif populiste contamine le journalisme et l’analyse sociale ... Car les campagnes prétendument "antipopulistes" semblent refléter la crainte d’une véritable révolte populaire devant l’évidence, qu’attestent deux décennies de régression sociale, qu’il n’est aucunement prévu de changer de politique, quoi qu’on nous en dise.
Et la manière dont politiques, décideurs et gestionnaires traitent les Français s’est-elle améliorée ces derniers temps ? En rapport avec le fiasco des projets de réforme de la Justice après Outreau, on peut relever cette phrase de Pascal Clément lors du débat parlementaire du 19 décembre : En 2005, sur plus de 30 000 informations ouvertes à l’instruction, presque 10 000 faisaient suite à une plainte avec constitution de partie civile, dont plus de 9000 se sont terminées par un non-lieu, une irrecevabilité ou un refus d’informer ! Des non-lieux terminent, même si l’on ne dispose pas de pourcentages précis, l’écrasante majorité des plaintes avec constitution de partie civile - sans doute 80 % en 2004 à Paris, en matière économique et financière ! On voit bien les abus qui ont cours. Pascal Clément prend pour base de son intervention, destinée à justifier de nouvelles limitations des possibilités de plainte avec constitution de partie civile, des données émanant de la magistrature et qui reflètent le fonctionnement actuel d’une Justice qu’il s’agissait précisément de réformer. La véritable raison invoquée pour ces nouvelles dispositions est l’encombrement des cabinets d’instruction. A aucun moment l’avis des citoyens n’a été demandé, alors que leurs actions en Justice sont d’emblée déclarées abusives dans un débat sur des propositions introduites avec très peu de publicité et adoptées sans aucune voix contre.
Quant aux prisons, la situation a-t-elle vraiment évolué après le rapport très critique du Commissaire européen Alvaro Gil-Robles ? D’après le Nouvel Observateur, l’avocat du détenu qui revendique un acte de cannibalisme présumé commis le 3 janvier à la prison de Rouen a mis en cause l’administration pénitentiaire, reprochant à la maison d’arrêt d’avoir refusé le placement en isolement de son client qui purgeait une peine de cinq ans pour viol avec violence, souffrait de schizophrénie et était "potentiellement dangereux".
Et les délocalisations, la prolétarisation de la grande majorité de la population, la misère croissante, la situation des SDF... Que penser d’un projet de loi qui, juste avant les présidentielles, instituerait un droit au logement opposable et qui suscite déjà le scepticisme ? Et pourquoi y a-t-il des SDF dans la France de 2007 ? Sans doute, les Français reprochent-ils aux "élites" une réelle perte de considération de l’être humain au cours des deux dernières décennies.
On trouve sur la Toile une chanson catalane des années 1960, la Cançó de les Balances (Chanson de la balance), composée par Josep-Maria Carandell et chantée par Ovidi Montllor. Elle raconte l’histoire d’un royaume de jadis où :
Doncs era un rei que tenia
el castell a la muntanya,
tot el que es veia era seu :
Terres, pous, arbres i cases,
i al matí des de la torre
cada dia els comptava.
La gent no estimava el rei,
i ell tampoc no els estimava,
perquè de comptar en sabia,
però amor, no li’n quedava,
cada cosa tenia un preu,
la terra, els homes, les cases.
Un dia un noi del seu regne
vora el castell va posar-se.
I va dir aquesta cançó
amb veu trista però clara :
" Quan vindrà el dia que l’home
valgui més que pous i cases,
més que les terres més bones,
més que les plantes i els arbres ?
Quan vindrà el dia que l’home
no se’l pese amb les balances ? "
(...)
(Il était un roi dont le château se trouvait sur une montagne. Tout ce qu’on voyait du château lui appartenait : terres, puits, arbres et maisons, et tous les matins il les comptait du haut de la tour. Les gens n’aimaient pas le roi. Lui, non plus, il ne les aimait pas. Car il savait bien compter, mais il ne lui restait plus d’amour. Tout avait un prix : la terre, les hommes, les maisons. Un jour, un jeune du royaume s’approcha du château et entonna le chanson qui suit avec voix triste, mais claire : " Quand viendra le jour où l’homme vaudra plus que puits et maisons, plus que les meilleures terres, plus que les plantes et les arbres ? Quand viendra le jour où l’homme ne sera pas pesé avec une balance ? " )
Une chanson dont des enseignants ont fait un conte pour enfants.
34 réactions à cet article
Ajouter une réaction
Pour réagir, identifiez-vous avec votre login / mot de passe, en haut à droite de cette page
Si vous n'avez pas de login / mot de passe, vous devez vous inscrire ici.
FAIRE UN DON