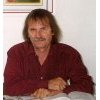Ce que vaut réellement le capital, c’est la peine qu’il peut imposer à autrui
À quoi tient la "réalité" du prix "réel" ? Pourquoi le travail qui, selon Adam Smith, est la mesure de la valeur de toutes les marchandises, est-il le garant de la "réalité" de cette valeur ? Tout simplement parce que, subjectivement - c'est-à-dire dans l'intimité de sa pauvre petite personne -, le travailleur s'est fatigué et a souffert, tandis que sous ses mains s'élaborait la future marchandise qui se présente ensuite devant l'acheteur avec, sous son prix nominal, un mystérieux, mais essentiel, prix réel.

Citons Adam Smith :
"Le prix réel de toute chose, ce que toute chose coûte réellement à l'homme qui veut l'obtenir, c'est la peine et le mal qu'il a pour l'obtenir."
Dans un troublant effet de miroir, voici, alors, ce qu'il en est de la position du propriétaire d'une marchandise :
"Ce que toute chose vaut réellement pour l'homme qui l'a acquise et qui veut la céder ou l'échanger contre quelque chose d'autre, c'est la peine et le mal que cette chose peut lui épargner et qu'il peut imposer à d'autres personnes."
Le mystère du prix réel, c'est donc qu'il mesure une fatigue, une souffrance, un désarroi, un désespoir, voire quelques gouttes de sang, une mutilation, un accident mortel... Ce qui n'empêche nullement la marchandise d'apparaître comme une "star" dans la vitrine... En effet, ainsi que le souligne Adam Smith :
"[...] comme c'est le prix nominal ou monétaire des biens qui détermine finalement la prudence ou la hardiesse de toutes les acquisitions et de toutes les ventes et par là qui règle presque toutes les affaires de la vie courante dans lesquelles il est question de prix, nous ne pouvons pas nous étonner qu'on s'en soit tellement plus occupé que du prix réel."
D'où l'on peut conclure également qu'en mode capitaliste de production, c'est bien parce que le producteur est esclave que le consommateur (le même, parfois) peut se prendre pour un roi...
Pour Adam Smith, la peine identique qui accompagne un même travail appliqué à des situations différentes fait, du travail en général, un instrument de mesure fiable de la valeur des marchandises produites. Mais quel rapport le travail, étalon du prix réel, entretient-il avec la monnaie qui est, elle, l'instrument de mesure privilégié par les acheteurs et les vendeurs qui s'affrontent sur un marché où règnent la loi de l'offre et de la demande, et donc les prix nominaux ?
La réponse d'Adam Smith marque un entêtement décidément indépassable :
"Le travail a été le premier prix, la monnaie d'achat originelle avec laquelle on a payé toute chose. Ce n'est pas avec de l'or ou avec de l'argent mais avec du travail que toutes les richesses du monde ont, à l'origine, été acquises ; leur valeur pour ceux qui les possèdent et qui veulent les échanger contre de nouvelles productions est précisément égale à la quantité de travail qu'elles peuvent leur permettre d'acquérir ou dont elles peuvent disposer."
On remarquera que nous sommes repassés ici du côté des employeurs, c'est-à-dire de ceux qui achètent et commandent la force de travail d'autrui en échange du versement d'un salaire représenté par une certaine quantité de... monnaie (prix nominal). Adam Smith poursuit, comme indiqué précédemment :
"En fait, ce prix peut quelquefois acquérir une plus grande quantité et quelquefois une plus petite ; mais c'est leur valeur qui varie, non celle du travail qui les acquiert."
Par conséquent, si toute peine mérite salaire, la peine accompagnant telle activité laborieuse et exigeant, en retour, la quantité de subsistances (le prix réel) qui permettra à l'ouvrier de se représenter approximativement dans son état premier le jour suivant, correspond à un prix nominal susceptible de variations...
Voilà pourquoi, ajoute Adam Smith,
"[dans un sens vulgaire] on peut dire que le travail, comme les marchandises, a un prix réel et un prix nominal. On peut dire que son prix réel réside dans la quantité de ce qui est nécessaire et commode pour la vie contre lequel on l'échange, et son prix nominal, dans la quantité de monnaie. Le travailleur est riche ou pauvre, bien ou mal rémunéré, en proportion du prix réel et non en proportion du prix nominal de son travail."
En d'autres termes, une hausse du prix nominal (du salaire comme il figure sur une fiche de paie) peut tout aussi bien correspondre à une baisse du prix réel de la force de travail (c'est-à-dire de la quantité de subsistances qu'il permet d'acquérir), la distorsion entre les deux prix provenant d'une baisse de la valeur de la monnaie dans laquelle le salaire est compté, ou de cette autre cause que nous évoquerons plus tard : la hausse de la productivité du travail qui fournit les subsistances nécessaires à l'ouvrier et à sa famille (permettant ainsi leur obtention à un coût moindre)...
13 réactions à cet article
Ajouter une réaction
Pour réagir, identifiez-vous avec votre login / mot de passe, en haut à droite de cette page
Si vous n'avez pas de login / mot de passe, vous devez vous inscrire ici.
FAIRE UN DON