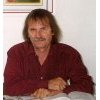Cette conscience de classe qui inquiète tant la bourgeoisie…
Même si, comme je le rappelais précédemment, la France de 1914 était encore un pays majoritairement rural, Charles Benoist sait bien distinguer où sont, alors, les forces politiques montantes :
« Le Nombre - c’est le suffrage universel, et dans le suffrage universel, c’est la classe ouvrière représentée surtout par les ouvriers de la grande industrie, qui, s’ils ne sont pas le nombre mathématiquement, arithmétiquement, le sont néanmoins, du fait de leur concentration, socialement et politiquement. » (La crise de l’État moderne, II, page 42)
Pour autant que les ouvriers sont les producteurs de cette plus-value qui conditionne l’existence même du capital, et qu’ils sont l’élément moteur du Nombre dans lequel le suffrage universel trouve son expression, il est assez clair qu’il y a péril en la demeure bourgeoise. Charles Benoist n’en doute pas :
« Notre système électif permet tout : rien n’y fait frein, rien n’enraye, ni n’arrête. La loi est la loi, et le nombre est le nombre. Le nombre fait la loi, et le travail - le salarié, le prolétariat, la classe ouvrière - est le nombre. Quand même, jour par jour, institution par institution, le nombre s’acharnerait ou s’amuserait à détruire la société, du fait qu’il est le nombre, la loi n’en serait pas moins la loi. » (pages 59-60)
Ici, il nous faut marquer un temps d’arrêt devant le rôle souverain que Charles Benoist donne à la loi. Si le nombre, conduit par la classe ouvrière, vient à se rendre maître de la loi, tout devra céder devant lui, nous dit-il. Façonné(e)s comme nous le sommes par la Constitution de 1958, nous avons quelque peine à comprendre ce qu’il nous raconte là. En France, le pouvoir tout spécialement législatif est tombé si bas que son rôle dans l’élaboration des lois qui nous gouvernent est ramené à peu près à rien. Quoi qu’il en soit des formes, nous sentons bien que c’est le pouvoir exécutif qui tient notre sort entre ses mains - ce qui ne l’empêche pas d’en faire diffuser certaines modalités de mise en œuvre par un pouvoir législatif qui dépend plus de lui que de nous…
C’est que la doctrine de Charles Benoist, relayé par André Tardieu, Jacques Bardoux (le grand-père de Valéry Giscard d’Estaing) et Michel Debré, est passée par là. D’où l’intérêt d’en voir le cheminement.
Mais il n’y a pas que la classe ouvrière… Celle-ci se trouve du côté de la production des richesses. Elle ne peut y œuvrer que si, par ailleurs, l’ensemble de la collectivité se trouve disposer d’une structure d’ensemble stabilisée et organisée pour durer : l’État. De ce côté-ci également, il faut être très vigilant… Et Charles Benoist, lui, s’inquiète à très juste titre, semble-t-il, de l’impact possible du Nombre à cet endroit :
« La législation se "socialise", se "révolutionnarise", et l’État peu à peu se "syndicalise" ou se "syndicaliserait". À la longue, les prétentions et les tendances actuelles des syndicats de fonctionnaires n’iraient en effet à rien de moins qu’à une transformation de l’État par la transformation des organes de l’État, ou plutôt par la substitution radicale de nouveaux organes aux anciens. » (page 73)
Qu’il s’agisse donc de l’État, c’est-à-dire de ce qui est constitutif du pouvoir exécutif, et du législatif - pour autant qu’à l’époque de Charles Benoist, il conservait une prééminence certaine sur le premier -, tout menace d’être bientôt plié, du fait de la mise en œuvre du suffrage universel, aux volontés du Nombre placé sous la conduite de la classe ouvrière.
C’est très exactement ce que Lénine décrivait au même moment et dans la continuité de ce qu’il en avait déjà dit depuis bientôt une vingtaine d’années.
Mais regardons comment Charles Benoist ne s’y trompe pas :
« Une condition nécessaire - et peut-être la plus efficace de toutes - à la formation et au développement d’une classe, c’est la concentration, le rassemblement en un lieu. » (page 87)
Or, il s’agit ici d’un rassemblement en un même lieu d’individus que réunit une identité particulièrement significative de leur condition d’ensemble :
« Un groupement se fait ensuite par profession. » (pages 91-92)
Cette pente de l’émergence prolétarienne que Lénine monte comme à plaisir, Charles Benoist est bien décidé à la faire redescendre à la classe ouvrière. Mais on pourrait presque s’y tromper tant c’est effectivement la même pente : celle de la lutte des classes. Ainsi allons-nous suivre l’homme qui nous conduit vers Michel Debré et vers le "parlementarisme rationalisé" dans un vocabulaire aujourd’hui oublié :
« En somme, deux éléments : l’un local, l’autre professionnel ; du rapprochement naît la conscience des intérêts communs : ce n’est pas encore la conscience de classe, mais c’en est le germe ou l’amorce. » (page 92)
"Conscience de classe" ! Ouh, la, la, comme vous y allez, Charles !... Qui poursuit, le bougre :
« Ces deux éléments, nous les retrouverons jusque dans les phénomènes les plus récents, jusque dans la formation de la classe ouvrière moderne, jusque dans la composition de la Confédération générale du Travail où se rejoignent sans se confondre le groupement local, les Bourses du travail, et le groupement professionnel, les Unions ou Fédérations de syndicats. » (pages 92-93)
Quant à nous, nous avons depuis longtemps assisté à l’effet historique strictement inverse : un éparpillement physique du monde ouvrier, une déstructuration des identités professionnelles… et à la disparition quasi-totale de la conscience de classe…
Dans ce contexte nouveau, la Constitution de 1958 ne fait pas que brider les couches antérieurement exploitées : elle les chasse de toute réalité sociale.
11 réactions à cet article
Ajouter une réaction
Pour réagir, identifiez-vous avec votre login / mot de passe, en haut à droite de cette page
Si vous n'avez pas de login / mot de passe, vous devez vous inscrire ici.
FAIRE UN DON