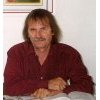Cette loi de la valeur qui demeure sous-jacente aux rapports de classes internes à l’Union soviétique
En 1952, l’Union soviétique se trouvait donc devant un dilemme dont Joseph Staline ne dissimulait pas la gravité :
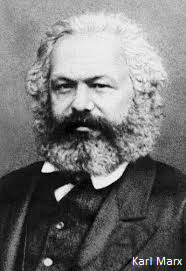
« Comment sera-t-il procédé à la formation d’un seul secteur universel ? Par simple absorption du secteur kolkhozien dans le secteur d’État, ce qui est peu probable (ceci pouvant être considéré comme une expropriation des kolkhozes), ou par la constitution d’un seul organisme économique national (avec des représentants de l’industrie d’État et des kolkhozes), ayant le droit d’abord de recenser tous les produits de consommation du pays et, avec le temps, de répartir la production, par exemple, sous forme d’échange des produits ? » (Idem.)
Redisons-le, pour éviter toute méprise : l’échange de produits n’est pas l’échange de marchandises… Une fois l’économie socialiste pleinement installée, ll ne s’y trouverait plus de monnaie… autre qu’une monnaie de compte. Mais même monétarisée, l’économie de marché qui subsiste en Union soviétique est une sorte de plante coupée de ses racines…
« Par conséquent, notre production marchande n’est pas une production marchande ordinaire, elle est d’un genre spécial, une production marchande sans capitalistes, qui se préoccupe pour l’essentiel des marchandises appartenant à des producteurs socialistes associés (État, kolkhozes, coopératives), et dont la sphère d’action est limitée à des articles de consommation personnelle, qui ne peut évidemment pas se développer pour devenir une production capitaliste et doit aider, avec son « économie monétaire », au développement et à l’affermissement de la production socialiste. » (Idem.)
Elle le « doit » au titre d’une idéologie qu’elle ne partage certainement pas… Et c’est là tout le problème… dans sa dimension strictement politique.
Mais, au fond même de la dynamique qui subsiste d’une économie de marché dans ce domaine tout de même très significatif des kolkhozes, autre chose agit qui conserve une efficacité qu’il vaut mieux ne pas perdre de vue. Il s’agit de l’ensemble des notions qui se trouvent rassemblées, chez Karl Marx, sous la formule générale de « loi de la valeur »… Celle-ci a été établie tout spécialement pour permettre la compréhension scientifique des mécanismes spécifiques de l’exploitation du travail dans les conditions du capitalisme.
Or, quoi qu’il en soit du niveau d’approfondissement du socialisme en Union soviétique, Staline n’en doute pas une seule seconde :
« Là où il y a marchandises et production marchande, la loi de la valeur existe nécessairement. »
Mais on pourrait dire qu’elle se manifeste dans toute sa splendeur là où Karl Marx est allé la scruter de très près, c’est-à-dire dans cette « production capitaliste », dont Staline nous dit qu’elle « est la forme supérieure de la production marchande ».
Prenons le Livre premier, première section, chapitre 1er du Capital. Sous le titre La marchandise, Karl Marx écrit :
« C’est donc seulement le quantum de travail ou le temps de travail nécessaire, dans une société donnée, à la production d’un article, qui en détermine la quantité de valeur. » (Karl Marx, Le Capital, La Pléiade, Œuvres, Économie, I, 1963, page 566)
Voilà pour la caractéristique la plus générale de la loi de la valeur telle qu’elle a été principalement établie par Adam Smith (1723-1790) et David Ricardo (1772-1823).
Quant au prix (de marché), il dépend lui-même de la loi de l’offre et de la demande, mais sur le fond plus général de la valeur portée réellement par la marchandise. Qu’il s’agisse de la valeur issue du travail à travers son exploitation par le capital, ou du prix de marché, nous sommes en présence de la valeur d’échange, qu’on pourrait hâtivement traduire par la valeur « vénale ». Indépendamment de quoi, le produit possède une valeur d’usage : le service qu’il peut rendre. Dans ce contexte précis du capitalisme, la force de travail elle-même est devenue une marchandise qui se vend dès qu’un individu met, pour un temps donné et dans des conditions précisément définies, certaines aptitudes de son propre corps au service d’autrui : voilà donc la valeur d’usage de la force de travail.
Quelle va être sa valeur d’échange ? Valeur réellement intégrée en elle, ou prix de marché sur fond de cette valeur réelle ?
La réponse fournie par Karl Marx pour La marchandise, reste la même dans le contexte de l’humain, et ceci pour autant qu’en mode capitaliste de production la force de travail est transformée en marchandise (rappel) :
« C’est donc seulement le quantum de travail ou le temps de travail nécessaire, dans une société donnée, à la production d’un article, qui en détermine la quantité de valeur. »
La force de travail étant nécessairement portée par un humain…, tout est donc dans la reproduction soigneusement calculée de sa personne en tant qu’elle travaille… Comme toute autre marchandise, la force de travail est rémunérée de façon à couvrir plus ou moins exactement les frais que sa reproduction aura occasionnés à travers l’élevage, la formation et la subsistance ordinaire de l’individu qui la porte…
Revenons maintenant à l’analyse que Karl Marx fournit de l’exploitation de l’être humain par l’être humain :
« Mais le travail passé que la force de travail recèle et le travail actuel qu’elle peut exécuter, ses frais d’entretiens journaliers et la dépense qui s’en fait par jour, ce sont là deux choses tout à fait différentes. » (Idem, page 744)
Nous retrouverons, dans le cas de la force de travail exploitée parce qu’elle n’est plus qu’une marchandise qui se vend (par le travailleur) et qui s’achète (par l’entrepreneur), cette même dichotomie qui caractérise la marchandise en général :
« Les frais de la force en déterminent la valeur d’échange, la dépense de la force en constitue la valeur d’usage. » (Idem, page 744)
Autrement dit : le capital rémunère la force de travail en tant qu’elle a une valeur d’échange, et il l’utilise en tant qu’elle est une valeur d’usage qui a comme caractéristique déterminante de pouvoir produire au-delà de ce qu’elle coûte… et ceci parce que le travail est la seule source de la valeur économique nouvelle, en dehors du fait qu’il maintient la valeur d’échange du travail passé qui se trouve incorporé dans les éléments qui lui permettent de travailler…
Dans le système de production capitaliste, la valeur d’échange incorporée dans tout produit comporte une part de salaire pour autant qu’il rémunère le temps de travail nécessaire au remplacement de la force de travail effectivement dépensée, mais aussi une part de surtravail qui ne revient pas au travailleur et qui s’en va alimenter le profit de l’entrepreneur.
Voilà ce à quoi il a été mis un terme en Russie par la Révolution bolchevique de 1917 : ce n’est plus sa capacité de produire de la plus-value au bénéfice du capital qui détermine la valeur de la force de travail ni les fonctions qu’il s’agit de lui donner.
1 réactions à cet article
Ajouter une réaction
Pour réagir, identifiez-vous avec votre login / mot de passe, en haut à droite de cette page
Si vous n'avez pas de login / mot de passe, vous devez vous inscrire ici.
FAIRE UN DON