Comme une image
« Connais-toi toi-même » et « Rien de trop » (gravés au seuil du temple d’Apollon dans la ville de Delphes où Socrate enseignait) ; « Mieux vaut faire envie que pitié » (Pindare, poète grec du Ve siècle av. J.-C.) ; « L’excès en toute chose est un défaut » ; ou encore : « Plus on a de pouvoir, moins on doit en user » que l’on vérifie au quotidien par « Moins on a de pouvoir, plus on aime à en user » ! Les sentences morales que l’on dit s’inspirer de l’esprit de sagesse sont pléiade.
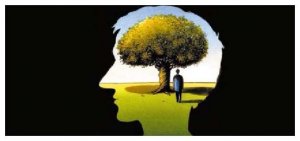
La sagesse, la voie de la sagesse… !
Si la sagesse désigne tant le savoir que la vertu d’une personne, dans son acception la plus courante elle est plutôt attribuée à celui apte à prendre des décisions raisonnables, justes, par exemple au prix de ses propres intérêts. C’est le bon sens populaire, parfois prosaïque et loin du philosophique ou du religieux. Mais un enfant sage n’est qu’un enfant obéissant. Par un mode de vie équilibré, parcimonieux, par le contrôle de ses passions et de ses émotions à l’égard du monde extérieur, le recours aux sagesses améliore l’individu. Par sa vie, l’incontournable Gandhi nous a démontré par l’agir la pertinence de sa philosophie. Et celle de Socrate vaut toutes les démonstrations. Quoi qu’il en soit, le sage est intrinsèquement lié au cosmos, à la réalité, et ce statut l'écarte des bruits de la cité. Savoir, modération, justice, respect, tempérance, actes liés aux paroles… Alors, en ces temps schizophrènes d’émotions médiatiques et de récurrents effets d’annonce, notre Homo est-il sage, comme ils disent…
Il ne faut pas chercher ailleurs que dans nos nouvelles racines monothéistes le déclin puis la chute de la sagesse. Bible, torah et coran ont su vénérer et instrumentaliser nos plus mauvais penchants, dont notre abominable désir de domination. Cette « mauvaise foi » donna leurs lettres de noblesse à nos pires instincts, fit une morale de nos tares. Christianisme, judaïsme, islam, les religions du Livre substituent l’antique sagesse, tout comme la sagesse écologique des peuples aborigènes et affins, par une croyance déraisonnable, irrationnelle. De toute évidence, le dogme se heurte à la conscience ensoleillée, l’obscurantisme s’impose par inquisition et contre la lumière ardente. Saint-Paul ne souhaitait-il pas renverser la sagesse : « Je détruirai la sagesse des sages, et j'anéantirai l'intelligence des intelligents » (1 Corinthiens.1 : 19).
La sagesse n’est plus de ce monde. Elle est désormais dans une catégorie « plus qu'humaine », au mieux peut-on y prétendre. Non, je ne suis pas sapiens, comme ils disent. Sapiens est donc un qualificatif erroné, un nom usurpé, débaptisons-le !
« Notre mode de vie n’est pas négociable » disait Georges Bush Père ; « Nous n’allons pas nous excuser pour notre mode de vie » répliquait Barack Obama.
À l’horizon 2050, cette vie deviendra invivable. Elle l’est déjà pour ceux qui fuient leurs terres occises. Le clap de fin est au mieux pour 2100. La passivité devant le désastre n’a d’égal que la vie anormale des gens normaux. « Et si l’aventure humaine devait échouer ? » : relire Théodore Monod s’impose.
« Je ne puis concevoir l'homme sans pensée : ce serait une pierre ou une brute (…) Penser fait la grandeur de l'homme. L'homme n'est qu'un roseau, le plus faible de la Nature ; mais c'est un roseau pensant. (…) Travaillons donc à bien penser : voilà le principe de la morale. » Blaise Pascal (Pensées, 1670)
« La principale maladie de la planète, c'est l'homme. » Paul Emile Victor
« Ce qui compte dans la sauvegarde des condors et de leurs congénères, ce n'est pas tant que nous avons besoin des condors, mais que nous avons besoin des qualités humaines nécessaires pour les sauver. Ce sont précisément celles-là mêmes qu'il nous faut pour nous sauver nous-mêmes. » Ian Mac Milan
Conscience de…
« Dieu dort dans le minéral, rêve dans le végétal, agit dans l’animal et s’éveille dans l’homme », disait un vieux précepte.
L’étymologie du mot « conscience » vient du latin conscientia, décomposé en cum scientia et signifiant « accompagné de savoir ». C’est notre faculté d’appréhender notre propre réalité et de la juger. La notion est déclinée en différents types et le langage courant parle de conscience objective, de conscience subjective, de conscience subconsciente, du Soi, de conscience universelle, de conscience de groupe, de conscience nationale, d’éco-conscience, etc. La conscience est un fait, ainsi que Descartes l’affirme dans ses Méditations Métaphysiques : « L'âme est un rapport à soi ».
L’humanité a de suite donné au terme conscience une connotation morale, le sens psychologique n’étant apparu qu’au XVIIe siècle. C’est bien le sens premier du vocable que l’on trouve déjà il y a plus de deux millénaires dans les œuvres de Cicéron ou de Quintilien. Le sens dominant reste aujourd’hui le même, la preuve en est que lorsque nous traitons une personne de « pauvre inconscient », c’est qu’il a perdu la conscience éthique, voire la raison, mais non la conscience de lui-même. Ne dit-on pas « conscientiser les foules » à propos d’une conscience que l’on estime objective ?
Une bonne métaphore pour comprendre la graduation de l’entièreté de la conscience, depuis le stade basique et subjectif jusqu’à l’accomplissement d’une conscience objective et universelle, sont les octaves de la gamme des sons. Tant que certaines de ces octaves ne sont pas atteintes, il n’y a pas discernement. Âpres au gain, enclins à l’irrespect jusqu’à la barbarie comprise, nous souffrons d’une réelle perte vers le haut de ces octaves de notre conscience que ne soigne nullement la surinformation instantanée, nous immunisant tout au contraire à l’endroit de toutes les émotions et de toutes les douleurs. Sans scrupules, nous ne souffrons plus du moindre poids de conscience et la conscience en fuite pourrait ainsi être mise en examen… de conscience. Histoire de libérer notre conscience d’un cas de conscience.
On peut déplorer que notre conscience ne soit pas à nos actions ce que le formidable instinct est à la conduite animale. Un piège culturel en toile d’araignée est tendu pour nous faire oublier cette voix de la Nature, pour que nous fassions l’impasse sur toute tentative de conscience objective, habilement reconsidéré en jugements de valeur sur-mesure, quitte à déployer mépris et déni. Inculquant idées fausses, mensonges, parti pris et préjugés, l’éducation reçue est plus exactement au service des fanatismes. Kant et Rousseau ont argumenté sur une autre éducation susceptible de faire entendre à l’enfant cette voix de la Nature, arguant du fait que le sens moral serait chez tout homme s’il n’était corrompu par l’instruction. C’est, selon Kant, l’œuvre d’une raison non savante, mais pratique, comme innée. Et même si Rousseau dissocie conscience et raison, c’est alors la raison théorique à laquelle il se réfère. « Conscience ! Conscience ! Instinct divin, immortelle et céleste voix ; guide assuré d’un être ignorant et borné, mais intelligent et libre ; juge infaillible du bien et du mal, qui rends l’homme semblable à Dieu, c’est toi qui fais l’excellence de sa nature et la moralité de ses actions ; sans toi je ne sens rien en moi qui m’élève au-dessus des bêtes, que le triste privilège de m’égarer d’erreurs en erreurs à l’aide d’un entendement sans règle et d’une raison sans principe. » (Rousseau, Émile, Livre IV).
Si la conscience psychologique est évoquée comme « la » lumière, celle morale est une voix intérieure. Ici, nous ne nous préoccupons guère de l’illumination, mais plus concrètement de la concertation, de la prise de conscience sans laquelle l’espèce humaine se dissocie de son milieu, se désolidarise du vivant, devient anature, seule, égoïstement perdue. Il appert que l’esprit écologique est la conscience et que la conscience est l’esprit écologique, l’écologie étant partout et nous unissant à tout, au travers des interdépendances. Tel un grand jeu d’empathie. L’effet papillon est comme un écho de mauvaise conscience. Il manquait le mot à Rousseau et à bien d’autres pour le dire. Les peuples racines des premières nations, dont toutes les cellules étaient en phase avec la Nature, ne souffraient d’aucune carence de conscience et excellaient par le respect universel. Adulés par Rousseau, nous les avons convertis, « instruits », volés, décimés. C’est ainsi que sous la menace des armes et des Livres, par l’extermination des aborigènes, des Amérindiens et de tant d’autres, notre pure conscience s’en est allée, lamentablement remplacée par la conscience du butin et de la très sale notion de patrie et de repli sur soi.
Voici des siècles, plus d’un demi millénaire, qu’à force de prosélytisme, d’idéologies véreuses ou fumeuses, et de fausses morales au service de l’appropriation, du progrès, du capital puis du consumérisme, que nous sommes en deuil de cette conscience naturelle, universelle, cosmique, qu’un Homo dit sapiens non civilisé partageait avec tous les êtres vivants. Il est inutile de lancer un avis de recherche, cette conscience là, nous n’en voulons pas, nous n’en voulons plus. Elle risquerait trop de mettre un terme à nos conquêtes, ces avancées à reculons auxquelles on doit notre incurable recul.
« Le respect seul, dans la mesure où il nous dévoile quelque chose de sacré… nous protègera contre la tentation de violer le présent au bénéfice de l’avenir, de vouloir acheter celui-là au détriment de celui-ci. » Hans Jonas
« Il faut résister contre cette dégradation de la dernière beauté de la Terre et de l'idée que l'homme se fait des lieux qu'il habite. Est-ce que nous ne sommes plus capables de respecter la Nature, la liberté vivante, qui n'a pas de rendement, pas d'utilité, pas d'autre objet que de se laisser entrevoir de temps en temps ? » Romain Gary
« L'homme Blanc possède une qualité qui lui a fait faire du chemin : l'irrespect. » Henri Michaux
3 réactions à cet article
Ajouter une réaction
Pour réagir, identifiez-vous avec votre login / mot de passe, en haut à droite de cette page
Si vous n'avez pas de login / mot de passe, vous devez vous inscrire ici.
FAIRE UN DON









