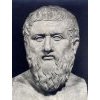Critique de la pensée positive
Depuis quelques années, la pensée positive est un des courants majeurs du développement personnel. Tandis que les morales traditionnelles plaçaient le devoir au centre de l’existence, la pensée positive se focalise sur le bonheur que chaque individu est apte à générer dans sa propre vie. Pourtant, la sagesse des siècles passés est peut-être plus fiable que certaines théories qui se veulent révolutionnaires. Il suffit de se projeter sérieusement dans l’alternative entre bonheur (et donc hétéronomie) et devoir (et donc autonomie) pour se faire une bonne idée des enjeux.

« J’ai fait de grands efforts, de vains efforts, pour m’éprendre de Gérard de Nerval », écrivait jadis André Gide. Et moi, je pourrais dire : « J’ai fait de grands efforts, de vains efforts, pour m’éprendre de la pensée positive. » Je lis en ce moment un livre intitulé The Happiness Advantage, de Shawn Achor (traduit en français sous le titre Comment devenir un optimiste contagieux). On y apprend que ce n’est pas le succès qui procure le bonheur, mais le bonheur qui procure le succès ; que, d’après toutes les études, le cerveau fonctionne beaucoup mieux lorsqu’il se trouve dans un état de satisfaction ; que c’est notre état d’esprit qui conditionne notre interprétation du monde, et qui détermine le succès ou l’échec de nos démarches ; que nous pouvons tous changer nos habitudes mentales à chaque instant ; que plus les gens ont une vie sociale développée, plus ils réussissent, etc., etc. Combien de fois ai-je déjà lu tout ceci ? Et pourtant, une voix au fond de moi persiste à soutenir que le but de l’existence, ce n’est pas le bonheur, c’est autre chose, quelque chose de bien plus inconditionnel que le bonheur : c’est la maîtrise de soi.
Le problème du bonheur, c’est qu’il se situe encore au niveau de la sensibilité, des circonstances, et donc de l’aliénation. Placer la finalité de l’existence dans le bonheur, c’est s’en remettre à des châteaux de sable, c’est tomber dans ce que Kant appelait l’« hétéronomie ». Il me vient à l’esprit l’image d’individus qui ont rejeté le bonheur tangible, qui ont détourné leurs regards de toutes les possibilités tellement vantées par la pensée positive, qui ont fait reposer tout l’équilibre de leur existence sur un principe unique, sur un point d’appui immobile, inébranlable, immatériel, et qui ont traversé plusieurs décennies de cette vie si chaotique grâce à cette discipline empreinte de pessimisme et de résignation. Je pense à ces petites vieilles que je voyais tous les dimanches sur les bancs de l’église au fin fond de la Pologne ; je pense à ces musulmans des premiers temps de l’Islam qui ont surmonté tous les obstacles et conquis la moitié du monde connu en se reposant sur un seul livre, le Coran, et en professant un seul credo : « Il n’y a de Dieu que Dieu, et Mahomet est son prophète » ; je pense à Épictète, à « ce que son œil a de fermé, de prudent, de réservé lorsqu’il lui arrive de se tourner vers le monde extérieur » (Nietzsche), à Épictète qui s’est détourné de l’univers entier pour posséder une seule chose : une volonté libre. Je pense à tous ceux qui baissent la tête, qui restent insensibles aux chatoiements de la vie, et qui tracent humblement et obstinément leur sillon. Je pense à tous ces êtres obtus et butés de tous les temps et de tous les pays, à ces paysans, à ces ouvriers, à ces matelots, et je me dis que ce n’est pas la pensée positive ou la transformation perpétuelle de soi-même qui répondent le mieux à la nature de l’existence, mais la fidélité indéfectible à sa propre posture.
6 réactions à cet article
Ajouter une réaction
Pour réagir, identifiez-vous avec votre login / mot de passe, en haut à droite de cette page
Si vous n'avez pas de login / mot de passe, vous devez vous inscrire ici.
FAIRE UN DON