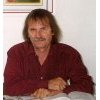De Voltaire à Ernest-Antoine Seillière, ex-patron du MEDEF
À diverses reprises, et notamment ces jours-ci, j’ai évoqué l’implication directe de Voltaire dans les guerres des deux premiers tiers du XVIIIème siècle en Europe.
Ce monde-là n’est pas si lointain de nous qu’il ne lui soit pas possible d’entretenir les liens les plus directs avec certains de nos contemporains, et d’une façon parfois presque stupéfiante. Ce sera le cas pour le premier président de ce qui s’appelle toujours le MEDEF : Ernest-Antoine Seillière, dont le patronyme complet est Seillière de Laborde…
Laborde, qu’est-ce donc ?
Sous ce nom, c’est effectivement la seconde moitié du XVIIIème siècle qui se rappelle à nous avec ce petit supplément qui vient soudain prendre la forme d’un définitif point de chute : le 29 germinal an II (18 avril 1794), le couperet de la guillotine s’abattait sur le cou de Jean-Joseph de Laborde, ex-banquier de la cour du mal-aimé Louis XV.
La scène se passe à six générations d’Ernest-Antoine. Elle n’a vraisemblablement rien perdu pour lui de sa cruauté. Peut-être même ne lui laisse-t-elle pas le choix d’être autre que ce qu’il est : un homme né de l’histoire dont on va suivre ici quelques développements.
Quand il fut brisé par les terribles remous de la Terreur, Jean-Joseph de Laborde tombait de haut, de très haut. À prendre la mesure de sa chute, nous ressentons nous-mêmes une sorte de vertige. Pourtant les noms sont ce qu’ils sont, de même que les chiffres. Pour les premiers, nous retiendrons d’abord Mme de Pompadour, Choiseul et Voltaire. Nous laisserons ensuite à ce dernier le soin de nous mettre le pied à l’étrier des grandes affaires d’une époque particulièrement mouvementée.
Le 6 décembre 1771, le patriarche de Ferney (77 ans) écrivait à Jean-Joseph de Laborde :
« Cette colonie va périr si je ne lui donne de nouveaux secours. Pouvez-vous avoir la bonté de me faire vendre cent mille francs de contrats ? Je ne disputerai par sur les prix […]. »
Nous non plus. Mais nous aimerions tout de même savoir de quels contrats il s’agissait et ce que représenteraient aujourd’hui ces 100.000 francs qu’on nous jette au visage.
La meilleure façon de répondre sur ce dernier point, c’est de considérer avec la plupart des spécialistes que la comparaison ne peut être que très approximative - pour ne pas dire totalement absurde -, et d’ajouter, avec au front le rouge de la plus extrême confusion, que l’hypothèse d’un salaire ouvrier moyen d’un franc par journée de travail n’est pas éloignée de pouvoir nous servir de boussole. Ainsi la modique somme de 100.000 francs évoquée par celui dont la bourgeoisie s’empresserait de porter les cendres au Panthéon dès 1791 représenterait aujourd’hui, en tout et pour tout, 100.000 journées de travail payées au SMIC.
Un petit calcul achèvera de fixer les idées. En cinquante années d’un travail effectué pour le franc quotidien, et suspendu les dimanches seulement, le manouvrier aura recueilli environ le sixième de cette somme : loin de pouvoir l’économiser, comme avait fait Voltaire, il l’aura dépensée au jour le jour pour à peine permettre à sa famille et à lui de survivre.
Ce brave Voltaire a donc en mains six vies entières de travail, ce qui n’est encore que l’un des fruits de son dur labeur. Mais ces 100.000 francs, il ne les a malheureusement que sous forme de contrats. Que veut dire cela ? Reprenons-le une vingtaine de mois plus tôt, alors qu’il écrivait à son ami le duc de Choiseul (12 mars 1770) :
« Si monsieur le contrôleur général voulait me rendre l’argent comptant qu’il m’a pris dans la caisse de M. de Laborde, sans que j’en aie prié, je pourrais commencer un gros commerce et attirer beaucoup d’ouvriers de Genève. S’il a voulu économiser, pourquoi n’a-t-il pas pris quatre millions cinq cent mille livres qu’il paie tous les ans aux Genevois ? Pourquoi n’a-t-il pas suspendu d’un ou deux ans le paiement des rentes sur lesquelles ils ont tant gagné ? Pourquoi me prendre à moi mon argent comptant qui m’appartient, et sur lequel je n’ai rien gagné du tout ? »
Comme cela se sent aussitôt : nous voici entrés dans la grande politique. À ce moment, en effet, le contrôleur général - le ministre des Finances - n’était autre que l’abbé Terray, un sous-marin introduit dans son propre Conseil par Louis XV pour préparer la disgrâce de celui qui était à la tête des affaires du royaume depuis bientôt douze ans, Étienne-François de Choiseul-Stainville.
Sur Voltaire, je vous en dis plus ici : https://youtu.be/-Pb4o-Hm5qg
Quant à Ernest-Antoine Seillière, je ne dispose que de ceci :
http://www.livres-de-mjcuny-fpetitdemange.com/#accueil.A/s0c/Tous
11 réactions à cet article
Ajouter une réaction
Pour réagir, identifiez-vous avec votre login / mot de passe, en haut à droite de cette page
Si vous n'avez pas de login / mot de passe, vous devez vous inscrire ici.
FAIRE UN DON