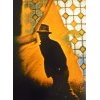Facteurs psychologiques post-attentats & Islamophobie
Près de quatre mois après l'attentat du Bataclan, Jesse Hughes des Eagles of Death Metal a confié à l’AFP : « Je porte toujours un flingue sur moi maintenant aux États-Unis (...) Je ne suis pas un cowboy, mais je veux être prêt. » Nombreuses sont les personnes présentes ce jour là à souffrir d'un trauma psychique post attentat. Ne confondons pas les victimes avec leurs assassins et persécuteurs. L'islamophobie peut-elle être considérée comme une pathologie phobique et qui n'a rien à voir avec le « racisme » ? Serait-elle un effet, une réaction à des faits en relation avec une cause (phobogène) première alors que le mot composé est utilisé dans un sens connoté pour signifier le rejet de l'islam et non dénoté, à savoir la crainte et l'effroi de l'islam parmi la population ? La question mérite à être posée et à la justice et aux experts de s'en emparer pour y apporter une réponse.
 La phobie est une peur incontrôlée irrationnelle susceptible à entrainer des répercussions sur la santé, la vie quotidienne et altérer la rationalité et/ou renforcer un sentiment de peur ou anxiogène. Tous ces aspects ont des répercussions sur l’organisme jusqu'à induire un état de stress chronique. Le stress en lui même n'est pas mauvais puisqu'il s'agit avant tout d'un effort d’adaptation de l’organisme. Ce qui est dangereux fait peur, c’est normal, et la peur peut être salutaire en s’accompagnant de réactions qui pourront aider à affronter la situation, soit en monopolisant nos ressources pour affronter le danger, soit en trouvant une énergie nouvelle pour évacuer rapidement la zone de danger. Mais au-delà de certaines limites, l'effort d’adaptation de l’organisme est dépassé et produit en nous toutes sortes de réactions ayant des retombées multiples sur la vie quotidienne et la santé. Si une situation n’est pas objectivement dangereuse mais qu’elle est ressentie comme telle, une réaction d’anxiété peut se déclencher et la personne se comporter comme si elle l'était réellement.
La phobie est une peur incontrôlée irrationnelle susceptible à entrainer des répercussions sur la santé, la vie quotidienne et altérer la rationalité et/ou renforcer un sentiment de peur ou anxiogène. Tous ces aspects ont des répercussions sur l’organisme jusqu'à induire un état de stress chronique. Le stress en lui même n'est pas mauvais puisqu'il s'agit avant tout d'un effort d’adaptation de l’organisme. Ce qui est dangereux fait peur, c’est normal, et la peur peut être salutaire en s’accompagnant de réactions qui pourront aider à affronter la situation, soit en monopolisant nos ressources pour affronter le danger, soit en trouvant une énergie nouvelle pour évacuer rapidement la zone de danger. Mais au-delà de certaines limites, l'effort d’adaptation de l’organisme est dépassé et produit en nous toutes sortes de réactions ayant des retombées multiples sur la vie quotidienne et la santé. Si une situation n’est pas objectivement dangereuse mais qu’elle est ressentie comme telle, une réaction d’anxiété peut se déclencher et la personne se comporter comme si elle l'était réellement.
Cet état psychophysiologique peut être lié à un sentiment d’insécurité indéfinissable et la simple vue d'un type d'individu devenir angoissante. Lorsque nous ressentons l'angoisse, « cette illusion de la peur », nous ne pouvons nous empêcher de prendre conscience d’un danger ou d’y penser au point d'être obsédé voire submergé par cette crainte. Des tas d’idées sombres nous viennent alors à l'esprit sans que nous puissions les en chasser. L'angoisse et son corollaire l'anxiété peuvent déboucher sur un comportement inapproprié pathologique. L’angoisse correspond à un sentiment de resserrement de la région épigastrique accompagné d’une difficulté à respirer. En fait, angoisse et anxiété sont pratiquement synonymes. L’attaque d’angoisse peut survenir brutalement et entraîner un sentiment très pénible et l'anxiété entretenir le stress qui à son tour génère encore plus d’angoisse.
Plus on comprend une situation plus nous pouvons l’admettre et la rationaliser, mais cela ne signifie nullement qu’il suffise de comprendre une situation pour ne pas la redouter. La panique est un état émotionnel paroxystique qui peut être de très brève durée mais avoir des conséquences dramatiques. La peur peut s’accompagner de manifestations somatiques (palpitations, dyspnée, etc.) ou pire ! de sidération. La personne est « statufiée » incapable de faire le moindre geste ou mouvement. La peur, qu’elle soit liée à l’enjeu ou à une situation subie dans laquelle on agit par réaction, reste une émotion associée à l’idée d’un danger réel. Plus l'individu craint la situation, plus sa réaction sera grande voire disproportionnée. Peut-on invoquer un jugement altéré ?
Chaque personne réagit sur le plan psycho-émotionnel différemment à une situation stressante. Cela dépend de sa motivation, sa personnalité et l’image mentale qu’elle se fait de la situation. Le stress qu’un individu peut supporter est compris dans certaines limites, au-delà apparaît l'épuisement et le sujet peut sombrer dans la dépression. Le système nerveux est complexe, si l’homme moderne a perdu bon nombre de ses défenses, il en a cependant conservé certaines manifestations. Devant un stress aigu, le corps va sécréter des hormones, l’adrénaline pour l’anxiété, la noradrénaline pour l'agressivité, et la libération de glucose par le foie (sucre) qui efface la fatigue et donne un « coup de fouet », apparaît ensuite la cortisone, et si le stress dure, les endorphines. Un stressor entraîne la vasodilatation (dilatation des vaisseaux) qui permet aux muscles striés (qui représentent environ 50 % de notre masse corporelle) d'accroître leur excitabilité et leur force contractile pour affronter ou fuir le danger. Si aucune activité physique ne vient en réponse du stress, les hormones sécrétées vont avoir une répercussion sur les articulations et être à l'origine de tendinites, contractures et de douleurs, c’est une des raisons qui pousse une personne stressée à avoir besoin de plus d’espace pour évacuer son excédent d'énergie. L’inhibition de l’action a une répercussion sur le long terme, si la réponse (fuite ou lutte) est satisfaisante, le sujet ne conservera que peu de séquelles, par contre si la réponse a été inadaptée, il y aura apparition d’un stress chronique avec : insomnie, fatigue, troubles somatiques, dépression. Tout cela a une répercussion à des niveaux différents sur les rapports avec autrui. Si la dépression est ignorée, elle peut déboucher sur une forme grave, comme la manie dépressive ou border line.
Juguler sa peur n’est pas facile. Il est impossible de prédire qui résistera à un stress extrême, tout au plus peut on avancer que 98 % des personnes sont des traumatisés potentiels. L’habitude du confort et les éléments sociaux y jouent un grand rôle. Pendant la seconde guerre mondiale, les armées américaines connurent plus de traumatisés psychiques que les Allemands ou que les Russes. Les cas dans l’armée Japonaise étaient quasi inexistants ! Le citoyen qui ressent un sentiment d'opposition à l'islam est peut être victime d’un sentiment de peur enfoui si profondément, qu’il contraint l’individu à un évitement total. Si certains nient leur peur, d’autres la projettent dans des phobies ou la déjouent par des contres-phobies. La contre-phobie consiste à aller au-devant de ce que l’on craint le plus. Une personne qui a peur du vide, exemple, se met à faire de l’escalade pour se prouver qu’elle n’a pas peur. L’individu essaie de nier une peur réelle par une activité physique ou symbolique de substitution qui va à l’encontre de son sentiment de peur. La contre-phobie entretient par contre la peur, ce qui signifie que l’on doit la combattre toute sa vie durant. la peur refoulée échappe à l’individu et va entraîner une tension qui va le ronger. Le sujet aura tendance à rechercher des situations dans lesquelles il se fera peur pour exorciser ses craintes.
La phobie emporte tout sur son passage, à la différence de l'anxiété, la phobie est répétitive face à une situation. Le seul fait d'apercevoir un « barbu » peut être à l'origine d'un sentiment de mal être ou de peur et conduire à une autre phobie comme celle de ne plus oser sortir de chez soi ou à éviter les lieux publics et dès lors conduire à une situation invalidante au plan professionnel et prendre une dimension de santé publique.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

10 réactions à cet article
Ajouter une réaction
Pour réagir, identifiez-vous avec votre login / mot de passe, en haut à droite de cette page
Si vous n'avez pas de login / mot de passe, vous devez vous inscrire ici.
FAIRE UN DON