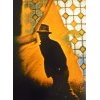Français de « souche »
La politique, pour être approchée, exige un certain nombre de connaissances économiques, historiques et géographiques à la base du caractère et de la mentalité nationals. La structure d'un État porte l'empreinte de son passé et la façon dont en sont organisés les divers pouvoirs permet de comprendre les réactions du peuple et de son gouvernement. Cela ne saurait être la panacée, derrière chaque État, il faut y discerner les réalités économico-politiques ou vécues comme telles par des hommes et des femmes faillibles.

De nombreux Français qui ont acquis la nationalité française soit par naturalisation soit par leur naissance sur le sol, ou issus d'une famille elle-même d'origine étrangère, prennent le vocable « français de souche » pour une discrimination alors qu'eux mêmes qualifient les Français de « Gaulois », c'est à dire de reconnaître implicitement une différence au travers d'une l'identité nationale partagée. Cela n'est guère nouveau « même les hérétiques se croyaient orthodoxes ». Paul Valéry a parfaitement circonscrit ce que signifie être Français de souche : « La vie d'un peuple organisé est tissue de liens multipliés dont la plupart passent dans l'histoire et ne se nouent que dans le temps les plus antiques. » Français de souche fait référence à la mère patrie, c'est à dire étymologiquement au pays du père ce qui est de fait impossible au Français de fraîche de date.
Combien de temps cela requiert -il de se sentir des racines dans un nouveau pays ? Pour l'ethnologue Edward Hall, au minimum trois générations... Cela peut au demeurant être valable pour la société américaine et certaines catégories d'appartenance, mais ne saurait valoir règle en France. Les Roms par exemple, conservent leur identité spécifique et les coutumes qui leurs sont propres depuis des siècles. La pire des choses qui puisse arriver à un membre de la communauté, c'est de s'en voir exclu et d'aller vivre au sein des « gadgos ».
Toute civilisation relève d'une culture et toute culture implique sa vision du monde. Pour beaucoup de nos concitoyens, le Moyen-Age évoque les châteaux-forts, les oubliettes, le seigneur féodal, les croisades, etc., oubliant que cette époque charnière marque le début de : l'État moderne, de la laïcité et l'émergence d'une société occidentale et du sentiment national. Jamais nous n'avons peut être été aussi proches de la modernité du Moyen-Age, d'ailleurs ne parle-t-on pas de fief, de baronnie, de droits et de devoirs, voire de République monarchique ou de République royale ? Autant de termes empruntés au Moyen-Age.
À peine la monarchie franque (Mérovingiens) installée que les cavaliers musulmans franchissent les Pyrénées après avoir soumis et islamisés le Maghreb et les peuplades qui y vivaient (ces derniers semblent avoir oublié cette épisode de leur histoire), s'apprêtant à envahir le royaume de France et à y propager leur foi. Les armées de Charles Martel vont les repousser en 732 au-delà des Pyrénées. Les barbaresques vont harceler les côtes méditerranéennes durant des siècles, piller l'« Italie » s'établir en Sicile ainsi qu'à la Garde-Freinet alors terre bourguignonne vers 890, et entraver l'essor économique. Le commerce avec Byzance se règle avec de l'or et l'Occident achète plus qu'il ne vend. Du VIIIe au XIe siècle on assiste à une prépondérance économique sarrasine, l'Occident qui ne frappe plus de monnaie d'or, mais d'argent, accepte le « dinar » qui devient la monnaie la plus appréciée. Le commerce concerne tout aussi bien les armes fabriquées par les Francs que les jeunes hommes et garçons enlevés par les « Allemands » et « Italiens » dans les pays slaves, d'où leur nom..., destinés à être vendus aux Sarrasins pour obtenir de l'or en échange et de commercer avec Byzance.
Qui se souvient que le calife de Bagdad, Haroun Ar Rachid et l'Empire de Charlemagne avaient conclu un traité de protectorat visant les Lieux Saints, et que le calife avait offert l'église du Saint-Sépulcre en toute propriété ? Cette entente allait permettre la construction à Jérusalem : d'églises, d'hospices et monastères chrétiens. Tout changea vers la fin du Xe siècle avec l'établissement d'un califat abbasside dissident qui régnait sur l'Égypte et une partie de la Palestine. Le calife El Hakin ordonna en 1009 la persécution des chrétiens sur tout son territoire, la destruction du Saint-Sépulcre, de Sainte-Marie-Latine, et celle de tous les monastères ainsi que le pillage de tous les biens chrétiens.
Aux IXe et Xe siècles, de grands propriétaires et de hauts fonctionnaires vont s'opposer au pouvoir royal avec succès, tant et si bien que le roi va leur accorder des chartes d'immunités interdisant aux agents royaux de pénétrer sur les riches domaines fonciers pour y lever l'impôt. Les premiers bénéficiaires en sont les abbayes tandis que les fonctionnaires royaux : ducs, marquis, comtes, deviennent inamovibles et leur charge devient héréditaire. Le comté est une circonscription indépendante et ses agents : comtes, vicomtes, châtelains, veulent eux aussi leur émancipation. Les ducs et les comtes exigent le service militaire, rendent la justice, et perçoivent les redevances autrefois perçues par le pouvoir royal.
Les voies navigables deviennent les voies d'invasion. Le seigneur s'étant substitué au pouvoir royal, lui incombe désormais la défense des territoires et la protection des gens présents sur ses terres, d'où le « contrat » instituant des droits et des devoirs, la personne a le droit a être protégée en contrepartie de son travail et le paiement de redevances. Le fief et la vassalité sont à la base de l'unité. À quoi bon la liberté quand sa vie est menacée. Une ordonnance (capitulaire) du IXe siècle recommande à tout homme libre de se choisir un seigneur. La fidélité au roi ne repose plus sur les sujets, mais sur le serment de fidélité prêté par les grands du royaume. Le roi désireux d'étendre son influence et son cercle en vient à concéder toujours plus de terres (et plus tard de charges) à ses vassaux. Si le vassal est protégé dans sa personne et ses biens, il se doit s'il est requis par son seigneur, l'apport de ses armes, troupes, de ses deniers et de servir à la guerre. Le système ressemble à une pyramide, celui qui a reçu des droits s'empresse d'en concéder une partie à d'autres vassaux. En cas de combat, tous les vassaux à quelque niveau que ce soit agiront de même au travers de la « chaîne féodale ».
Au Xe siècle, les seigneuries maillent tout le royaume, la baronnie en reste la cellule fondamentale. L'unité locale est réelle, elle est voulue par Dieu et sa cité comprend le ciel et la terre qui œuvre à l'harmonie divine. Les rivalités et les différents entre les grands sont nombreux mais l'Église invoque la paix céleste pour unir vassaux et seigneurs par la foi jurée sur les évangiles, y renoncer revient à être parjure et félon. La chrétienté unit la communauté au sein d'une même foi et une même culture. L'engagement chrétien librement consenti est gage de dignité et de respect de la personne humaine.
La foi chrétienne va gagner une grande partie des territoires européens : les Yougoslaves, les Bulgares et les Moraves (VIIIe siècle), les Hongrois, les Polonais, les Danois (le roi à la Dent bleue qui a donné son nom au système « bluetooth ») au Xe siècle, les Poméraniens, les Livoniens au XIIe siècle, les Prussiens, les Finnois, les Lapons, les Lituaniens au XIIe siècle. L'Église impose le latin aux lettrés et crée des universités où l'on enseigne les humanismes. La chrétienté dispose d'une hiérarchie en la personne du pape, sa loi ou droit canon, d'un clergé, d'ordres religieux ou militaires.
Au XIe siècle, le clergé connaît une crise morale avec le trafic des dignités et les charges ecclésiastiques qui deviennent vénales, elles sont transmises de clerc en clerc (la simonie). Le pape Grégoire VII (1073) entreprend des réformes (grégoriennes), Nicolas II va confier l'élection du pape aux cardinaux en 1179. La société religieuse est supérieure à la société civile, le pape peut juger et punir les rois et a pour mission de protéger les populations contre la tyrannie. On peut en appeler à lui de toute la chrétienté. Les rois ne tirent leur pouvoir que de celui de Dieu confié au pape.
Si la chrétienté rêve d'unité et de paix, elle a aussi ses adversaires : les païens, les hérétiques et les musulmans. Quand ses intérêts ou ceux des chrétiens sont menacés, la « guerre est juste » ou guerre sainte. Innocent III impose une monarchie pontificale avec la réforme, et les croisades vont se poursuivre contre l'islam. La guerre sainte reste un devoir religieux, les soldats et les pèlerins ont fait « vœu de croisade » et tous les hommes qui meurent en combattant les infidèles gagnent : « le repos de la vie éternelle. » Toute autre guerre qui détourne des chrétiens est impie. Les guerres privées doivent immédiatement cesser quand la guerre est déclarée aux infidèles. La trêve de Dieu suspend les conséquences de la guerre privée, les personnes, les terres, et les récoltes, bénéficient de la neutralité et sont inviolables.
Au XIIIe siècle, les tensions menacent la chrétienté, la croisade est délaissée (Philippe Auguste a abandonné le siège de Saint-Jean-d'Acre en 1191 pour regagner la France), l'hérésie progresse, la nouvelle bourgeoisie et les marchands ébranlent l'organisation seigneuriale pour prendre une forme laïque... Les villes conquièrent leur liberté. Plus question de faire vœu de pauvreté. Il ne s'agit pas d'une séparation de l'Église et de l'État, mais les laïques veulent intervenir dans les questions religieuses, rattacher les hôpitaux et les écoles à la commune, juger les hérétiques, et percevoir l'impôt. Philippe le Bel devenu souverain, le pape lui dénie de prélever des subsides sur le clergé, le roi réplique en interdisant toutes les sorties monétaires du royaume. Les légistes ont trouvé dans le droit romain un modèle de monarchie absolue et administrative : « Tout ce qui plait au prince a force de loi. » Le pape est déclaré hérétique et Philippe Le Bel fait élire en 1305, un pape français, Clément V, ce qui déplaît fortement aux Anglais. La guerre de Cent ans fut un conflit entre deux souverains de grands royaumes puis en une lutte de deux nations.
La lignée de Philippe Le Bel : Louis X (1314-1316), Philippe V (1316-1322), et Charles IV (1322-1328) va poursuivre sa politique et aboutir à la nation française. Richard II refuse de reconnaître le nouveau roi de France Charles VI qui lui refuse de reconnaître le pape de Rome. La royauté va tenter de se séparer du pape d'Avignon en proclamant en 1398 la « soustraction d'obédience ». En 1408, les deux papes sont déclarés hérétiques par le grand concile de Pise. La France et l'Allemagne en profitent pour consacrer leur indépendance à l'égard du saint-Siège. La délivrance de la ville d'Orléans en 1429 par Jeanne d'Arc vient renforcer l'éveil du sentiment national. Un nouveau péril va menacer le monde européen, l'Empire Ottoman porte le fer et le feu dans les Balkans posant un problème à la chrétienté. Les « Turcs » musulmans vont constituer l'empire Ottoman et la chute de Constantinople en 1453 va ébranler l'Occident chrétien.
La fin de la Guerre de Cent ans (1453) permet à Charles VII de poursuivre les grandes réformes : l'organisation du gouvernement, les impôts, des armées permanentes, les douanes, la séparation du temporel et du spirituel. Tous les États européens vont évoluer vers la monarchie centralisée. L'œuvre de Cervantes « Don Quichotte » (1605) allait se révéler néfaste à la chrétienté et annonçait les prémices de l'esprit voltairien - Descartes (1596-1650) Discourt de la Méthode - Colbert (1619-1683) - Pascal (1628-1662) - Montesquieu (1689-1755) l'esprit des lois - Rousseau (1712-1778) Le contrat social - Diderot (1718-1784) l'Encyclopédie - Turgot (1727-1781), etc.
Au Moyen-Age, la vie économique restait soumise à la morale et l'épargne était inconnue. Il ne devait point y avoir de gain sans travail et le gain devait rester en rapport avec la tâche (juste prix), c'est à dire un montant capable de subvenir aux besoins du travailleur. La notion de bonheur était alors inconnue, le but de la vie était de faire son salut et d'aider son prochain à faire le sien. La terre n'était qu'un lieu de passage. Le prêt était interdit, car il aurait permis de faire vivre sans travail, le prêteur (intérêts) et l'emprunteur consommant sans investir, réflexions que nous semblons redécouvrir au XXIe siècle !
14 réactions à cet article
Ajouter une réaction
Pour réagir, identifiez-vous avec votre login / mot de passe, en haut à droite de cette page
Si vous n'avez pas de login / mot de passe, vous devez vous inscrire ici.
FAIRE UN DON