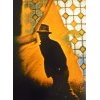Génie civil : l’habitation en zone sismique
Selon le BRGM et le CNRS, le foyer du tremblement de terre proche du Teil survenu le 11 novembre 2019 à 11h 52 qui a endommagé 600 habitations (classe B), serait situé « entre 1 et 3,5 kilomètres » sous la croûte terrestre. La Cellule post-sismique de s'interroger, les tremblements de terre en France se situent généralement entre 5 et 20 kilomètres, il est inhabituel de retrouver des failles visibles en surface pour un séisme de cette intensité accompagné d'un très faible nombre de répliques ! Selon certains sismologues : « La présence de la carrière de calcaire en activité située au-dessus de la faille supposée avoir rompu pourrait avoir contribué au déclenchement du séisme. (...) Les matériaux exploités depuis plus d'un siècle ont créé un allègement de la roche et provoqué un mouvement d'isostasie : sous la poussée verticale des roches en profondeur, le bloc allégé est remonté de quelques cm brusquement et a provoqué au moment de son mouvement ce séisme de magnitude 5,4 - 5,6 ».

Le Réseau National de Surveillance Sismique comptabilise environ 1.300 tremblements de terre en France, et une quinzaine d'une magnitude supérieure à 5. Le séisme le plus fort enregistré en 1909 à Lambesc avait une magnitude de 6.2. La magnitude représente la quantité d'énergie libérée, tandis que l'intensité est liée à l'effet des secousses en un endroit donné. L'aléa sismique reste en l'état actuel de nos connaissances imprévisible, si on peut le prévenir on ne peut le prévoir. Les secteurs sismiques sont définis en fonction de la géologie, de la fréquence de résonance du sol et des types de bâtiments (classe A à D). Le classement du zonage sismique national est basé sur le recensement des aléas régionaux survenus au cours des 475 dernières années pour les constructions « ordinaires », et sur le séisme le plus fort survenu sur mille ans auquel on ajoute un demi degré (échelle ouverte de Richter) pour les sites sensibles (classe D).
Les tremblements de terre sont souvent localisés au voisinage des plaques tectoniques et des failles. « un tremblement de terre se traduit par une vibration du sol due à une accumulation d'énergie qui se libère en créant, ou en faisant rejouer des failles intraplaques. Après la secousse principale, des répliques peuvent survenir correspondant à de petits réajustements des blocs au voisinage de la faille ». Tous les tremblements de terre sont différents et leurs effets diffèrent d'un lieu à un autre, et ce, pour une même construction. La rupture dans le sous-sol peut aller de quelques centaines de mètres à plusieurs centaines de kilomètres, et la faille être superficielle ou profonde.
Lorsque l'onde sismique primaire rencontre le sous-sol d'un bâtiment, elle y subit une accélération responsable de la déformation du bâti vertical, et l'onde secondaire le bâti horizontal. Chaque fois qu'un corps entre en mouvement il est soumis à une force. Tout mouvement est le résultat d'un travail, traction ou poussée, (les jeunes désœuvrés qui poussent le mur de leur cité n'accomplissent aucun travail, le mur n'a pas bougé ;-)). Un phénomène de résonance peut amplifier dangereusement les oscillations. Le mouvement d'un pendule vient de ce que l'énergie qu'il renferme change progressivement de cinétique à potentielle. Au points extrêmes où le pendule s'arrête, son énergie cinétique est nulle et son énergie potentielle est maximale, il ne se déplace plus mais s'apprête à revenir (l'effort pour pousser une balançoire nécessite moins d'énergie si la poussée accompagne le mouvement). Les périodes d'oscillations sont propres à chaque construction et dépendent de sa forme et de ses dimensions. Les forces d'inertie (résilience) tendent à ramener les superstructures à leur point d'origine (comme le passager d'un bus subissant une décélération qui revient à sa position de sustentation). La vitesse de déformation du sol se mesure en m/s2, et la force d'inertie correspond à la masse de la structure par l'accélération subit. Les secousses verticales ébranlent tout terrain instable et sont susceptibles d'entraîner un glissement de terrain ou une chute de pierres. Les terrains aqueux peuvent se « liquéfier » et perdre de leur cohésion (principe des sables mouvants). Une onde sismique emprisonnée entre deux reliefs (vallée, talweg, etc.) ou une couche de terrain meuble et le bed-roc peut voir son action amplifiée.
Une construction requiert une assise stable, le type et les dimensions des fondations doivent être adaptés aux aléas (profondeur hors gel, risque de sécheresse, sismique), ce qui est rarement le cas pour les constructions anciennes, et aucune construction ne devrait être bâtie à proximité d'une zone de faille ou d'anciennes mines ou carrières. Il n'existe pas de fondations standard, les fondations servent d'interface et amortissent les forces inertielles et les ébranlements de la structure. L'étude de sol (portance, homogénéité, pente, humidité) détermine la technique à retenir : poteaux-poutres, murs porteurs (les semelles isolées supportent la charge des poteaux, parfois reliés (chaînés) entre eux pour améliorer la stabilité horizontale du bâtiment, ou filantes réalisée en continu sur tout le périmètre de la construction qui sert de chaînage horizontal) pour les terrains offrant une bonne portance. Radier et renforts de ferraillage au dessous des porteurs pour un sol moyen homogène et fondations profondes (pieux), consolidation des sols (injection de mortier, compactage) en terrain hétérogène ou à portance médiocre. Si deux constructions voisines n'ont pas la même charge ou reposent sur un sol hétérogène, elles interagissent différemment avec le sol, leurs semelles doivent être liaisonnées et un joint (6 cm) entre les fondations s'impose.
Les murs ont pour fonction de supporter les planchers et les ouvertures en transmettant au sol leurs propres poids et de contribuer à la répartition des charges qu'ils supportent. Les murs porteurs sont alignés dans le plan vertical et horizontal afin qu'ils se superposent, et l'alignement vertical des fenêtres améliore la " descente de charge " jusqu'aux fondations. Le linteau placé au dessus des ouvertures reporte les charges vers les parties pleines. Comme les efforts mécaniques sont moindre dans les étages supérieurs, l'épaisseur des murs peut être inférieure dans les parties hautes (surtout par souci d'économies). A noter que la tenue d'un mur dépend de son élancement (hauteur / épaisseur) et des matériaux employés et de leur assemblage. Les murs de refend sont les murs porteurs à l'intérieur qui recoupent le bâtiment dans sa longueur et sa largeur, la chaîne verticale est souvent discernable sur le mur extérieur (le conduit de cheminée y est souvent en appui) ; les cloisons délimitent les pièces. Le chaînage, horizontal et vertical ou d'encoignure s'oppose à la dislocation des murs. Les murs pignons supportent les pannes de charpente du toit. La toiture est composée de fermes en charpente (bois, métal, béton) disposées transversalement (combles) qui la supportent et d'une couverture (tuiles, ardoise, zinc, lauzes) reposant sur des lattes. La pente tient compte des conditions climatiques et des traditions régionales.
Le plancher situé entre deux niveaux doit supporter la masse et la charge des pièces (environ 500 kg/m2), son ossature doit être appuyée sur la structure verticale et solidaire du chaînage horizontal (les murs de l'étage sont construits ou posés après le plancher). Jusqu'au XIX°, les planchers étaient en bois, les solives prenant appui sur les murs porteurs ou sur les lambourdes. Les trémies, parties vides réservées à l'escalier, ascenseur, gaines techniques, requièrent parfois une interruption du plancher conduisant à modifier son ossature et à compromettre la stabilité (transfert et report de charges).
Les secousses sismiques entraînent des contraintes, au-delà d'une certaine déformation (environ 2 cm par niveau) la maçonnerie se disloque, c'est l'effondrement avec déversement de la façade. Aucun matériau n'est parfait, l'action d'une force sur un corps a un effet de traction (allongement), de compression (tassement), de cisaillement (deux forces de sens contraire). La déformation est d'abord élastique, le corps reprend ses dimensions primitives lorsque les forces qui l'ont déformé ont cessé d'agir (quand une balle frappe le sol, sa surface de contact se déforme et emmagasine de l'énergie élastique, l'énergie cinétique s'accumule sous forme d'énergie potentielle élastique qui la fait rebondir et redevient énergie cinétique), puis semi-élastique (la déformation s'atténue sans disparaître totalement), ou plastique, le corps reste déformé (caramel mou).
Selon la direction de l'onde de surface, le bâtiment peut s'écrouler sur sa base (poussée d'en bas) ou vers l'extérieur y formant un tas de décombres (poussée latérale). Plus le moment d'inertie d'une section profilée est grand, plus sa résistance sera grande, une bande de papier posée entre deux appuis fléchit et cède, si on y fait un pli de chaque bord, on obtient un élément bien plus rigide. Tout changement de forme (flambage par exemple) ou de section d'une pièce chargée produit un point de tension d'autant plus important que le changement de section sera soudain (concentration des lignes de force). La rupture se produit par une sorte de flexion latérale (voile ou flambage). Une solution repose sur le contreventement (croix de Saint André, tirants) des panneaux pour obvier l'effondrement (angles des diagonales sur lesquelles les poussées vont s'exercer).
La déformabilité dépend de l'élévation des murs, des matériaux de construction utilisés (brique, béton armé, vibré, parpaing, pierre, etc.), de leur assemblage (maçonnés panneresse, à l'anglaise, coulage dans un coffrage), leur forme, leur masse et leurs liaisons avec le système porteur. Pour apprécier la résistance mécanique d'une construction, il convient de faire une distinction entre la construction en dur : où façades et murs porteurs répartissent la charge du bâtiment sur l'ensemble de ses fondations. Les murs en béton sont généralement armés de fer et constituent le plus souvent l'enveloppe extérieure et les cloisons internes. La construction à colombage ou à ossature : de bois, de fer, de béton armé qui supporte la charge du bâtiment. Les vides entre les poutres sont remplis avec des pierres, des briques, de la terre, du béton, etc. La façade peut être recouverte de ciment, de plaque ou d'un bardage. Les murs de remplissage n'offrent que très peu de résistance aux poussées latérales.
En zone sismique, toute modification sur une partie du bâti, souvent des ajouts tardifs, doit être évitée. Une mauvaise disposition géométrique des pièces (en L, U, T, saillant, encorbellement), des parties fragilisées (fissures, béton éclaté) ou des reprises de maçonnerie peut suffire à entraîner l'effondrement. La ruine peut s'amorcer à partir d'un point faible (ouverture, porte, fenêtre, R-d-C, escalier, porte-à-faux) ou de l'angle d'un mur non confiné dans un cadre ou de l'absence d'une chaîne d'angle (appareil en besace). Ces bases digérées, gageons que vous ne regarderez plus les bâtiments de la même façon.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
16 réactions à cet article
Ajouter une réaction
Pour réagir, identifiez-vous avec votre login / mot de passe, en haut à droite de cette page
Si vous n'avez pas de login / mot de passe, vous devez vous inscrire ici.
FAIRE UN DON