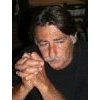4. Il n’y a pas de violence gratuite : Shogun, Robespierre et Columbine
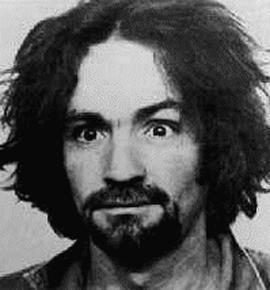
La révolution industrielle et la suprématie incontestable de l’occident étant derrière nous, ces deux formes de pouvoir ressurgissent, faisant apparaître les difficultés dues à l’inexistence d‘un mythe fondateur et fédérateur en occident et parallèlement l’impossibilité d’un anti discours autonome en Asie. Dérégulation et mondialisation se définissent au sein de ces deux ensembles de manière très différente. Cependant, au sein de ces deux ensembles il existe une variation de modèles : la Chine, qui suivit l’exemple des Shogun avec le maoïsme, perpétua cependant une sorte de culture individualiste souterraine (mais bien affirmée) par sa diaspora commerçante et les exceptions institutionnelles basées sur le mimétisme dont l’exemple le plus frappant est le « une nation, deux systèmes » qui régissent, via les anciens comptoirs occidentaux (Hong Kong) une gestion « pragmatique » du binôme économie - politique. Les Etats-Unis, créés par une aventure collective et individualiste à la fois, perpétuent le mythe fondateur d’un Etat nation arraché aux grandes puissances européennes décadentes par les armes (Angleterre) ou par l’argent (France) tout en individualisant à l’extrême la notion même de réussite (self made man : l’homme se fait par lui même).
La conquête de l’espace nord-américain se fit d’abord par des hommes et bien après par les institutions étatiques. Ce qui installa durablement une mythologie antiétatique d’une part et, d’autre part le retour à une autonomie revendiquée de l’espace privé et local, aux dépens de l’Etat central. Contrairement à l’Europe qui réintègre la tradition gréco-romaine d’une restriction juridique du « Padre Padrone », et de l’Asie où le monopole étatique de la violence devient la règle. Pour donner un simple exemple, la peine de mort, qui tend à disparaître en Europe, reste pratiquée aux Etats Unis avec l’aval de l’opinion publique (est souvent grâce à la peur des exécutifs face à la vox populi). En Chine aussi, mais cette fois, comme symbole d’un monopole d’Etat institutionnel et central ayant remplacé celui des pouvoirs éclatés et arbitraires.
De la sorte, la « violence inexplicable et inexpliquée » diffère d’une région à l’autre. Aussi bien du point de vue institutionnel et de l’opinion publique qu’analytique. L’extraction volontaire ou forcée du corps social principal et de sa manière de juger ou d’expliquer, ainsi que les explications psychologiques ne sont pas les mêmes ni de part et d’autre de l’Atlantique ni entre les pays occidentaux et asiatiques. Les dites pathologies sociales non plus : un tueur en série aux Etats-Unis n’est absolument pas perçu ou expliqué ici et en Amérique de la même manière. Son aspect individualiste (messianique et souvent anti fédéral) qui sévit en Amérique est quasiment inexistant. Nos tueurs en série sont, (dans la plus part du temps) considérés comme des pervers sexuels qui tuent en conséquence de leur perversion, et non pas des tueurs croyant à une mission terrestre ou divine.
Exception faite de la grande dépression, puis des révoltes à caractère racial, (comme on dit aux USA), ce pays ne connaît pas de « révolte des banlieues », ni de guérilla urbaine, ni même une confusion de genre entre criminalité urbaine et contestation sociale. « Paradoxalement », le niveau de violence est plus élevé en Amérique mais le discours l’accompagnant n’a rien de radical. Et cela même en ce qui concerne les syndicats qui, dans une histoire relativement récente, ont préféré faire appel à la pègre plutôt que de radicaliser leur discours (Teamsters, mineurs des Appalaches, etc.).
Ainsi, en Europe, tout prend une connotation politique (même quand les intéressés n’y pensent pas) tandis qu’aux Etats Unis tout est du domaine du privé (même quand l’action est essentiellement politique). En ce sens, la lutte pour les droits humains (Human rights) oppose - même mené collectivement - l’individu et son domaine privé à l’omniprésence de l’Etat.
L’impossibilité de percevoir un message politique extrême interne peut mener très loin : dans les années 60, le seul groupe non noir-américain qui a radicalisé son discours, les Weatherman, a été liquidé par le FBI comme un « ennemi extérieur », une « association d’espions ».
Le maccarthisme n’avait pas agi autrement.
Bref, derrière chaque acte violent inexpliqué en Europe on cherche une explication sociale (chômage par exemple) ou analytique (perversion sexuelle, folie) l’individu étant par définition une victime ou un « plus révolté que les autres », face au machiavélisme de la Cité.
Tout acte violent qui ne se fédère pas derrière une contestation politique est inexplicable ; Mais pas vraiment.
Aux Etats-Unis, on le soupçonne d’être, soit un corps étranger, soit un défendeur des droits inaliénables de l’individu face à l’Etat (Unibomber).
L’inexplicable, dans ce cas restant Columbine ; Mais pas vraiment.
(A suivre)
5 réactions à cet article
Ajouter une réaction
Pour réagir, identifiez-vous avec votre login / mot de passe, en haut à droite de cette page
Si vous n'avez pas de login / mot de passe, vous devez vous inscrire ici.
FAIRE UN DON