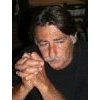Avril 1987 : à cent kilomètres de Monggok, au sud-est de la Birmanie, la bataille fait rage. C’est ce qu’indique l’ensemble des dépêches de presse, les télévisions, les commentateurs. Mais sur place, où je me trouve (et sans grande difficulté), c’est le calme absolu. Les bonzes, les pagodes flamboyantes, les paysages perpétuent un calme et une sérénité absolues. En fait, il s’agit du énième épisode d’une guerre imaginaire, qui se perpétue pour nourrir justement les agences de presse et pour indiquer à quel point il est difficile de contrôler en Birmanie la production d’opium. Cette guerre entre pouvoir central et « minorités ethniques » n’est pas uniquement un spectacle télévisuel (véhiculé par les mêmes images sorties des archives et quelques escarmouches auxquelles on vous invite à assister) : il implique des actions diplomatiques, des financements Onusiens, ordonne la patience et la compréhension, et finit par devenir un rite d’intégration du pouvoir militaire de Rangoon au sein de la communauté internationale. Si je témoigne qu’il ne se passe rien là où « tout le monde », (c’est-à-dire les centrales d’information installées dans un autre pays, la Thaïlande), affirme qu’il y a une guerre, je ne serais, tout simplement, pas entendu : En effet, je ne mets pas en cause un simple fait, mais un mythe, un rituel, un système d’interprétation bien établi. Je mets surtout en cause un relais d’informations qui se nourrit de lui-même et qui peut difficilement supporter la moindre digression. Deux problèmes se posent ainsi : le premier, porte sur la volonté de saisir et de comprendre un fait extra - ordinaire et ses relations avec le long terme. Le deuxième, porte sur la nature et le fonctionnement des acteurs de l’information et sur les capacités de perception de cette même information par le reste du monde et les « décideurs ». Nous sommes en effet face à un paradoxe : à force de consommer une information formatée et routinière, les décideurs, nationaux ou transnationaux n’agissent plus que sur des « ressorts de crise » -donc réagissent-, en abandonnant leurs capacités d’anticipation. « Gérer le monde » -attitude anticipatrice par excellence-, aujourd’hui c’est « gérer les crises » c’est-à-dire n’intervenir que lors de l’exceptionnel, ou perçu en tant que tel. Comment on est-on arrivé là ? Comment une addiction à l’exceptionnel, qui peut se concevoir de la part des médias, est devenue une pratique quotidienne des « décideurs » ? Interrogés, les analystes et observateurs, venant de milieux aussi divers que la presse (télévisuelle et écrite), des ONG, des forces de l’ordre ou des professionnels du renseignement, indiquent à quel point la perception et le compte-rendu d’un phénomène est souvent aussi important que le phénomène lui - même. Or, le support responsable de la perception n’est pas neutre. L’information étant devenue une marchandise comme une autre (et ici le mot marchandise n’a rien de péjoratif), elle se décline selon une multitude d’intérêts qui ne se résument plus au tandem classique « pouvoir - droit à l’information ».
Si le monde s’est globalisé, il a éclaté au moins autant que ceux qui en rendent compte. C’est dire à quel point, une information qui voit le jour est le résultat de filtres subjectifs et surtout d’un « consensus de perception », d’un compromis et d’arrière-pensées. En 1997, en menant en France une étude statistique sur les analyses médicales d’ex-consommateurs d’héroïne sous traitement de méthadone, je fis remarquer qu’un pourcentage significatif de ces patients (un bon tiers) cherchant un substitut au « flash » manquant de l’héroïne consommaient de la cocaïne, en plus du produit de substitution
[1]. Les professionnels de la prévention me firent remarquer que la politique volontariste de substitution ne supportait pas de telles informations. Six années plus tard, on découvrit une « forte consommation » de cocaïne contre laquelle il fallait agir de « toute urgence ».
Une fois ainsi « donnée », « l’information - compromis » devient un sujet d’information et d’analyse supplémentaire, s’enrichit de nouvelles variantes, des nouveaux protagonistes s’en emparent, lui donnant l’intérêt qu’ils veuillent bien, celui qui leur propre intérêt. Vendre de l’humanitaire, des nouveaux logiciels de contrôle ou de perception, vendre des nouvelles peurs, de nouveaux espoirs, des subventions, des aides au développement, des armes, de l’audimat, des journaux, des services de protection, des analyses géopolitiques, des politiques, etc.
La « perception » devient un objectif en soi, détermine des nouveaux marchés et, dans ce dessein, doit se focaliser, se concentrer, gagner du temps et de l’espace (télévisuel par exemple) pour atteindre la pérennité relative nécessaire à une exploitation. Ainsi, la surexploitation compétitive de l’événement crée de la démesure. La focalisation excessive sur un événement a un prix, n’est pas neutre, engendre des actions et des dividendes. C’est là, sans doute, la première contradiction issue d’une globalisation de l’œcoumène et des multiples acteurs qui en rendent compte. Or, cette focalisation sélective empêche l’anticipation. Elle engendre un regard et une action « paniques » (au sens que lui donnent les auteurs du « théâtre panique »), qui valorisent des archétypes enfouis dans l’inconscient collectif de nos sociétés, considéré comme une « valeur forte et pérenne », sensée pouvoir perpétuer et cultiver l’intérêt.
Ainsi, la garantie principale de la
durée de l’information devient justement l’exceptionnel, c’est-à-dire quelque chose qui en soi est
éphémère.
[2]L’anticipation -par contre-, exige une recherche et un travail d’enquête sans à priori. La globalisation (qui amplifie et diversifie l’objet), la multiplicité des exigences et des stimuli -parfois contradictoires- issus du « besoin panique de pérennité », le manque de moyens, l’accélération du temps et surtout l’hégémonie d’une
techné amputée dans sa dualité de son aspect philosophique (Comprendre le monde)
[3], deviennent autant d’obstacles à la mise en pratique d’un processus d’enquête. Par ailleurs, la focalisation excessive ne supporte pas (ou peu) la nuance. L’information se doit manichéenne. Au moment de l’action, l’outil information simplifiera les enjeux : peu importent si par exemple, Serbes et Bosniaques s’échangent (ou se prêtent) des biens (armes) et des services (réseaux de contrebande) dans les boîtes de nuits pendant le couvre-feux à Sarajevo. Peu importe si la KLA se finance à l’héroïne. Choisir un camp rend secondaires ces informations quitte à avoir à affronter, quelque temps après, des problèmes inhérents à la « criminalisation du politique » soudainement « découverts ».
Le chercheur, quant à lui, aspiré par un environnement utilitaire,se désespère d’avoir le monde comme objet, s’ajoutant à la liste précitée de tous ceux qui ont quelque chose à vendre sur l’exceptionnel qui devient permanent.
L’hégémonie des crises sur notre perception du monde
La fixation sur les crises occulte ainsi la perception du monde complexe duquel, pourtant, elles sont issues. L’information privilégiant l’accélération et le modèle « panique » déterminant la perception se conjuguent pour donner l’image d’un monde effervescent et accéléré. Mais l’est-il vraiment ? Pour les trois quarts de l’humanité, pourtant partie prenante de la mondialisation, celui-ci reste plutôt figé ou régressif. Il comporte certes « des enclaves de modernité » comme les offshore des Caraïbes ou de l’Océan Indien, -elles aussi produit d’un « compromis »-. Les actions d’intégration, normative comme en Afghanistan, militaire comme en Iraq, technologique comme en Inde, économique comme en Chine, juridique comme au Cambodge, etc, ne touchent qu’une infime minorité d’individus côtoyant ou partie prenante de la logique de l’enclave. Ainsi, quand on parle de l’Afghanistan et de son « processus démocratique » qui vise à la mise en place d’une constitution d’un islam modéré et d’une société civile libérée des clans et des seigneurs de la guerre, on parle de deux choses différentes : de la mise en place d’un processus non intériorisé pour quelques-uns, et d’un autre, se calquant sur des exigences importées en les phagocytant. Pour la communauté internationale, l’ONU ou l’Union européenne, protagonistes de ces mutations, le fait est remplacé par sa perception.
Si l’on décline l’ensemble des variantes ci-dessus (et qui ne portent que sur une toute petite partie de l’œcoumène), nous pourrions affirmer que la notion d’hégémonie ou plus simplement d’une mondialisation d’un modèle occidental, est perçue et non réelle. Qu’elle comptabilise des espaces, des pratiques, des « intégrations » au niveau de sa perception et non pas sur celui d’une réelle « unification » : Certes, le Cambodge a désormais une loi anti-drogues, mais, tant qu’il n’a pas un code civil à quoi sert-elle ? Elle sert à
comptabiliser le Cambodge comme un pays intégré « dans la lutte anti-drogues ». Ainsi, le concept l’emporte sur la réalité (des drogues au sein du Cambodge). La focalisation sélective transforme un problème isolé non résolu
[4] en un « tout » intégré. On pourrait démultiplier les exemples à l’infini, le constat est là : à force de percevoir (et d’agir) sur l’exceptionnel, on cultive l’immobilisme tout en étant persuadés que « tout » va très vite. Nous sommes persuadés d’avoir une prise sur cet
olos -la totalité
-, tandis qu’il ne s’agit que d’une perception d’action sur une réalité locale. C’est justement le rôle du mythe. Celui-ci, en déclinant des actions ponctuelles mais symboliques raconte le processus émancipateur qui aboutit à la Cité. Il suffit à Hercule, qui combat les symboles du chaos, de tuer un lion, celui de Némée, pour éradiquer tous les lions…
Quelle est la différence avec nous ? Les mythes fondateurs grecs célèbrent une Cité sortie du chaos. La fixation sur une action ponctuelle mais globalisante (sorte d’autosuggestion rassurante) cultive les incertitudes d’une Cité parfaitement constituée, mais ayant toujours peur du chaos environnant. Avoir la perception d’agir sur une parcelle du monde n’est, hélas, pas comprendre et agir sur le monde tout entier. L’exemple de l’Iraq est significatif. L’intervention américaine se proposait comme but d’irradier un processus démocratique au « Moyen orient ». Or, comme le communisme d’antan, cet espace géographique est multiculturel, divers, contradictoire, et surtout en équilibre instable. Toutes les hypothèses quant à son évolution sont envisageables, sauf justement, le mimétisme.
L’entropie régnant sur nos outils de perception n’est pourtant pas une fatalité. Si Athéna, détentrice de la techné n’est plus là pour protéger les émancipateurs prométhéens, Hermès symbolise bien notre univers. Non pas en tant que porteur du message, mais comme l’annonciateur d’une multitude d’informations. Il y a en effet une différence entre l’accoutumance hypnotique à la télévision, l’Internet polyvalent, une photo satellite, ou un logiciel d’analyse dépendant de nos entrées ou celles d’un autre. En d’autres termes, comment s’émanciper de la subjectivité structurelle de la multiplicité des messages ? Comment faire la différence entre voir et savoir ? Comment hiérarchiser sans pour autant être pris dans la spirale d’une perception symbolique victime de l’insécabilité
« Connais toi toi-même »
La Grande-Bretagne est couverte d’une toile de vidéo - surveillance qui a l’ambition de couvrir l’ensemble de l’espace et des hommes. Cela n’a pas empêché les attentats terroristes. Mais cette toile, relayée par l’enquête policière et surtout par la télévision, a permis de
voir ce que l’on devait
savoir depuis longtemps : L’opposition entre Anglais, Galois ou Ecossais d’une part et
des citoyens britanniques issus des anciennes colonies de l’autre. Cette opposition, d’un ex-Empire marchand qui produit du
citoyen schizophrène sur un plan identitaire, prend aujourd’hui la forme du fondamentalisme. Mais, depuis Disraeli
[5], la politique d’intégration (avec ses adeptes et ses opposants), lévite autour d’une idéologie officielle qui fait du
concept de l’Empire le creuset de l’unification des classes et des sujets britanniques. Toute mutation de cet Empire, tout affaiblissement, tout excès, et enfin son entrée au sein du domaine de l’immatériel produisent, depuis le XIXe siècle,
des réactions, souvent violentes, comme c’est le cas aujourd’hui. Il s’agit là d’un exemple « d’Histoire longue », de ceux qui traversent les siècles, et restent insensibles aux aléas de la
perception ponctuelle et des actions qui s’en dégagent. L’exemple n’est pas pris au hasard : la Grande-Bretagne est un pays bien structuré, ayant pleinement conscience de son histoire et de ses traditions. Elle est aussi consciente de la complexité et de la stratification de sa société et des contradictions qui en découlent. Cependant elle n’échappe, ni à la
perception panique, ni au syndrome de l’
olos, ni à la
simplification, véhiculés par les médias et les professionnels précités qui gèrent l’ensemble de ces concepts.
Que dire alors des structures plus jeunes, moins structurées, et qui plus est doivent leur existence autant au pouvoir du politique qu’à la force du symbolique, comme c’est le cas de l’Union Européenne ? Pourtant, celle-ci est par excellence aujourd’hui, un outil de vérification. Un « client » privilégié pour les producteurs de l’information panique. Elle a la responsabilité ardue de faire la part des choses, de créer ses propres hiérarchies concernant la multiplicité des messages. Elle ne pourra cependant connaître le monde qu’en se connaissant elle-même. En prenant pleinement conscience de sa fragilité, de la multiplicité contradictoire de ses propres services (et de leur action), d’un tropisme globalisateur propre, qui parfois la paralyse. L’Union Européenne, pourra exploiter pleinement alors le fait qu’elle est le plus important fournisseur de sources d’intelligence ouvertes, qu’elle a pour vocation de les partager avec tous les pays - membres. En outre, et telle la Cité grecque, l’Union a un avantage sur les pays qui la composent (et les autres) : elle est issue du mythe, elle n’en cultive pas nécessairement des nouveaux. D’une certaine manière, ce manque d’un imaginaire justificateur pourrait lui permettre de voir le monde tel qu’il est, et non pas comme les pays membres le craignent ou le désirent.
Sa complexité institutionnelle, une fois intériorisée et rationalisée peut lui donner les outils propres à faire la part des choses entre une information panique et subjective et un regard lucide sur le monde. Comment ? En proposant le modèle d’un anti-empire qui assume le désordre global. En devenant le seul acteur mondial qui n’ajoute pas du désordre normatif. En acceptant que toute information est importante, non pas pour ce qu’elle véhicule mais par celui qui la véhicule. En s’attardant sur la nature des concepts et non pas sur ce qu’ils proposent dans leur vision panique du monde. En refusant l’olos comme objectif d’une démarche fragmentée[6] et en s’intéressant à la multiplicité de la réalité, qui est la nature même de ce « tout ».
L’espace fragmenté, le Temps variable
Dans une rencontre entre « spécialistes » sur l’Afghanistan et la production d’opium, on me posa la question « quel est l’aspect le plus criminogène » de ce pays. Je répondis, sans hésiter : la construction de nouvelles routes. Avant même de pacifier l’espace on le met en contact avec le reste du monde. Un monde basé sur la consommation et le désir de possession. On intègre ainsi une société enclavée, dépourvue de tout, et où tout devient désir. L’opium étant le seul produit de valeur, il ne servira plus à la survie des populations paysannes mais à l’assouvissement des désirs importés de toute la population. De surcroît la route facilitera l’accomplissement de cet échange et créera une nouvelle criminalité prédatrice, basée sur le
contrôle de la route. Quelques jours plus tard, à Madagascar, je fis l’analyse contraire : La prédation systématique du patrimoine minier de ce pays est basée sur l’éclatement du territoire, et la mise en place de baronnies féodales qui ont pendant trente ans détruit les voies de communication. Leur destruction a transformé les territoires en châteaux forts. Les reconstruire fait partie de la re-conquête de l’espace et de la lutte contre le crime organisé. Ainsi, en prenant ces deux exemples et selon leur réalité ambiante, la route, perçue en tant que telle, devrait être construite ou ne le devrait pas. Par contre la route, comme
symbole du progrès et de l’intégration, doit impérativement se construire. La différence n’est pas anodine : comme symbole du progrès, toute construction est comptabilisée, entre dans des statistiques, est considéré comme un
plus global par les bailleurs de fonds tels l’Union Européenne, la Banque Mondiale, l’ONU, etc., qui se simplifient ainsi la vie et énumèrent les résultats concernant les espaces « intégrés » par leur action. Ce simple exemple indique à quel point, la connaissance détaillée introduit des variantes multiples qui doivent s’imposer comme connaissance
avant l’action. Or, la complexité de fonctionnement d’une institution à vocation impériale -et sous peine de nécrose de son action-, l’oblige à « généraliser », à procéder par formules dites « modèles d’action », qu’elle énonce comme des
success stories. Dans ce cas, elle agit pour elle-même et non plus pour le destinataire de son action. Nier la nature multiple de l’espace où elle intervient lui permet de ne pas observer l’éclatement de son propre espace. Elle ajoute ainsi du désordre chez l’Autre, mais aussi en elle-même. Par contre, la négation de la notion de l’Empire qui soutient cette logique lui permettrait d’affiner son analyse, c’est-à-dire de voir l’espace comme un lieu d’action et de synergie et non pas d’une intégration modélisée
[7].
Si les organisations internationales agissent de bonne foi, elles sont soutenues par une idéologie globalisante (la dernière encore active) qui concerne « l’économie de marché » et qui supporte mal la nuance. Pendant vingt ans, la Banque Mondiale refusait toute approche positive sur l’économie informelle. Aujourd’hui, elle perçoit cette économie comme « un moteur innovant et positif ». Ce volte - face militant l’empêche aujourd’hui de considérer les relations entre l’informel et le criminel dont sont victimes une grande partie des pays du Sud et émergents qu’elle appuie. Or, si cette économie, désormais intégrée est gérable au sein des pays de l’Europe du sud -et qui ont longtemps souffert des critiques de l’institution avant d’être montrés comme exemple-, par contre, au sein des pays émergents (la Russie par exemple) elle est plutôt aspirée par des pratiques du crime organisé et produit des « oligarches » plutôt que du progrès économique. Encore une fois, le même fonctionnement a des effets différents et ne peut donc pas être modélisé
[8]. Le faire, c’est accentuer ses effets pervers chez l’autre, et renforcer un regard éclaté chez soi. On arrive ainsi, pour les institutions issues des accords de Bretton Woods, à considérer
en même temps et dans le même rapport que « financer les compagnies pétrolières dans les pays à risques contribue à juguler le désordre », et que « l’exploitation des sources énergétiques dans ces mêmes pays est un sérieux facteur d’instabilité »
[9]
À ma dernière visite à Téhéran, fin 2004, il était déjà question de l’approche « d’une crise du nucléaire », que, sur place, on analysait essentiellement comme un différent géopolitique opposant les Etats-Unis et l’Union Européenne. Cela ne concernait pas, d’après mes interlocuteurs, l’utilisation du programme civil nucléaire à des fins militaires mais l’irruption de l’Euro comme monnaie de référence pour les échanges d’hydrocarbures. Qu’il s’agissait d’un bras de fer non déclaré entre ces deux entités qui pourrait, pour la première fois dans l’histoire récente, mettre à nu le déficit structurel américain. Bien entendu, il ne s’agit pas ici de simplifier une approche portant sur un problème géopolitique majeur et complexe. Il ne s’agit pas non plus de sous-estimer le fait, que ce problème existe vraiment. Mais d’indiquer qu’un des protagonistes, l’Iran, soulève un aspect qui, en Europe, est absent des débats. Ce qui n’est pas le cas en ce qui concerne certains milieux nord-américains, qu’ils soient proches des néo-conservateurs ou des alter - mondialistes
[10]. Pourquoi ? À mon sens, aucune politique non -déclarée n’a vraiment des chances d’aboutir. L’Iran n’est pas
uniquement un pays de mollahs réactionnaires. Comparé aux pays du golfe, (et aux yeux de l’islam wahhabite), il est
moderne. C’est-à-dire qu’il peut intégrer l’autre et ses réalités. Donc jouer avec ses contradictions. Bref, c’est un acteur majeur dans notre monde et un des seuls pays musulmans où la théologie de
l’interprétation a un droit de cité.
Assumer et promouvoir la complexité
Dans un monde d’information ouverte, s’amputer d’une variable, c’est courir le risque d’être accusé de manipulation. En d’autres termes, l’information oblige. Le temps des empires coloniaux qui menaient des guerres lointaines loin du regard du reste du monde est définitivement révolu. Si l’espace s’est fragmenté au niveau de la perception, il est devenu audible, tout comme les analyses endogènes qui s’y produisent.
Cependant la confusion des temps, des espaces, des interrelations complexes entre eux, l’autonomie d’analyse nouvelle des périphéries, sont pratiquement occultés. Aussi bien par les administrations étatiques et la presse que par les organisations internationales.
En Europe, la perception devient celle d’une entité (l’Union Européenne) qui n’a pas à séduire, ni à se positionner, ni même à s’expliquer, il suffit qu’elle se montre. Ses relais de perception restent ceux d’un empire suiviste. Or, pour l’Union Européenne, l’essentiel ne doit pas être : qu’est-ce qu’on observe et avec quelle précision mais qui regarde et avec quelle intention. Intention de comprendre ou intention d’intégrer ? Si la question n’a pas de réponse, c’est qu’elle reste au mieux ouverte, au pire n’est pas posée. Il existe une autre hypothèse, plus proche de notre analyse. Des intérêts contradictoires et en relation complexe ont trouvé le moyen de s’entendre pour mettre en application un projet important (la construction européenne), mais chacun d’eux pour des raisons diverses, voire contradictoires. Ainsi, le regard de l’Union est un regard multiple, qui occulte ses différences en exhibant le plus petit dénominateur commun, celui d’une administration technocratique et tatillonne. Dans ce cas, le message qui passe est forcément brouillé et peut suggérer un gaspillage de moyens, investis pour glorifier le symbole d’un empire qui se cache
[11]. On rétorquera que la
communication a été livrée dans sa totalité par la Commission ou le Conseil. Et c’est sans doute exact. Il se pose alors le problème des relais : L’U.E a-t-elle tranché entre « information » et « communication », entre « expliquer » et « séduire » ? L’explication (même subjective) renforce l’autonomie, la communication, par contre, multiplie des relais autonomes ayant leur propre subjectivité analytique.
L’Union Européenne, comme « promoteur » de perspectives et de projets, comme alternative d’anti-empire, ne va pas de soi. Celle-ci doit donc cesser d’être un simple « client » de l’information panique et doit se convaincre d’entrer dans l’arène de l’information globale, comme producteur d’information et de perception complexes.
C’est à ce prix que la pérennité basée sur l’éphémère et la notion de crise pourra être contestée. En d’autres termes, pour produire de l’histoire et pas du mythe, il faut vendre de la complexité. C’est sans doute le sujet que l’Europe domine le mieux, mais qu’elle occulte à elle-même. Il est temps cependant d’en faire un de ses chevaux de bataille.
Effacer l’image, dépasser l’instant
Gérer et anticiper, plus simplement gouverner, est une affaire d’
eumetrie [12] : Se trouver à bonne distance du fait, des lieux et des hommes. Ne pas se précipiter, en réaction à l’image instantanée, ne pas perdre son temps non plus, en cultivant une complexité institutionnelle, des filtres successifs, des domaines de compétence, des frontières administratives, des pré-carrés. La subjectivité conjointe de l’information et de la perception exige le fonctionnement d’une
cuve commune active d’appréciation. Active parce que elle-même devrait être un producteur de perception permanente. Active aussi, parce que cette perception devrait être transmise en tant qu’information.
Un exemple de ce « retour de l’information » serait l’interprétation de la crise bolivienne. L’élection d’Evo Morales, paysan syndicaliste cocalero, à la présidence de la république, est généralement représentée comme un retour aux vieilles lunes d’une Amérique Latine au passé chargé de conflits sociaux et de mouvements de guérilla. Morales lui-même, et le département d’Etat américain participent à cette mise en images, cultivant de part et d’autre un discours belliqueux et anti-impérialiste. Or, le cadre dans lequel se place ce nouveau conflit fait l’impasse sur deux nouveaux aspects, à notre sens fondamentaux, et qui sont occultés par les agences d’information et les analystes. Le premier concerne la résurgence des frontières (en opposition à l’idéologie de la « Patria grande » drapeau des mouvements insurrectionnels des années 1960-1975). Ce retour en force du concept des frontières en Amérique Latine est le résultat de l’entrée du marché des hydrocarbures dans l’ère de la globalisation. D’où surviennent les conflits et les contestations en vue ? La plupart des pays ont des frontières considérées, -depuis les guerres dévastatrices du Paraguay, du Chaco et du Pacifique-, comme « indéterminées », lorsque celles-ci sont relativement inaccessibles (Andes, Amazonie). C’est une constante de l’Histoire longue, adossée à la tradition Bolivarienne d’une « Nation latino-américaine » utilisée comme outil idéologique à cette acceptation de fait. Or, et surtout en ce qui concerne l’acheminement du gaz, mais aussi certaines réserves importantes, la question de la frontière ressurgit. D’une part, des infrastructures importantes doivent se construire au sein de ces espaces « indéfinis », d’autre part, certains champs gaziers ou pétrolifères se situent à cheval entre plusieurs pays. Cette résurgence des frontières indique cependant, et c’est là la deuxième différence par rapport aux années précitées, des nouvelles capacités régionales d’émancipation. Cette « information » devrait anticiper une réflexion sur les effets de la globalisation sur la suprématie nord-américaine dans cette région, et mettre en avant l’essoufflement de celle-ci. Comme les routes, la globalisation n’est pas forcément négative et surtout elle n’est pas, en ce qui concerne l’Amérique Latine, synonyme de « l’impérialisme américain ». Bien au contraire. Au nom de la mondialisation et de l’internationalisation du marché le pré-carré américain est sérieusement contesté.
Cette réflexion qui introduit de la complexité géopolitique devrait trouver des relais pour entrer dans l’arène de l’information, tout en permettant un redéploiement politique effectué dans les faits déjà par les entreprises européennes spécialisées dans l’industrie des hydrocarbures et des travaux d’infrastructures (mais aussi chinoises, russes, canadiennes, japonaises, etc.)
Si la force de l’image et les habitudes perceptives restent invariables, si la fixation standardisée des concepts et des discours n’est pas contestée, c’est que l’information panique se fixe sur l’instant (élections iraquiennes), sur un espace rétréci (Afghanistan), sur des répétitions traumatiques (attentats) en leur donnant une valeur pérenne et universelle. C’est aussi parce que nous avons une interprétation cyclique et répétitive. Cela a comme résultat la mise en place d’outils et de politiques qui n’ont -éventuellement- d’effet que sur les matrices premières pour lesquelles ils ont été conçus. Ils sont cependant perçus comme agissant sur la globalité, sur un olos qui devient de la sorte imaginaire.
Cependant, pour citer Guy Debord, « l’époque ne demande pas seulement de répondre
vaguement à la question que faire ? , …il s’agit maintenant si l’on veut rester dans le courant, de répondre, presque chaque semaine à la question « Que se passe-t-il ? »
[13] En outre, cette question ne doit pas se fier aux analogies et aux standards d’une perception cyclique et routinière, mais au contraire, en tant que matrice première, gagner son autonomie par rapport à l’information panique et ses relais intéressés.
Ainsi, la contestation de la globalisation de l’information et de la standardisation de la perception exige une action sur les « sources » qui, pour être efficace, se doit de s’assumer en tant qu’acteur important de création et de perception d’une information autonome. L’Union Européenne devrait donc définir des moyens de perception et d’information et donner au reste du monde (mais aussi aux Etats Membres), sa propre vision du monde. Elle devrait aussi concevoir sa propre complexité, en tant que sujet d’information et comme ingénierie cohérente face aux autres systèmes de gouvernance. Non pas dans un souci obsédant de la promouvoir en tant que modèle mais comme garantie d’autonomie et d’indépendance d’analyse. Enfin, elle doit se penser comme distributeur de sa propre information, choisir de s’expliquer plutôt qu’espérer de se faire désirer. Comme entité et comme projet politique et culturel assumant la complexité.
[1] Où va la cocaïne en Europe ?, étude pour le compte de l’OEDT et de la MILDT,1997.
[2]La distinction entre la durée et le temps confère alors un nouvel éclairage à l’opposition classique entre un temps physique et un temps psychologique, car le temps façonné par la conscience imaginative produit des effets dans le monde jusqu’à être confondu avec la durée réelle des choses. Spinoza, Lettre XXII.
[3] Comme l’indique Jaques Ellul, la « société technicienne » - celle dans laquelle un système technicien est installé- tend de plus en plus à se confondre avec le « système technicien » : produit de la conjonction du phénomène technique caractérisé par l’autonomie, l’unicité ou l’insécabilité, l’universalité et la totalisation. In « Propagande et démocratie »,
Revue française de science politique, vol.2, n°3, juillet -septembre. 1952.
[4] Encore un exemple de ce théâtre du processus d’intégration : Au Cambodge, des dizaines de réunions et plus de quatre années de négociations avec l’UNODC, n’ont pas encore abouti à l’amendement d’un article de la loi anti-drogues qui prévoit de remplacer la phrase suivante « …une amende
et / ou une peine de prison… » par une autre qui enlève le « ou » : « …une amende
et une peine de prison ».
[5] Discours de Manchester et Crystal Palace en 1872
[6] D’après Raymon Panikkar, cette démarche (prendre un fait pour universel) est un « virus venant du Nominalisme et encore d’avant ; c’est une croyance selon laquelle en connaissant les parties on connaîtra le tout, et que pour connaître nous devons nous spécialiser dans quelque chose. Ainsi commence la fragmentation de la connaissance qui conduit à la schizophrénie du connaissant ». ITV donné à Jordi Saval (Classica) Décembre 2000.
[7] Sans vouloir entrer dans la polémique de l’intégration de la Turquie, car ce texte parle des moyens et pas des objectifs, une
vision d’action qui concernerait ce pays le verrait tel qu’il est, formaté par son histoire propre, sa culture, ses capacités et ses impossibilités. Une
logique d’intégration exige par contre et au préalable, la destruction des structures kémalistes mises en place pour atteindre, par la force, l’image de notre propre modèle. Ainsi, la contradiction entre ces deux logiques s’énonce clairement : l’exigence de mise en cause d’un modèle de démocratie
formelle suppose une
prise de risques calculée de notre part concernant les
risques potentiels inhérents à une
démocratie réelle chez l’Autre[7]. En assumant cela on comprend mieux pourquoi, les secteurs les plus modernistes de la société civile turque s’accommodent parfaitement d’une armée omniprésente autoritaire et laïque, mais
aussi d’un parti religieux aux assises fondamentalistes.
[8] Voir : Klitgaard, R.,
Controlling Corruption, Berkeley/Los Angeles : University of California Press, 1988
[9] Leite, C., Weidman, J., Does Mother Nature Corrupt ? Natural Resources, Corruption and Economic Growth, IMF Working Paper 2003
[10] Voir William Clark : The Real Reasons why Iran is the Next Target. The Emerging Euro-denominated International Oil Marker, Septembre 2004, in GlobalResearch
[11] D’où le renforcement des positions eurosceptiques, voire europhobes.
[12] Lire Michel Onfray, La sculpture de soi, Grasset, 1991.
[13] Correspondance, Volume 5. Fayard 2005