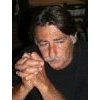2. L’identité des trafiquants : les « circuits courts »
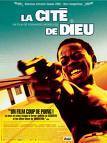
A ses débuts, il s’agissait de la multiplication de transporteurs individuels (ou appuyés sur des réseaux ethniques rudimentaires) qui, une ou deux fois transportaient au maximum un kilo, de quoi pouvoir créer un capital de survie dans leur nouvelle vie. Il ne faut pas oublier qu’à l’époque une série de conflits (Caucase, Balkans, Turquie, etc.) avait jeté sur les routes des milliers de réfugiés, tandis que la drogue finançait ces mêmes conflits. (Pour plus d’informations : J.C Ruffin. L’empire et les nouveaux barbares. J.C. Lattès, 1991).
En fait, notre jeune Kurde n’avait aucune idée du prix de l’héro. Il avait acheté son kilo à Istanbul (2000 dollars) et le revendait en doublant sa mise. Le problème (mais ce n’était qu’un début) c’est qu’il y avait des milliers de gens comme lui. J’ai même rencontré un dentiste albanais qui vendait « son kilo » en Allemagne pour installer son cabinet dentaire à Tirana. Les effets de cette « mutation démocratique » se sont tout de suite fait sentir : à la fin des années 1990, les kosovars constituaient la majorité des incarcérés pour trafic de drogue dans les prisons suisses, tout comme les arméniens (de l’Arménie ex - soviétique) des prisons californiennes.
La guerre des clans mafieux turcs par partis politiques interposés (et vice-versa), la guerre sale du gouvernement Tciller à l’intérieur et à l’extérieur de la Turquie (Roumanie, Hongrie, Bulgarie, Azerbaïdjan, Arménie, Géorgie) contre les réseaux kurdes et alevis, avaient déstabilisé l’étanchéité légendaire de la « route des Balkans ». Ils ont ouvert une brèche pour des réseaux balkaniques et caucasiens qui, cependant, se fournissaient toujours en Turquie. (Pour plus d’informations : “L’économie mafieuse en Méditerranée Orientale” in Evaluer la menace terroriste et criminelle, Culture et conflits, Paris, 2002.)
Ce système de « trafic individuel » prouvant son efficacité a contribué à une mutation de taille dans les habitudes contrebandières. Les grandes organisations trafiquantes, déstabilisées dans un premier temps, ont repris au début des années 2000 le procédé à leur compte : Au lieu d’acheminer jusqu’au client la marchandise, ils fixèrent des labos et des stocks à la périphérie (Roumanie, Bulgarie, etc.) limitant les risques tout en augmentant (raisonnablement) les prix du demi-gros.
En ce qui concerne la cocaïne, des causes différentes ont abouti aux mêmes effets. La destruction des deux cartels historiques (Cali et Madelin) la mise en combat des réseau Noriega, allaient de pair avec un processus qui avait commencé pendant les années 1980 : la Colombie étant devenue autosuffisante en production de coca, elle n’avait plus besoin de Pérou et de la Bolivie. Du coût, ces deux pays écoulèrent leur production de manière autonome, faisant du Brésil frontalier leur voie principale. Or, ce dernier utilisa dès le début des années 1990 les pays africains lusophones (Angola, Mozambique, Cap Vert) comme lieu de stockage et de réacheminement. Ces trois pays étaient en guerre, c’était des espaces de non droit, demandeurs de fonds et d’armes, et côtoyaient des pays, eux aussi en guerre mais surtout grands producteurs de diamants. Enfin, le Nigéria pays entropique par excellence et les réseaux mourides des pays du Golfe du Gabon, offraient la main d’œuvre et les voies d’acheminement et de pénétration au sein des pays consommateurs. (Pour plus d’informations : A.G. Camacho : Drogua, corruption y poder. Universidad del Valle, 1981 ; A. Rayes Posada : La violencia y la expancion territorial del narcotrafico, Bogota Ed . Uniandes/CEREC, 1990)
Les réseaux colombiens ont de leur côté utilisé le Mexique comme voie de pénétration par excellence, faisant de ce pays le royaume des cartels mexicains.
Ainsi, le trafic de cocaïne et d’héroïne, concentré et contrôlé jusque là, a explosé à partir des années 2000, d’autant plus que les nouveaux opérateurs payaient les passeurs en nature : ainsi non seulement les réseaux se sont multipliés à l’infini, mais aussi la consommation a explosé aux lieux de passage (Macédoine, Albanie, Bulgarie, Brésil, Mexique, Caraïbes, Angola, Mozambique, Sierra Leone, Côte d’Ivoire, etc.).
En espace de vingt ans il y a eu une continentalisation du processus drogues en l’Amérique Latine et en Afrique ne laissant aucun pays hors circuit.
Les circuits courts on ainsi imprimé leur identité sur les structures mafieuses traditionnelles, tandis que de nouveaux opérateurs, plus liés à l’économie financière et formelle pointaient et que les drogues de synthèse permettaient enfin à des organisations criminelles locales d’installer leurs laboratoires à la porte d’à côté du consommateur… A suivre.
6 réactions à cet article
Ajouter une réaction
Pour réagir, identifiez-vous avec votre login / mot de passe, en haut à droite de cette page
Si vous n'avez pas de login / mot de passe, vous devez vous inscrire ici.
FAIRE UN DON








 Je viens juste de comprendre....
Je viens juste de comprendre....