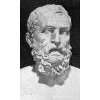L’Inde réfrène ses musulmans. Divorcer sur Whatsapp en quelques clics, une pratique islamique pratique
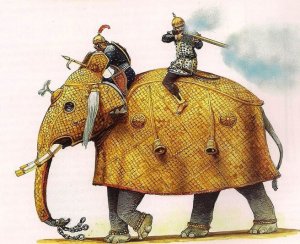
Avec trois « talaq » je te plaque. Les temps devenaient durs pour les musulmanes en Inde, on les répudiait en quelques claquements de doigts sur son smartphone, avec Skype on se quittait aussi, des sms effaçaient les promesses… L’islam n’est pas tendre avec les femmes.
Considérant que "Le triple talaq enfreint le Coran et la charia. Il ne fait pas partie des pratiques religieuses et va à l'encontre de la moralité constitutionnelle", la Cour suprême indienne s’est opposée au "triple talaq", cette dérive musulmane qui autorisait l’homme à répudier sa femme en prononçant trois fois la formule ad-hoc et qui jusque-là était admise dans son expression expresse via internet. La formule indienne, ne s’embarrassait même plus des deux témoins évoqués dans la sourate 65. Probablement au motif suffisant de la sourate 2.228 qui explique que « … les hommes ont une prédominance sur elles »
Ces mœurs sont à considérer à la lumière d’autres usages islamiques qui codifient les comportements des musulmans avec les femmes, comme le contrat de mariage al-mut‘a à durée déterminée chez les chiites dit « de jouissance, de plaisir » ou muwaqqat « provisoire », entre un homme marié ou non et une femme non mariée. Les mariages musulmans sont des contrats, pas des sacrements.
Conscient que l’interdiction de ce divorce immédiat allait déplaire à près de 100 millions d’individus hommes représentant la moitié des musulmans indiens, le Parlement a procédé avec prudence, les autres formes de répudiation un peu moins brutales restent autorisées. Car cette interdiction ne plaisait pas à tout le monde si l’on en juge par l’acceptation de la mesure par seulement trois communautés religieuses indiennes sur cinq (hindouisme, zoroastrisme, christianisme, sikhisme et islam).
La laïcité indienne place toutes les religions à égalité mais, comme le Royaume Uni qui forme des juges pour ses tribunaux islamiques, le droit s’adapte encore à la religion de chacun.
L’Inde envisageait cependant depuis quelques temps déjà de reconsidérer ces singularités pour un « pays laïc », avec le remaniement de son Code civil qui remettrait les droits à l’endroit. Le train de la transformation de leurs habitudes de vie semble donc en marche pour les musulmans où depuis 1987 le droit religieux (émanation de la charia) s’imposait au droit civil pour les affaires de mariage, d’héritage et de divorce...
Mais ces évolutions culturelles ne passent pas sans grincements. L’Inde et son Parlement sont sur la sellette un peu partout à propos du vote d’une loi sur la citoyenneté car discriminant les réfugiés musulmans.
Récemment, le 11 décembre dernier, ils n’y sont pas allés avec le dos de la cuillère. Profitant de son large succès aux dernières élections, le parti hindou de Narendra Modi (ancien petit vendeur de thé à la sauvette dans une gare) met en cohérence ses actes avec ses promesses électorales « nationalistes » d’où les remous avec le « Citizenship Amendment Act » qui accorde la nationalité indienne aux persécutés hindous, chrétiens, bouddhistes, jaïnistes, parsis et sikhs d’Afghanistan, du Pakistan ou du Bangladesh, entrés en Inde avant 2015. Mais qui exclut les musulmans.
Les mêmes musulmans indiens, qui contorsionnent la laïcité en bénéficiant du droit particulier à juger pour eux avec la charia, invoque cette fois l’application sans concession de la laïcité constitutionnelle pour réfuter cette nouvelle loi.
La réplique indienne à ses voisins musulmans s’éclaire si on mesure leur nettoyage religieux. Il ne reste qu’un peu plus de 3% d’hindous et de chrétiens au Pakistan, et en Afghanistan où on a presque fini l’épuration, les non-musulmans représentent moins de 1%. Ces deux pays sont classés par l’ONG Portes Ouvertes, respectivement 2e et 5e des pays persécuteurs des chrétiens dans le monde. D’évidence, les hindous n’y ont pas échappé.
Quant au Bengladesh ou l’islam est la religion d’Etat, les hindous discriminés ne représentent plus que 15% de la population et fuient le pays.
En France, ici et là dans notre presse on décèle un soupçon de distance envers ces nationalistes hindous au pouvoir qui envisagent depuis plusieurs années de revoir leur relation avec leurs musulmans. Les commentaires soulignent la digression constitutionnelle du gouvernement indien encore laïc et l’opposition musulmane qui s’est levée, sans expliquer le contexte avec ses voisins musulmans, ni rappeler qu’il s’agissait d’une mesure phare du BJP le parti largement réélu, ni parler des soutiens à sa mise en œuvre qui se sont réunis par dizaines de milliers dans le nord-est et dans le sud du pays. On regrettera les oppositions violentes, les lynchages de musulmans rappellent, comme les motifs, ceux des Rohingyas au Myanmar (Birmanie).
Ces manifestants réveillent une conception du début du XXe s. l’Hindutva de l’indépendantiste Savarkar, une idéologie qui protègerait la culture indienne (donc hindoue) contre celles politiques et religieuses de l’étranger. Comme les chinois du XVIe s. qui avaient entièrement détruit leur immense flotte pour se protéger des influences étrangères et Xi Jinping qui veut adapter la Bible de ses 10 millions de chinois chrétiens pour protéger son communisme, le Japon qui a dressé de nombreuses frontières protectrices, l’Arabie Saoudite qui est enfermée dans son carcan religieux, l’Iran, Israël… Quant à l’Europe elle commence à se rappeler que sa culture est d’origine romaine, chrétienne et grecque.
L’Inde n’est pas la première à vouloir enjamber la laïcité pour protéger son identité et ne compte pas s’arrêter là. Elle envisage de redéfinir sa nation avec les critères de l’UNESCO qui garantissent la cohésion sociale : « Ensemble des traits distinctifs spirituels et matériels, intellectuels et affectifs qui caractérisent une société ou un groupe social, englobant outre les arts et les lettres, les modes de vie, les façons de vivre ensemble, les systèmes de valeurs, les traditions et les croyances ». La nation indienne et la population hindoue devant se confondre.
Pour y arriver un vaste programme d’identification a été mis en place avec le Registre National des Citoyens qui a pour effet de déceler les immigrés illégaux ; dans le seul Etat d’Assam près de deux millions d’individus, incapables de prouver leur arrivée légale en Inde avant 1971 (guerre d’indépendance du Bengladesh), deviennent de facto apatrides. Près de la frontière des bengalais musulmans immigrés illégaux sont discriminés…
L’empire britannique avait pourtant bien pris soin de séparer les populations en fonction de leur religion avant d’abandonner sa colonie du sous-continent en organisant « … le déplacement de 12 millions d’individus », l’Inde regroupait les territoires des hindouistes et le Pakistan ceux des musulmans. Le transfert laissa en Inde des musulmans (10% de la population) qui ne s’intégreront pas plus ici qu’ailleurs. Des conflits éclatèrent sous différents prétextes comme en 1920 pour défendre le statut de Calife du Sultan ottoman contre des hindous… non concernés.
Pour régler les difficultés indiennes, le prédicateur Zakir Naïk (interdit de séjour même au Bengladesh), a proposé la solution « si vous êtes un bon hindou vous devez croire dans Mahomet… ».
17 réactions à cet article
Ajouter une réaction
Pour réagir, identifiez-vous avec votre login / mot de passe, en haut à droite de cette page
Si vous n'avez pas de login / mot de passe, vous devez vous inscrire ici.
FAIRE UN DON