La bonne intention de madame Guigou
Lorsque j’ai pris connaissance de la loi du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d’innocence et les droits des victimes, dite loi Guigou, son essence me paraissait éminemment positive. Quoi de plus positif, en effet, que de marteler qu’un individu n’est pas pénalement coupable sans avoir été condamné, que le juge d’instruction « instruit à charge et à décharge », etc. ? Tout cela est positif, dans l’intention, j’en suis intimement convaincu. Là où le bat blesse terriblement, malheureusement, c’est au stade de la mise en oeuvre de ces beaux principes.
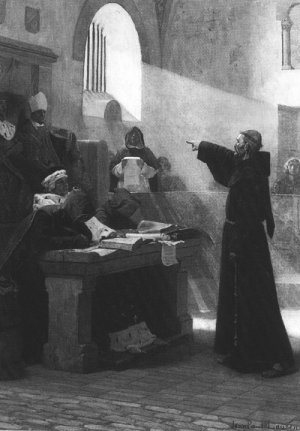
Tout d’abord, on a commis des erreurs évidentes dans la forme même de la loi (source). Ainsi, on s’explique très mal qu’une loi devant renforcer la présomption d’innocence emploie, à plusieurs reprises, l’expression « indice faisant présumer qu’elles ont commis ou tenté de commettre une infraction », contredisant frontalement le principe au coeur de la loi. Bonne intention ; mais quelle inattention ! Cette erreur de forme masque mal le fait qu’un lourd questionnement de fond, sur le sens du soupçon et son poids dans la procédure, fait défaut. J’ai déjà abordé la question (lien), je ne m’étends point.
Ensuite, on a fait des erreurs proprement démentes dans la pratique. Par exemple, il est indéniablement bon de permettre à des individus de comparaître libres, si on estime que rien ne requiert qu’ils soient placés en détention entre les audiences, le temps du procès. Ainsi, il était judicieux de restreindre les conditions de recours à l’ordonnance de prise de corps au moment du procès. Mais dans la pratique, sauf erreur de ma part, les accusés qui ne font pas l’objet d’une ordonnance de prise de corps, qui comparaissent libres, ne vont pas dans le box des accusés. C’est comme si on hurlait aux jurés que certains des accusés de la session sont des furieux que l’on estime devoir enfermer dans le box, et que d’autres sont des anges à qui l’on peut donner un traitement de faveur. En d’autres termes, au nom du respect de la présomption d’innocence, on invite les jurés à se faire des idées nettes sur la dangerosité de l’accusé avant même que les auditions ne commencent.
Finalement, qui oserait se plaindre que « toute personne condamnée (ait) le droit de faire examiner sa condamnation par une autre juridiction » ? C’est le bon sens même, les condamnations d’assises peuvent être si lourdes qu’il faut s’offrir le luxe de s’interdire l’erreur, de croire l’erreur possible. Comme de nombreuses affaires nous l’ont révélé, une cour peut se tromper, c’est trop que de tout remettre entre ses mains. Mais, en même temps, quelle valeur donnons-nous au premier degré de la juridiction de jugement, s’il faut admettre que l’appel se systématise ? Pourquoi ne pas faire d’emblée deux procès, puisque l’un compte de facto pour du beurre ? Là aussi, il me semble qu’il y a un oubli forcément néfaste pour le fonctionnement de la Justice : plus d’appels signifie plus de procès, de plus longs délais, ce qui est au désavantage de tous, parties civiles et accusés. Il n’aurait pourtant pas été si complexe de trouver une solution ménageant la chèvre et le chou : en cas d’appel interjeté en premier par le condamné, on aurait pu prévoir que si le condamné est à nouveau reconnu coupable, il y ait une sanction supplémentaire automatique (peine de sûreté plus longue, ou peine aggravée). Là, au lieu de donner une prime au condamné qui ne reconnaît pas ses torts, on sanctionnerait celui-ci, tout en conservant largement la porte ouverte à l’innocent victime d’une erreur.
Certes, certains argueront que certains jurés pourront être tentés de déclarer des coupables innocents par simple refus d’une aggravation de la sanction. Mais dans ce cas-là, ils devraient assumer le fait d’avoir ôté toute peine en déclarant innocent, et ainsi trahi la tâche qui leur était confiée par la nation. Etre juré d’assises est assurément une question de conscience. Certes, d’autres argueront que cela briserait l’idée que le second degré de juridiction est un nouveau procès ex nihilo. Mais ce principe est déjà très relatif, puisqu’on admet que l’appel puisse ne porter que sur une partie d’un jugement, selon qu’il est interjeté par telle ou telle partie.
Voici quelques exemples de méfaits involontaires de la bonne intention de madame Guigou. Elle avait assurément raison d’agir, de faire quelque chose, de vouloir s’attaquer à ces problèmes. Il est dommage pourtant qu’on ne puisse franchement pas dire que sa loi soit bonne, puisqu’elle crée ou aggrave autant de problèmes qu’elle n’en résout.
En ce sens, je ne suis pas tout à fait surpris de l’entendre aujourd’hui parler de « l’idée fixe de la droite de punir les juges » (source). Celle qui a fait préciser dans le Code de procédure pénale que le juge d’instruction « instruit à charge et à décharge » refuse que l’on sanctionne le juge qui ignore cette loi, poussant à la décrépitude une institution censée réguler la société, au prétexte que celle-ci aurait légitimité à se placer hors de ses propres règles, en plus des règles constitutives de la France (« La Société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration »). S’il n’y a pas de faute disciplinaire commise par Burgaud, alors que tout le monde s’accorde à dire qu’il a instruit à charge, c’est évidemment que les règles disciplinaires ignorent le Code de procédure pénale. Comment peut-on s’en féliciter ? Comment peut-on attendre de la Justice qu’elle soit respectueuse des citoyens, lorsqu’on refuse l’idée de faire appliquer les lois que l’on fait rédiger soi-même ?
1 réactions à cet article
Ajouter une réaction
Pour réagir, identifiez-vous avec votre login / mot de passe, en haut à droite de cette page
Si vous n'avez pas de login / mot de passe, vous devez vous inscrire ici.
FAIRE UN DON








