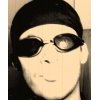L’Europe s’engage dans une austérité généralisée, tout sauf propice à résorber la crise issue des milieux financiers. Qu’est-ce qui conduit nos « élites » à se fourvoyer aussi pitoyablement ?
Bien plus que l’épouvantail protectionniste, ce sont les politiques à courte vue d’austérité des années 30 qui ont conduit le monde à une paupérisation toujours plus profonde et propice aux rancoeurs les plus simplistes. On sait ce qu’il en a résulté en Europe : nationalisme, conservatisme, xénophobie, massacres en masse.
Est-ce si loin dans l’histoire pour que l’on ne soit plus en mesure de constater que l’on se dirige tout droit dans le même gouffre ? Faut-il que nos "élites" fussent de si francs ahuris pour rééditer les mêmes erreurs qui ont conduit à la barbarie suprême ?
Il y a quelque chose de tragiquement fascinant de relever chaque jour dans le Figaro ou dans le Monde (sans que ces titres n’invitent à un tel niveau de réflexion) la manière avec laquelle ceux que l’on considère hâtivement comme la frange intellectuelle la plus haute nous conduisent inexorablement au désastre. Qu’est-ce qui empêche ces êtres, pourtant éduqués dans les supposées "meilleures écoles", à s’avérer à même de comprendre que le mécanisme d’austérité dans lequel ils engagent nos sociétés n’a, en toute rigueur, aucune valeur scientifique, tant d’un point de vue historique qu’économique ?
Coupes dans les salaires, dans les retraites, dans les indemnités chômage, mise en charpie générale du matelas social dont les vertus contracycliques sont à la portée de n’importe quel élève de terminal ES : alors qu’un temps (certes très court, avant que les cerveaux de nos éditocrates retrouvent leur général état de bouillie intellectuelle) on vit certains médias parmi les plus libéraux relever que le modèle social français s’avérait beaucoup plus efficace pour parer les effets les plus dramatiques d’une crise économique, il n’est plus aucune rédaction (ou presque) qui n’appelle pas à la nécessité de se serrer la ceinture, de sacrifier les acquis archaïques d’une époque illuminée où le partage des richesses ne relevait pas de la franche tartuferie. Un langage que l’on croyait condamné après le choc de l’automne 2008, dont tout le monde semblait s’être subitement désolidarisé, et qui revient plus sûr de lui et arrogant.
"On vit plus longtemps donc il faut travailler plus longtemps." Les "grands esprits" qui balancent ce type de truismes sont-ils au courant que toute l’histoire de l’humanité va dans le sens contraire, ont-ils même une idée du concept de "gains de productivité", qui supposent justement qu’à temps égal les richesses produites sont bien plus importantes et porteuses de progrès social, si tant est qu’elles fassent l’objet d’une juste redistribution ? Visiblement non. Ou bien cela confine à la bêtise la plus incurable, ou bien - et plus sûrement - il s’agit là d’entériner et d’approfondir la cupidité d’une classe minuscule de rentiers et de parasites, aux dépens de l’immense majorité.
Fondamentalement, pourquoi la France ne semble aujourd’hui avoir à sa tête que des illuminés, gavés des litanies de l’ultra-libéralisme et incapables (ou bien ce sont des cyniques) de la moindre prise de distance ? Lagarde, Woerth, Bertrand, Strauss-Kahn, Sarkozy (et tant d’autres) : qui pour sauver l’autre ? Qui pour prouver que l’éducation supérieure qu’ils sont supposés avoir reçue ne relève pas seulement du mythe auto-entretenu ?
En vérité la remise en cause est profonde. Si l’on creuse suffisamment, on constate qu’il s’agit aussi d’interroger les critères d’élection qui ont mené à une telle faillite, si évidente, de nos élites (mais est-elle franchement nouvelle ?). Qui avantage-t-on le plus ? Celui qui sait apprendre, réciter, maîtriser les éléments de méthodologie les plus porteurs dans une copie d’examen. L’esprit sûr de lui, confiant dans les formes qu’on lui a enseignées pour présenter ses "idées", parfaitement au fait des ficelles qui font gagner des points dans les concours. Une hexis sans cesse poussée à intérioriser sa perfection sans en interroger l’artificialité. Mais au-delà de cette culture de vernis - de cette culture utilitariste - que reste-t-il pour le doute, pour la remise en cause ? Comment un tel être peut-il comprendre qu’à vingt ans, on a tout juste les bases pour repérer les discours les plus biaisés et faux, qu’il reste tout à apprendre et que jusqu’au bout ses idées les plus ancrées doivent être interrogées ? Faut-il être surpris dès lors que, alors que la théorie libérale a montré empiriquement sa faillite absolue (et pas qu’une fois), l’on ait encore autant de fous furieux, à la tête des plus hautes institutions nationales et européennes, pour nous seriner le même pitoyable message qui, moins d’un siècle auparavant, conduisait l’humanité entière à l’une de ses faillites les plus effroyables.









 . Comme ce Woerth pris la main dans le pot de confiture mais que ce n’est pô grave vu que le consensus merdiatique n’y voit rien que de très humain...
. Comme ce Woerth pris la main dans le pot de confiture mais que ce n’est pô grave vu que le consensus merdiatique n’y voit rien que de très humain...