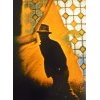La liberté d’expression artistique en danger !
Le tweet de Richard Ferrand à propos de la couverture de l'hebdomadaire M monde présentant Macron en noir et blanc sur fond blanc et rouge a provoqué l'ire de la « majorité ». Le directeur de rédaction de se justifier : « La couverture de M le magazine du Monde datée du samedi 29 décembre a provoqué des réactions critiques de certains de nos lecteurs. Nous présentons nos excuses à ceux qui ont été choqués par des intentions graphiques qui ne correspondent évidemment en rien aux reproches qui nous sont adressés. (...) Les éléments utilisés faisaient référence au graphisme des constructivistes russes au début du XXe siècle, lesquels utilisaient le noir et le rouge ». Rien à voir avec la réappropriation des codes de l'iconographie nazie.

Il faut attendre 1491 pour qu'apparaisse la première image imprimée sur support papier. L'affiche commence à se répandre au XVI° siècle, François I° s'en réserve la primauté (édit du 13 novembre 1539), laissant l'usage des enseignes aux marchands. Les édits de 1652 et 1653 limitent la liberté d'affichage, ce dernier devient clandestin. Au XVIII°, la gravure sur cuivre se généralise et la couleur procède une identification rapide : le jaune pour l'Opéra, le rouge pour la maison de Bourgogne, etc. La profession de colleur d'affiches est réglementée, chaque affiche doit porter l'autorisation du lieutenant de police et un exemplaire avoir été déposé à la chambre des libraires et imprimeurs. Le colleur doit savoir lire et être porteur d'une plaque l'identifiant. L'invention de la lithographie (en N&B) et l'avènement de la révolution vont contribuer à la multiplicité des placards et des affiches.
L'affiche en couleur apparaît avec la monarchie de Juillet (1830), clichage sur bois ou sur zinc colorié au pochoir collé sur fond typographié. Des affiches grand format (280 x 138) sont placardées sur les murs de la capitale (1845). La loi du 29 juillet 1881 proclame la liberté de l'affichage. Les murs deviennent une source de revenus. La ville de Paris met les siens en adjudication ! Les sociétés d'affichage prospèrent, les formats sont standardisés selon le multiple de 1,10 x 0,70 (format Aigle), l'affichage devient envahissant. Une centaine de colleurs suffit à couvrir toutes les palissades et tous les murs parisiens. L'affiche prend une nouvelle dimension lors de la Première Guerre mondiale. Il ne s'agit plus de réclame ou de placards officiels, il faut transmettre un message puissant et patriotique à la population.
La Grande Guerre terminée, Lénine lance la propagande par l'art. Les artistes (les futuristes et les constructivistes) se muent en propagandistes. L'affiche devient une forme d'expression dramatisée qui se doit de marquer les esprits. L'association des jeunes artistes soviétiques annonce les théories du Bauhaus allemand (1919). « Le constructivisme est une fenêtre sur le monde contemporain, l'art éternel n'existe pas. Tout est sujet à changement, la vie constructiviste est l'art du futur ». Ce courant d'idées va se répandre à travers l'Europe, Cassandre, Coolin et Bernard, en France.
Les groupes Styjl et Bauhaus vont être à la base de la communication visuelle contemporaine. Le Styjl repose sur des lignes verticales et horizontales, des formes géométriques colorées et une typographie très épurée groupée en blocs. Aucun souci des fioritures (1931), l'affiche est ramenée à sa fonction première. Un « cri » qui interpelle le quidam. « On commençait à prendre en compte le fait que la forme, la taille, la couleur et l'aménagement du matériel typographique (lettres et signes) possèdent un fort impact visuel. (...) La typographie est un moyen de communication : elle doit être une communication claire, convaincante » (Mohody-Nagy). Le Bauhaus ferme ses portes avec l'avènement du nazisme (1933).
En France occupée, deux nouvelles générations de graphistes font leur apparition. Les uns font de la propagande collaborationniste tandis que d'autres optent pour la résistance à l'envahisseur. Le gouvernement - les fonctionnaires - la police - la gendarmerie - le personnel pénitentiaire - la justice sont sous la coupe de l'envahisseur... Cette chaîne citoyenne, si peu fraternelle, va participer au pire et contribuer à jeter, à jamais, l'opprobre sur ces corps ! Être surpris à imprimer - coller - transporter - distribuer des tracts ou des affiches mène à la mort ! La simplicité du graphisme et la subtilité du message priment sur la composition graphique. La couleur noire, couleur de mort, le rouge celle du sang et de la colère, parfois sur fond bis (comme le pain rationné) en attestent. La guerre terminée, les affiches publicitaires vont bouleverser l'affichage commercial, contribuer à la consommation et à la relance de l'économie.
Mai 68 est un coup de tonnerre. Les années cinquante ont été marquées par la radio et les années soixante par les débuts de l'audiovisuel. On oublie souvent que Mai 68 fut précédé de la lutte « provotarienne » apparue en Hollande. Les agitateurs hollandais, ancêtres des ultras et autres black bloks, feront du 10 mars la journée de l'Anarchie. Le mouvement « provo » a ouvert la voie de la revendication et celle des stations radio-pirates. En mai, les affiches, véritables « outils de propagande » imprimées dans les ateliers Populaires des Beaux-Arts font appel à des moyens techniques tombés dans la désuétude : lithographie - pochoir - sérigraphie - gravure linoleum. L'affiche soutient le mouvement contestataire : « La chienlit c'est lui » - « CRS SS » (affiche qui montre un CRS brandissant une matraque) - « l'imagination au pouvoir », etc., sont distribuées à des milliers d'exemplaires. Les journaux muraux informent la population des abus policiers.
Le domaine politico-artistique a changé le rapport à l'autre et l'association des couleurs participe à l'expression artistique. Ces couleurs (le noir et le blanc ne sont pas à proprement parlé des couleurs) adoptées par le Parti national socialiste des travailleurs allemands (NSDAP) correspondaient au drapeau noir et blanc de la Prusse, et à celui blanc et rouge de la Ligue hanséatique, couleurs qui puisent leur signification dans l'héraldisme (sable pour le noir - gueule le rouge - argent pour le blanc). L'association du noir, blanc et rouge est sans conteste la plus ancienne, elle remonte à l'antiquité, et on la retrouve au Moyen-Age sur les étendards templiers (baussant & gonfanon). Le vert, le jaune et le bleu n'apparaissant qu'au XI° siècle.
Les couleurs sont déterminées selon des critères chromatiques et celui de visibilité qui va du blanc au noir, le jaune étant la couleur la plus lumineuse. L'association percutante noir, blanc et rouge n'est pas propre au nazisme, elle se retrouve au KDP (parti communiste allemand), au SPD (parti antifasciste) et à la SFIO (trois flèches noires sur fond rouge) de 1936, et dans la signalétique Vigipirate ! Le rouge dramatise en créant un climat de tension, symbolise la colère (Les Stylos rouges), mais est utilisé en art graphique pour se superposer aux couleurs « fuyantes » afin de délivrer un semblant de perspective. C'est le thème central de l'affiche qui fait la différence. L'édition française du magazine allemand, Signal, reprenait ces mêmes couleurs (la bichromie a un coût moindre que la tri ou quadri) pour véhiculer un message destiné à influencer l'opinion de la population occupée.
La couverture d'un magasine se doit de surprendre et d'interpeller un public dépourvu de toute culture des arts appliqués, R. Ferrand en reste l'illustration parfaite. Il a une lecture et une compréhension réductrices des codes graphiques qu'il réinterprète à sa guise. Il n'aura pas échappé aux lecteurs que nous sommes en présence d'un photomontage. L'« association de plusieurs images produit une autre image qui permet d'accéder à une autre signification (J-M Verret) ». Richard Ferrand a juxtaposé deux photographies ne se ressemblant que très vaguement et ne respectant pas les mêmes proportions. La première représente Hitler en « plan poitrine », la seconde Macron en « gros plan ». La lecture de gauche à droite n'est pas neutre, elle induit une association d'idée. « Si je rassemble des documents photographiques et que je les dispose face à face intelligemment et habilement, ils exerceront sur les masses un effet énorme de propagande et d'agitation » (John Heartfield). L'agitateur Richard Ferrand a-t-il été l'objet d'une vision stéréotypée ou d'un fantasme en interprétant ce qu'il voulait y voir, ou a-t-il contribuer à ébruiter un message subliminal de la personnalité du président ? A moins que son esprit soit le siège d'une projection nauséabonde au point d'en interpréter les codes visuels en référence au nazisme ? Hitler symbolise la folie et l'effroi à lui seul.
N'ont-ils pas compris, ces idolâtres qui se prosternent devant frau Merkel, l'effet épouvantail qu'ils inspirent à une certaine partie de la population ? Leurs Tweets ont des effets plus dévastateurs que la couverture de l'hebdomadaire M.monde. R. Ferrand et Gérald Darmanin (les chemises brunes) pensaient-il marquer le point Godwin ou contrer le slogan « CRS SS » en retournant la sémantique (la relation du signifiant au signifié) ? Les deux font une belle paire..., double insulte à l'égard de l'ensemble de la population française et à nos aïeux qui ont souffert de l'occupation dans leur chair. Les BOF (beurre - œufs - fromage) n'ont toujours pas disparus.
L'Art de l'affiche est tombé en désuétude sauf pour Decaux et la RATP. Lui a succédé l'Art urbain et le speed painting : graffiti - pochoir - stickers - cellographie (un film de cellophane, support d'un dessin tendu entre deux supports, arbres, poteaux, grilles) - collage - décapage (on ôte la crasse sur un mur pour détourer un dessin). Le graffeur peut, au choix, utiliser des bombes de peinture (aérosols) ou des matériaux éphémères (craie, blanc d'espagne, peinture à l'eau), et utiliser la colère, l'humour, la poésie, la dérision pour transmettre une émotion. La technique du pochoir est parfaite. Le pochoiriste découpe son dessin dans une radiographie, plus robuste et plus souple pour être dissimulée, s'il en conserve les deux parties, il pourra obtenir deux effets différents. Le street art peut être tout autant subversif que l'affiche pour stigmatiser : la politique, l'économie, l'actualité, le sociétal, le social, la culture et marquer les esprits afin d'entrainer un début de la réflexion comme nous aimons à le faire, librement, sur AV.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
8 réactions à cet article
Ajouter une réaction
Pour réagir, identifiez-vous avec votre login / mot de passe, en haut à droite de cette page
Si vous n'avez pas de login / mot de passe, vous devez vous inscrire ici.
FAIRE UN DON