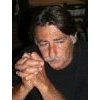La loi et la mort d’un dictateur

Le droit existe là où il y a la loi, disait Aristote. Loin de toute considération éthique, celle ci répond à plusieurs besoins. Faire vivre et organiser la Cité ; rationaliser et fixer la relation avec autrui et avec soi-même ; passer les compromis nécessaires au vivre ensemble ; chasser hors des murs de la Cité l’arbitraire considéré comme un vestige de l’état sauvage. Le droit est surtout pour Aristote l’arme ultime de la pensée politique, un produit de rapports de force antagoniques qui se résume en un résultat commun au-delà (ou au-deçà) duquel la Cité régresse. Faute de pouvoir juger Kadhafi pour ses crimes, la loi aristotélicienne, qui est la nôtre, exige de juger ses assassins. Ne pas le faire c’est déjà accepter une régression de la pensée juridique œcuménique (avec ses variantes locales) ; se réjouir de sa mort, en faisant semblant d’oublier les circonstances qui l’accompagnent, c’est la nier : nous ne somme plus sur une régression mais témoins amorphes d’une digression lourde de conséquences. On peut en effet contester la condamnation d’un autre dictateur, Saddam Hussein et critiquer son procès comme non conforme ; mais on ne peut pas nier qu’il en a eu un. On peut regretter que la condamnation du bourreau nazi Eichmann soit le produit d’une exception juridique extraordinaire, mais celle-ci a bel et bien été votée par la Cité, puis abrogée une fois le procès terminé. Ces régressions, qui dans le cas de l’Etat d’Israël ont été largement explicitées, ont été le résultat d’un constat : le droit existant ne prévoyait pas une peine égale au délit. Il y a certes régression, mais celle-ci est temporelle, légalement argumentée, et perçue comme telle. Entre ces attitudes et le lynchage, l’exécution sans autre forme de procès, accompagnés par une justification policière, militaire ou politique (comme ce fut le cas pour Che Guevara ou Marighella), il y a un monde. Celui qui sépare les limbes du non droit et de l’arbitraire sauvage de la Cité et de ses lois. Si la « révolution » libyenne était autonome, si les combattants de Misrata ou de Benghazi, les armes à la main avaient seuls renversé un régime dictatorial et crée un vide juridique intermédiaire, ils auraient seuls assumé cette responsabilité, le crie aurait été limité dans l’espace et le temps révolutionnaire, comme il le fut avec Mussolini ou Ceausescu (qui eu droit à un procès expéditif). Mais ce n’est pas le cas. Le révolution libyenne fut portée à bras le corps par les forces de l’OTAN, par l’aviation française, britannique et américaine (entre autres), consacré comme pouvoir responsable par les discours et la présence sur place du président français et du premier britannique. L’Europe, les Etats Unis, l’ONU, l’OTAN, on endossé leur cause et doivent l’assumer. Il ne s’agit pas d’imposer à la Libye le droit occidental. Au contraire : pour la communauté internationale, il s’agit d’assumer que les « valeurs » qui lui ont imposé le rôle d’arbitre agissant l’engagent a accepter ses propres lois, la première d’entre elles étant qu’elles sont les mêmes pour tous. Si les tueurs du dictateur ne sont pas jugés ( et peut-être, pourquoi pas, acquittés), non seulement nous sommes allés en Libye pour rien, mais cette expédition nous aura coûté la perte d’un pilier essentiel, fondamental de ce qui régit notre Cité : notre capacité, pour revenir à Aristote, à faire la part entre le trop et le pas assez, accéder à l’eumétrie, cette règle d’or censée garantir notre vivre ensemble.
11 réactions à cet article
Ajouter une réaction
Pour réagir, identifiez-vous avec votre login / mot de passe, en haut à droite de cette page
Si vous n'avez pas de login / mot de passe, vous devez vous inscrire ici.
FAIRE UN DON