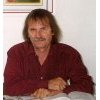La lutte des classes à tout petit feu
Ainsi que nous l’avons vu, Charles Benoist place la question du contrôle des pouvoirs de l’État comme un enjeu entre le capital et le travail. Selon lui, sitôt que survient le suffrage universel (masculin), c’est-à-dire ce qu’il appelle la loi du Nombre, le travail a tout ce qu’il faut pour devenir souverain.
Certes, le capital ne se laisse pas si facilement dépouiller de son rôle de maître absolu, puisque, comme nous, Charles Benoist ne manque pas de constater qu’il existe tout simplement ce qui s’appelle la "lutte des classes" :
« Or, l’histoire contemporaine nous montre les efforts réalisés pour placer la classe ouvrière - pour faire rentrer le "nombre" - dans les cadres traditionnels de l’État. Elle nous montre ensuite comment cette classe, ou du moins une fraction de cette classe, tend, par le syndicalisme, à prendre position, non point dans les cadres anciens de l’État, mais à côté de lui, en face de lui, contre lui ; comment enfin la classe ouvrière, en tant qu’elle vise à s’emparer de l’État pour son compte exclusif et à son profit, oppose sa "souveraineté" particulière à la souveraineté nationale. » (La Crise de l’État moderne, II, 1914, page V)
Il semble donc qu’en 1914, Charles Benoist en soit à s’écrier : « Le syndicalisme, voilà l’ennemi ! », formule qui, une quinzaine d’années plus tard, sera complètement dépassée… tandis que le pouvoir d’État aura été pris, de vive force, par tout un peuple dans l’ancienne Russie tsariste…
Mais revenons un instant sur cette "souveraineté" que Charles Benoist gratifie de guillemets, et qu’il oppose à quelque chose de bien plus sérieux selon lui : la souveraineté nationale. La première est celle que menace de faire valoir le Nombre, à travers le suffrage universel. La seconde paraît pouvoir se définir par le fait de ranger l’ensemble d’une population donnée sous la domination du capital, c’est-à-dire sous la capacité d’appropriation par quelques-uns de l’ensemble de la richesse nouvellement produite.
A priori, pour le capital l’affaire ne peut être que très délicate : la force ne se trouvera-t-elle pas du côté du Nombre ? Dans la France de 1905, les choses ne sont pas encore très claires. Une trentaine d’années plus tôt, il y avait bien eu la Commune de Paris, mais cela n’avait valu que pour la capitale et quelques grandes villes : l’économie rurale restait dominante. Elle rassemblait des artisans et des agriculteurs propriétaires réels ou apparents de leurs outils de production. Dans l’ensemble, le Nombre ne paraissait pas devoir se ranger de si tôt du côté du travail salarié pour aller à l’affrontement, même électoral, contre les grands capitaines d’industrie ou les financiers.
L’Allemagne, certes… pour lui reprendre l’Alsace-Lorraine !... Mais, à l’intérieur de la France, où le capital aurait-il pu trouver à s’inquiéter pour la pérennisation de sa domination ?
Par contre, certainement le syndicalisme - pour peu qu’il sache s’organiser - a-t-il les moyens de nuire, ici ou là, à la rentabilité des entreprises les plus importantes. C’est donc sur ce point qu’il est potentiellement dangereux, et qu’il pourra le devenir davantage au fur et à mesure de la montée en puissance de l’industrie manufacturière. Loin de pouvoir prétendre à la souveraineté, le travail salarié pourrait envisager de peser davantage dans un rapport de force qui ne lui est pourtant d’abord que très désavantageux…
D’où la formule d’action que propose Charles Benoist :
« Ce serait de concilier et de combiner l’idée et le fait de la souveraineté nationale avec l’idée et le fait de la prépondérance de la classe ouvrière ; l’idée et le fait parlementaire avec l’idée d’association et le fait syndical ; l’idée et le fait de la multiplicité des groupements corporatifs, des collectivités secondaires avec l’idée et le fait de l’unité de l’État. » (page VI)
Il y a donc le principal et l’accessoire… Avec, dans ce cas précis, un accessoire qui est la condition nécessaire à l’existence du principal… Sans travail salarié, point de capital. Le syndicat ne peut donc pas être considéré comme l’ennemi du capital, mais comme sa principale courroie de transmission à double sens : de bas en haut et de haut en bas, sous le règne plus général de la "souveraineté nationale".
Dans la France relativement paisible d’avant 1914, qui pense toujours - sans jamais en parler - à l’Alsace-Lorraine, la souveraineté nationale, la souveraineté de la propriété, prend un sens qui dépasse très largement les conflits intérieurs. C’est donc sans détoner le moins du monde que Charles Benoist peut écrire cette phrase en en soulignant lui-même les éléments qu’il juge les plus significatifs :
« Du miracle que doit accomplir "la violence", nous n’avons pas à nous occuper en cet essai où l’on voudrait traiter positivement, historiquement, évolutionnairement et non révolutionnairement, de la Crise de l’État moderne. » (page 41)
Comme nous le savons : trente ans plus tard, il en irait tout différemment.
8 réactions à cet article
Ajouter une réaction
Pour réagir, identifiez-vous avec votre login / mot de passe, en haut à droite de cette page
Si vous n'avez pas de login / mot de passe, vous devez vous inscrire ici.
FAIRE UN DON