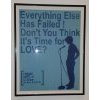La « méthode » des militaires pour résoudre n’importe quel problème
Les militaires utilisent une méthode de planification pour organiser leur action afin de modifier une situation selon les souhaits émis par le niveau politique. Il peut s’agir de renverser un dictateur, de rétablir la paix, d’apporter une aide humanitaire, de lutter contre des terroristes ou de libérer la France occupée. Les militaires doivent résoudre ce genre de problème avec des contraintes pour l’emploi de la force et des limitations de moyens, de durée. Cet artcile présente dans un premier temps l'axe autour duquelle s'articule cette méthode : "le centre de gravité" puis illustre son utilisation dans le cas d'une insurection.
La « guerre » moderne est très éloignée de « call of duty » ou de « battle field » : pas d’ « unlimited weapons » « automatic reload ». Dans la réalité, les munitions, les armes et ceux qui le mettent en œuvre coutent chers et le militaire, comme tout le monde, est comptable des deniers de l’état. Le type de problème que suscite une intervention militaire peut rapidement générer des maux de tête et des insomnies chez ceux qui ne savent pas comment les aborder. Quel doit être le format de la force ? Quels sont les cibles qu’il faut frapper ? Où faut-il se déployer ? Combien de temps doit durer l’intervention ? Combien tout cela va-t-il coûter ? Que faut-il comme moyens ? Par où commencer ? Pas simple, lorsqu’on y regarde de près, pour un néophyte. D’ailleurs, il ne faut pas s’y méprendre mais l’exercice n’est pas simple non plus pour les militaires, surtout s’ils n’ont pas été confrontés depuis les plus jeunes grades à ce type de réflexion. Sun Tsu écrivait « la promptitude dans l’action n’est que le fruit de la réflexion préalable jointe à une grande expérience ». Pour planifier correctement et dans des délais acceptables une opération, il faut avoir un « background » opérationnel, avoir déjà réfléchi à ce type de problème et pouvoir appuyer sa réflexion sur un acquis. Tout le monde n’y arrive pas. Mais pour autant, les militaires ne sont pas totalement désarmés face à ce type de problème. Ils disposent de « la méthode ». La méthode de planification permet de décomposer n’importe quel problème en une suite de petits problèmes plus facile à résoudre, chacun des bouts de solution permettant in-fine de constituer une solution globale. Cette méthode, partagée par l’ensemble de la communauté militaire, permet de travailler horizontalement et verticalement, en partageant le problème entre plusieurs équipes et en élaborant des solutions avec les différents niveaux de commandement (stratégique, opérationnel et tactique). Le cœur de cette méthode, celui où s’exerce réellement le talent du planificateur, s’appelle l’art opératif, il s’agit de la phase durant laquelle, après avoir analysé la situation initiale et déterminé la situation souhaitée in-fine (de façon réaliste), le planificateur identifie les jalons qui permettront d’atteindre ses objectifs. Cette phase s’articule autour du concept assez puissant de centre de gravité.
Mais qu’est-ce que le centre de gravité ? Pour certains, il s’agit de ce « point » un peu magique qu’il suffit de détruire pour que la situation devienne conforme aux objectifs. C’est un peu le talon d’Achille, encore que cette comparaison soit très mal choisie, nous y reviendrons par la suite. Bien entendu, chacun des belligérants a un centre de gravité et chacun aura à cœur d’attaquer celui des autres et de protéger le sien. Mais revenons à Clausewitz : “On doit garder à l’esprit les caractéristiques dominantes des deux belligérants. De ces caractéristiques on tire un certain centre de gravité, le moyeu de la puissance et du mouvement, duquel tout dépend. C’est le point contre lequel toutes nos énergies devraient être dirigées”. Facile à écrire mais comment trouver l’engin en question ? La doctrine militaire actuelle définit le centre de gravité de la façon suivante : « caractéristiques, capacités ou situation géographique dont un pays, une alliance, une force militaire ou toute autre entité tire sa liberté d’action, sa puissance ou sa volonté de combattre ». A ce stade, notons que liberté d’action et volonté de combattre ne sont finalement que des constituants de la puissance et que caractéristique, capacité ou situation géographique peuvent être résumés par particularité. Ainsi, la définition du centre de gravité devient beaucoup plus digeste « particularité dont une entité tire sa puissance ». Notons que pour une opération donnée, un belligérant aura un centre de gravité à chacun des niveaux de la guerre (politique, stratégique, opérationnel et tactique) et que ce centre de gravité est lié aux objectifs de l’opération. Le centre de gravité pour renverser un dictateur n’est pas forcément le même que celui pour rétablir la paix ou pour mener une opération humanitaire. Notons également qu’il peut exister, tout au moins au niveau tactique, plusieurs centres de gravité, c’est-à-dire un par mission. Pour une opération interarmées, par exemple, les forces navales détermineront un centre de gravité qui sera probablement différent de celui des forces aériennes. A l’inverse, au niveau stratégique, il n’existe qu’un seul centre de gravité. Le Col Eikmeier
Ce concept de « Critical Factors Analysis » a été exposé pour la première fois en 1996 par le Dr Joe Strange, professeur au « Marine Corps War College ». L’idée est que chaque centre de gravité possède des « critical capabilities » (CC) qui sont des actions que peut réaliser le centre de gravité. Ainsi, si le centre de gravité est une force, cette force peut « se déplacer », « se ravitailler », « attaquer »…. Ce sont là des CC. Ensuite, pour soutenir ces CC, le centre de gravité possède des « Critical Requirement » ou CR. Par exemple, pour attaquer, il faut des munitions et des armes ; pour se ravitailler il faut des voies de ravitaillement, des entrepôts ; pour se déplacer il faut des camions. Enfin, parmis ces CR, certaines sont vulnérables et peuvent être attaquées, ce sont les « Critical Vulnerabilities ». Ainsi, les voies de ravitaillement peuvent être bloquées, ce qui aura pour conséquence de priver le centre de gravité de son ravitaillement et au final, entrainera sa chute. Mais cet outil ne fonctionne pas que dans un sens. Il est également possible de partir des « Critical Capabilities » pour déterminer le centre de gravité. Ainsi, une force déployée sur un territoire pour une mission donnée peut commencer par lister toutes les actions susceptibles d’entraver son action pour ensuite déterminer l’entité capable d’exercer ces entraves : il s’agira alors du centre de gravité, pour la mission confiée. A noter que cette méthode est souvent plus simple que celle consistant à identifier directement un centre de gravité.
A ce stade, il est important de se souvenir que le centre de gravité est un concept abstrait, uniquement destiné à faciliter la recherche d’une solutions pour un problème donné, et que son choix aura une influence directe sur la pertinence et la robustesse de la réponse proposée par l’équipe de planification. Il convient donc d’être particulièrement vigilant lors de cette étape cruciale et de ne pas céder à la facilité. Les planificateurs non expérimentés choisissent souvent « la volonté de combattre » comme centre de gravité. L’expérience montre que c’est un mauvais choix car s’il y a une volonté de combattre, c’est qu’il y a des combattants et la volonté de combattre est tout au mieux un « critical requirement » mais pas le seul : Le soutien politique, le soutien logistique sont probablement d’autres « critical requirement » qui peuvent être attaqués et qui conduiront également à l’atteinte du centre de gravité. Mais si le choix s’arrête sur « la volonté de combattre », ces autres "modes d’action" ne feront pas partie de l’étude. L'expérience montre qu’aux niveaux « tactique » et « opératif », l’un des critères qui permet de choisir un « bon » centre de gravité est celui : « doit pouvoir conduire des actions susceptibles de gêner la réussite de la mission ». J’y reviendrai probablement dans un prochain article.
Maintenant que la notion de centre de gravité ainsi que la méthode qui permet de le déterminer est explicitée, tentons de l’appliquer à la guerre dite asymétrique, celle que conduit une troupe insurgée contre une force traditionnelle. A la base de toute planification, il y a la réflexion du planificateur et son expérience. La mienne m’amène à affirmer que les rébellions, insurrections, groupes terroristes et autres éléments asymétriques s’appuient sur 4 « Critical Capabilities » :
-
Penser
-
Communiquer
-
Se déplacer
-
Opérer
J’ai choisi ces 4 CC comme une sorte d’hommage au jeu de Go, ou chaque pierre dispose de 4 degré de liberté et aussi en me souvenant du film "la bataille d’Alger". De ces CC, il est possible de tirer des « Critical Requirement » qui sont variables selon les théâtres. Il ne s’agit pas ici de lister tous les CR mais uniquement ceux qui présentent un intérêt pour l’étude, selon son niveau. Ainsi, quelques CR sont ici :
-
La liberté de circulation
-
La liberté d’expression
-
Le soutien logistique
-
La liberté de penser (et oui, c’est aussi une liberté)
-
La possibilité de recruter
-
Le soutien d’une partie de la population….
Enfin, parmi ces CR, certaines sont clairement des « Critical Vulnerabilities » (CV), des faiblesses qui peuvet être attaquées :
-
Le soutien d’une partie de la population peut être réduit par une campagne d’ « information » adaptée ;
-
La liberté de circulation peut être limitée par la mise en place de barrage, check points, patrouilles et autres dispositif destinés à prendre le contrôle de l’espace.
-
Le soutien logistique peut être attaqué à plusieurs niveaux : coupure des routes logistiques, blocage des finances….
- La liberté de penser peut être réduite par la diffusion d’une alternative culturelle plus alléchante ; la télévision peut être utilisée comme le vecteur d’une pensée concurrente à celles d’adversaires…
Quant au centre de gravité de toute lutte asymétrique, il s’agit, bien évidemment, des forces asymétriques elles-mêmes, aussi insaisissables soient elles. La tentation d’en définir un autre ne peut que brider la solution au problème et in-fine, conduire à une impasse, les résultats des guerres conduites par les américains sur des territoires insurgés sont là pour le montrer.
Je conclurai cet article par une ouverture. La méthode de planification opérationnelle permet également de trouver des solutions étayées et parfois originales à des problèmes qui échappent à la sphère purement militaire. Son enseignement, en école d’état-major, s’appuie parfois sur des situations tirées de la vie civile, voire du monde de l’entreprise. Une société souhaitant conquérir un marché trouverait certainement avantage en l’enseignant à ses cadres. Bien entendu, cet article ne fait qu'effleurer la planfication opérationnelle qui ne se limite pas à l'étude du centre de gravité, même si ce concept s'avère le plus intéressant et le plus riche d'un point de vue conceptuel.
Bibliographie
BIBLIOGRAPHY 1. Center of gravity analysis. Eikmeier, Colonel Dale C. July -August 2004, MILITARY REVIEW, p. 5.
2. Dr. Joe Strange, USMC War College. UNDERSTANDING CENTERS OF GRAVITY AND CRITICAL VULNERABILITIES. [Online] http://www.au.af.mil/au/awc/awcgate/usmc/cog2.pdf.
3. JMO Department, Naval War College. JOINT OPERATION PLANNING PROCESS (JOPP) . 21 January 2008 .
4. Fowler, LTC Christopher W. CENTER OF GRAVITY – STILL RELEVANT AFTER ALL THESE YEARS. s.l. : U.S. Army War College, 09 April 2002.
5. N, J O S E P H L. S T R A N G E and R I C H A R D I R O. Center of gravity : what Clausewitz really meant. s.l. : JFQ / issue thirty-five.
6. Clausewitz, Carl von. Vom Kriege.
12 réactions à cet article
Ajouter une réaction
Pour réagir, identifiez-vous avec votre login / mot de passe, en haut à droite de cette page
Si vous n'avez pas de login / mot de passe, vous devez vous inscrire ici.
FAIRE UN DON