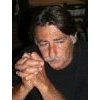La révolution n’est pas un jeu de Playstation

« Dans une culture comme la nôtre, habituée depuis longtemps à l'éclatement et divisant toute chose pour la transformer en moyen de contrôle, il est un peu choquant de se dire que le moyen est le message… Il s'agit pourtant de dire que les conséquences personnelles et sociales de tout moyen résulte de cette nouvelle échelle qui s’introduit dans nos affaires, sorte de rencontre de nous-mêmes et de toute nouvelle technologie ». Plus complexe que l’aphorisme que l’on retient en général (ici en italiques), cette phrase de MacLuhan (Understanding Media), pourrait s’opposer à l’emballement de nos moyens de communication (on oublie systématiquement le mot communication) et à leur autosatisfaction résultant d’une chimère largement partagée qui consiste à dire que la révolution est internet (ou Twitter, ou Facebook, qui ne sont que ses applications). Il serait plus sensé de dire que la profusion, l’aléatoire, le divers et l’instantanéité qui régissent ce moyen de communication global produisent des conséquences inattendues et/ou involontaires, mutation que prévoyait McLuhan dans ce même ouvrage.
Si Rabelais opposait l’os à la substantifique moelle, c’était bien pour indiquer que le moyen (l’infrastructure, le porteur, l’englobant), insignifiant quant au message, cache (ou couvre) l’essentiel, l’important. Cependant, que l’on parle de l’os ou d’ Ethernet (terme propice pour indiquer un réseau véhiculant, propulsant, couvrant, à travers l’air (éther), on indique toujours un moyen. Le premier dirige, contraint, couvre de par sa forme solide et immuable. Le second, entropique, diffuse en tous les sens, n’a apparemment ni vecteurs prédéfinis ni interlocuteur précis. Une sorte de bouteille à la mer à saisir. Du moins en apparence. Car instantanément l’os revient, ou plutôt le « nous-mêmes » et interfère pour solidifier, créer des pivots, qui, eux restent étanches. Facebook et Twitter, entre autres, créent des communautés de certitudes, d’opinions cristallisées, de groupes d’intérêts subjectifs, qui deviennent en soi des infrastructures solidifiées, des vecteurs contraignants et dirigés qui communiquent peu entre eux et souvent privilégient le futile ou le marginal à l’essentiel, par la simple loi du nombre.
Quoi qu’il en soit, le moyen de communication reste un moyen de distorsion. Distorsion des événements qu’il véhicule. Sans jeu de mots, le téléphone arabe, celui auquel on jouait enfants, en est la meilleure illustration.
Ainsi, « le changement d'échelle, de rythme ou de modèle qu'une nouvelle innovation introduit dans les affaires humaines », (pour reprendre MacLuan), ne changera en rien sa nature déformante. Par contre, la déformation ne sera plus unique mais multiple. Elle ne sera plus brouillée par un discours d’objectivité unique mais revendiquera une subjectivité multiple et motivée. En ce sens, et à partir d’un événement donné, moyens de diffusion, opinions et interprétations se confondent formant un tout avec l’événement lui-même. Ce tout apparaît avec autant d’identités qu’il y a de groupes, avec leurs intérêts, leurs arrières pensées, leurs objectifs, différents et /ou divergents.
Cette identification à l’événement, parfois proche parfois lointain, donne l’illusion d’une participation active des « consommateurs ». Mais en réalité l’événement en soi continue son cheminement autonome hors interprétation, et une autre voie (une autre vie virtuelle), le multiple, le confond avec les moyens de communication et les groupes qui les « consomment ».
Dans la vraie vie, une révolution (pour prendre cet exemple) poursuit ces propres objectifs, liés aux contraintes du possible, subit les coercitions et la répression, avance avec des pertes et des sacrifices vers ses objectifs, passe des compromis, motive alliances et mésalliances, atteint ou n’atteint pas ses objectifs. Sa relation avec le virtuel existe mais elle a des applications limitées : moyen de communication d’une part, moyen de mobilisation d’autre part. La mutation la plus importante par rapport au passé étant l’immédiateté, c’est-à-dire la possibilité d’agir sans délais. L’immédiateté agit aussi (mais sélectivement et avec des variantes) sur l’onde de choc, l’influence, le mimétisme et le témoignage, mais cette fois dans la totalité diffuse et contradictoire décrite ci-dessus, c’est-à-dire sous son aspect de « seconde vie ». Une vie qui peut se développer sans les contraintes du réel que connaît la révolution elle-même. Ce que MacLuan indique comme étant « l’extension de nous-mêmes », agissant dans l’immédiateté, ne peut utiliser que des opinions déjà constituées et dépendantes du fait lui-même en ce qui concerne l’interprétation, c’est à dire que, par manque de temps et de recul, l’opinion n’a aucune autonomie ni pouvoir de théorisation (ce qui était le cas avec le philhellénisme au début du 19e siècle par exemple). Se crée ainsi une situation oxymore : d’un côté l’événement - ensemble, déconnecté de la réalité peut voguer sans contraintes, mais, d’autre part, il est dépendant pour l’analyse du monde de l’évènement en tant que tel. Que celui-ci disparaisse des écrans, des moyens de communication, qu’il soit noyé par un autre événement (insignifiant ou important, peu importe), la pensée et l’intérêt s’arrêtent aussi. Les contraintes liées au fait réel devenant par ailleurs un paravent supplémentaire pour les relais de son interprétation.
Ce qui caractérise le mieux les mécanismes de l’interprétation ce sont leur boulimie et leur propension à la démesure. En compétition constante avec d’autres événements, privé du temps de l’analyse, en situation de « concours constant », l’événement - ensemble n’a comme arme de pérennité que la démesure. Fut-elle déconnectée de l’événement réel. Il lui faut par ailleurs de la nourriture événementielle permanente, confondant de la sorte le pérenne et l’éphémère, l’insignifiant et le signifiant le stratégique et le tactique, n’hésitant pas à transformer le tout en information vitale. Cette démesure, mise à la disposition de la techné perturbe l’entendement, l’appréciation et, en fin de compte, la praxis elle même.
La société tunisienne, égyptienne, libyenne, l’ensemble de l’œcoumène, ont besoin du Temps et des appuis s’attardant sur les longs processus qu’elles engendrent. Les moyens de communication (mais nous mêmes aussi), par leur addiction à l’exceptionnel, leur interdisent cet usage du temps, les condamnant à la permanence de l’éphémère.
Tandis que les processus révolutionnaires s’installent, chacun à son rythme, dans une dialectique du possible, négociant les obstacles les uns après les autres, les médias se focalisent sur leur finalité. Ne la trouvant pas, pour la simple raison que nous sommes face à un processus, ils deviennent répétitifs et surtout n’arrivent pas à hiérarchiser, à faire le tri entre l’important et l’insignifiant, l’ici et l’ailleurs, le discours et l’action. Mais du côté des révolutions, les débats engendrés et les politiques annoncées (politiques qui instrumentalisent les faits pour une consommation intérieure du devenir), sont très mal vécues. Alors que sur place l’événement en soit est chargé de tragédie (les gens se battent, meurent, sont déplacés, la nourriture manque, les familles sont cloitrées, etc.) l’événement global, sautant les étapes faute d’être alimenté par le réel, dérape sur des débats sur la sécurité européenne, l’immigration ou le terrorisme. Avant même d’affronter une étape, les révolutions sont interprétées par ce qu’elles « risquent » de devenir. Il ne s’agit pas d’un exercice d’anticipation mais, comme disait Guy Débord, d’une répétition à l’infini de ce qui est connu et nous effraie, une vision cyclique de ce que l’on craint.
Par ailleurs, la focalisation excessive ne supporte pas (ou peu) la nuance. L’information se doit manichéenne, compulsive. Au moment de l’action, l’outil information simplifiera les enjeux, tout en exacerbant les enjeux hypothétiques, se situant à des lieues des enjeux du fait réel.
Lorsque Henry Guaino affirme que ce n’est pas la diplomatie française qui est confuse mais le monde qui devient instable, il avoue d’une certaine façon que la France n’a pas su ou pu créer les outils qui permettraient d’aller au-delà de l’éphémère. Qu’il n’existe aucune autonomie au sein des relais d’information, et que, tout comme les médias, les gouvernements sont devenus des consommateurs d’une information basée sur l’exceptionnel dont l’exploitation qui en découle alimente, au jour le jour, une pensée fragmentée, dérivante et n’ayant aucune autonomie anticipatrice. Insister enfin sur les constantes immigration ou terrorisme c’est ne pas observer et analyser un événement en soit mais, au contraire, le charger de ce qui alimente ce que l’on craint. Ainsi, et indépendamment de l’événement, on est condamnés à une vision anxiogène des choses, c’est-à-dire à celle de l’instant.
Quand Nicolas Sarkozy indique que les peuples engagent un processus qui met à bas des régimes autoritaires et dictatoriaux acceptés par le passé par ce que ils étaient un bouclier contre le terrorisme, il participe du même schéma, mais fait une analyse viciée à plusieurs niveaux. D’une part il indique que l’acceptation de ces régimes était un moindre mal. Que cette acceptation était forcée. Il situe le problème à un niveau moral. Or, il s’agit d’un problème politique : loin « d’accepter » ces régimes, nos sociétés et notre économie les intégraient. Les affaires, les investissements, la coopération militaire et policière, le tourisme, en faisaient des partenaires, des marchés, des appuis, des dividendes.
D’autre part, cette situation figée était justement celle qui produisait du terrorisme. Sans vouloir remonter jusqu’à Spinoza, il est bon de rappeler que tout pouvoir autoritaire génère de la violence, refoulée ou exprimée.
En fait, faciliter les processus démocratiques est une manière de préserver un intérêt bien compris visant à endiguer le terrorisme et pas le contraire. On est loin, très loin, de cette démarche intellectuelle.
Les médias, c’est après tout leur métier, énumèrent les risques et autres tensions au jour le jour, confondent les faits avec leur interprétation et négligent leur analyse en la traînant dans les plateaux d’experts aussi dépassés et monotones que le reste. Quel est leur défaut d’interprétation ? Il faut remonter au « nominalisme » de Raymon Panikkar c’est-à-dire à cette propension des sociétés techniciennes et globalisatrices « de croire qu’en connaissant les parties on connaitra le tout et que donc pour connaître nous devons nous spécialiser dans quelque chose » « Ainsi », disait-il, « commence la fragmentation de la connaissance qui conduit à la schizophrénie du connaissant ». Comme jadis on observait l’Amérique Latine comme un ensemble catholique et hispanophone, méprisant les dizaines de variantes qui la déterminent par ailleurs, aujourd’hui on observe le monde arabo-musulman comme un tout où les objectifs et la forme utilisée pour les atteindre serait uniforme.
Une fois encore, comme l’indique Jaques Ellul, la « société technicienne » tend de plus en plus à se confondre avec le « système technicien » : produit de la conjonction du phénomène technique caractérisé par l’autonomie, l’unicité ou l’insécabilité, l’universalité et la totalisation. Bref, le contraire de la réalité.
1 réactions à cet article
Ajouter une réaction
Pour réagir, identifiez-vous avec votre login / mot de passe, en haut à droite de cette page
Si vous n'avez pas de login / mot de passe, vous devez vous inscrire ici.
FAIRE UN DON