La séduction à tout prix
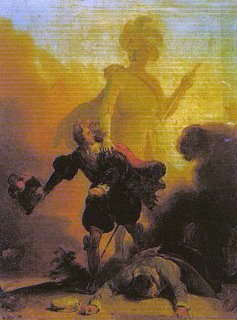
Une double page des Dingodossiers
(Gotlib et Uderzo - 1967) resurgit régulièrement dans mes pensées. Elle
fait référence aux contes, aux films, bref à toutes les histoires qu’on
peut raconter et s’intitule : Après la fin. Une première image
présente le prince charmant et la petite bergère, vus de dos, se
dirigeant vers un château, enlacés sur leur cheval blanc et auréolés de
leur passion avec pour légende le célèbre épilogue : « Ils se marièrent
et eurent beaucoup d’enfants. » L’image suivante, quelques années plus
tard, montre un couple en furie : le père, agressé par une nuée
virevoltante d’enfants, tentant vainement de lire son journal (sic)
vocifère : « Puisque tu es bergère, occupe-toi de ce troupeau » à sa
femme, les mains dans la bassine qui, en se retournant, se contente de
rétorquer d’un air mauvais : « Charmant ». Le romantisme des jeunes
amoureux, loin de résister à l’épreuve du temps, a migré vers l’amère
réalité du quotidien.
Jusqu’aux
décennies récentes, dans les histoires et le plus souvent dans la vie,
la séduction n’avait donc cours que pendant la brève période séparant
l’adolescence du mariage. Les amants, une fois unis par les liens
sacrés, n’éprouvaient plus le besoin de déployer tout un stratagème
d’artifices destinés à s’octroyer les faveurs de quiconque puisque leur
vie amoureuse, toute tracée, était censée ne plus connaître de
déviance. Bien sûr, il y eut madame Bovary, toutes les intrigues de
cour réservées aux aristocrates, ces femmes, souvent conspuées, qui
soignaient leur apparence et qu’on soupçonnait d’adultères, ces hommes,
dont on se méfiait, qui paradaient en mondanités et qu’on soupçonnait
de débauche... Mais pour le père et la mère classiques, chercher à plaire
en dehors du foyer ne présentait plus d’intérêt, une fois fondée la
sacro-sainte famille.
Il
semble que ce soit le passage d’une vie rurale à une vie citadine qui
changea radicalement la donne. La grande ville multiplie les contacts
humains visuels. L’image tend à devenir fondamentale puisque, le plus
souvent dans la rue, la relation anonyme se résume au regard. La vue
devient le plus important de nos sens alors qu’elle ne l’était pas dans
une société restreinte, en majorité analphabète, où la transmission de
la connaissance et de l’information se faisait oralement. L’individu
s’ouvre à l’esthétique. Il devient soucieux de son apparence et de son
charme, prend conscience avec le spectacle, aussi bien celui de la
scène en pleine expansion que celui de la rue, que les intérêts ne sont
pas neutres, qu’ils sont faits d’attirances et de succès. On entre dans
l’époque de la séduction.
On a beaucoup écrit sur le volet amoureux de la séduction : Voiture (La carte du tendre), Kierkegaard (Journal d’un séducteur), Cohen (Belle du Seigneur), Baudrillard (De la séduction, Les Stratégies fatales).
La littérature fourmille de séducteurs de renom : Don Juan, Casanova,
Valmont, James Bond, alors que les séductrices se font plus rares. Il
faut aller chercher Carmen, qui en mourra, pour trouver un prototype à
l’égal des mâles précédemment cités. Ou encore Salomé pour l’Antiquité,
Lolita pour l’époque contemporaine. Toutefois, la femme des romans est
majoritairement séduite et donc passive. Elle laisse au mâle l’illusion
de sa victoire. Il faut remarquer également que les séducteurs des
romans ont le plus souvent des fins tragiques, comme si la morale
prenait sa revanche pour châtier les gêneurs. La séduction est donc,
jusqu’au XXe siècle, le propre de l’amour juvénile. Une fois cette
période passée, elle devient négative et on doit même s’en garder au
risque de sombrer dans la dépravation et l’immoralité.
Est-il
besoin de mettre l’accent sur le chemin parcouru depuis un siècle ?
Concernant l’amour, Baudrillard nous assure que la distribution a
changé. Le séducteur, ravalé au rang du vulgaire dragueur grotesque,
devient la proie de l’objet convoité, et la « femme objet » joue le
premier rôle d’un jeu où les règles éculées du passé ont changé : « Qui
a jamais pressenti la puissance propre, la puissance souveraine de
l’objet ? Dans notre pensée du désir, le sujet détient un privilège
absolu, puisque c’est lui qui désire. Mais tout se renverse si on passe
à une pensée de la séduction. Là, ce n’est plus le sujet qui désire,
c’est l’objet qui séduit. Le privilège immémorial du sujet s’inverse
[...] Le séducteur n’est-il pas plutôt séduit, et l’initiative ne
revient-elle pas secrètement à l’objet ? » (Les Stratégies fatales)
Mais
la grande nouveauté demeure que la séduction déborde les limites de
l’amour pour s’insinuer partout. Elle devient même le passage
obligatoire pour tout succès, s’exerce partout où la concurrence joue.
L’ancienne image négative de perversion s’est transformée positivement
en critère déterminant. La réussite de tout acte, l’impact de toute
création se résume au dilemme suivant : plaire ou ne pas plaire.
L’éducation se doit d’être ludique, le public, rassasié de culture
didactique et ennuyeuse, demande du divertissement. Indépendamment de
tout autre caractère, tout ce qui est proposé doit charmer
l’utilisateur potentiel. C’est la suite logique de la « société de
consommation » et de la « société du spectacle » dénoncées dans les
années 70 qui n’ont pas de fin en soi autrement qu’associées au
plaisir.
Le
candidat au succès doit s’y soumettre obligatoirement : séduire devient
la première des qualités nécessaires à sa promotion, la condition sans
laquelle rien de fructueux n’est envisageable. Les discours qui perdent
leur sens à force de ressemblance dans les canaux médiatiques ne font
plus recette. Restent les images, au propre comme au figuré, au parfum
de réalisme, qui donnent davantage confiance et sur lesquelles tous les
efforts vont donc se concentrer. Les hommes publics, toutes tendances
confondues, n’existent aujourd’hui qu’à travers leurs représentations
largement diffusées et donc grâce à leur perception par le plus grand
nombre. La compétence devenue secondaire, voire dérisoire, une image
favorable devient l’alpha et l’oméga de toute tentative de prise de
pouvoir, qu’il soit politique ou médiatique. On a constaté qu’un
candidat aux élections américaines avait tout intérêt à faire rire (et
d’ailleurs les prétendants s’y emploient activement depuis plusieurs
décennies), de la même façon que réussir à faire rire une femme est
presque la garantie du succès de sa cour. L’image visuelle, stricto
sensu, se mue en représentation symbolique. On parle, par exemple,
d’image valorisante de réussite.
On cherche à séduire
un électorat versatile, un public capricieux. La séduction touche
aujourd’hui tous les secteurs : l’art (il faut que l’artiste se montre
et se fasse un nom), les espaces de représentations publiques :
théâtre, cinéma, télévision (les exemples sont superflus), la politique
(cf. ci-dessus), la littérature (presque tous les personnages publics
écrivent des livres qui se vendent bien), le sport (gros effort
esthétique chez les équipementiers, calendriers de rugbymen,
conférences de presse obligatoires), les sciences (Tazieff, Cousteau,
De Gennes), le monde du travail (les entretiens d’embauche, les CV
flatteurs). Il n’y a que la bulle financière pour laquelle « vivons
heureux vivons cachés » reste la devise, le seul domaine qui échappe
encore au déballage médiatique et dans lequel les protagonistes se
cloîtrent davantage qu’ils ne s’exhibent. Il faut dire que
l’enrichissement personnel de quelques-uns au détriment du plus grand
nombre est une idée difficile à promouvoir.
La séduction, c’est présenter de quelqu’un, d’un produit ou d’une action une image valorisante dont le public se souviendra tout en essayant de sortir des sentiers battus : l’essence même de la publicité. Séduire, c’est engager un effort pour plaire et par conséquent susciter un contentement, qu’il soit visuel, gustatif, sexuel ou autre. Tous les coups sont permis pour s’accorder les faveurs de ceux qui constituent aujourd’hui une masse sans visage mais sans lesquels aucun succès d’envergure n’est concevable : le public. Les sociétés libérales dans lesquelles nous vivons sont fondées sur la concurrence. Le corollaire de cet esprit de compétition semble être la séduction à tout prix, condition nécessaire et même souvent suffisante à la valeur dominante : le plaisir individuel. Reste à savoir si cela suffira pour remplacer les anciennes croyances et les idéologies disparues ?
Illustration : Don Juan et le commandeur par Fragonard.
5 réactions à cet article
Ajouter une réaction
Pour réagir, identifiez-vous avec votre login / mot de passe, en haut à droite de cette page
Si vous n'avez pas de login / mot de passe, vous devez vous inscrire ici.
FAIRE UN DON









