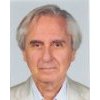LE PAIN ET LE VIN
LE PAIN ET LE VIN
Pourquoi avoir choisi le pain et le vin ?
Le pain est, ce que le peuple demande avant les jeux. Le pain, symbole de la nourriture, est indispensable. On ne danse pas l’estomac vide. Et il faut entrer dans la danse pour comprendre ce qui se passe.
Tant pour le vin, est aussi le partage d’un plaisir commun aux dominés comme aux dominants, qui garantie la paix. L’ivresse nous permet de voir la réalité plus belle qu’elle ne l’est, à condition de l’oublier une fois la sobriété retrouvée.
Dans la Grèce antique l’épis de blé et sa transformation en pain avaient une place importante dans les Mystères d’Éleusis fondés sur le Mythe de Perséphone. La fille de Zeus et de Déméter fut enlevée par Pluton, le dieu du troisième Monde, le monde des morts. Le combat de sa mère Démèter, déesse de la Terre nourricière, pour récupérer sa fille symbolise la Mort et la renaissance de la Nature. Zeus, a décidé que Perséphone passerait six mois en enfer (durant l’hiver) et six mois avec sa mère (durant l’été). La prise de conscience du temps cyclique des saisons et du Mythe de la réincarnation, donnaient un sens à la vie de ces gens là. Le vin était honoré par Dionysos, le Dieu de la fête, du partage et de l’élévation de l’âme et de l’esprit au dessus des contingences de la vie quotidienne. Un autre aspect de la philosophie pratique qui maintient encore le peuple grec joyeux et courageux dans les pires épreuves.
Le pain et le vin nous offrent un parfume d’offrande. Cette offrande est un sacrifice. La suspension de notre égoïsme pour un petit instant, la conversion du regard vers l’ « autre », ou l’ « Autre » nous est délicatement suggérée...
000
Dans la Genèse, livre fondateur de notre civilisation occidentale, - La mythologie grecque est laissé aux érudits et les hellenistes, de moins en moins nombreux -, Dieu refuse l'offrande de Caïn, tandis qu'il accepte celle d'Abel, ce qui a rendu Caïn tellement furieux qu'il a tué son frère. Mais pourquoi Dieu a-t-il refusé l’offrande de Caïn ?
Caïn offre des produits du sol, et Abel le premier-né de son troupeau. C'est très différent. Abel offre le meilleur tandis que Caïn n’offre qu’une partie quelconque des ses récoltes.
Par la suite, Caïn est banni par Dieu, mais il a une descendance, et devient le père d'une grande lignée, qui construira des villes. Il périra pourtant dans le déluge : il n'est donc pas si maudit pendant un long laps de temps …
Toute la descendance de Caïn, et sa généalogie se termine par une phrase énigmatique : Lamek, l'un de ses descendant, dit à ses deux femmes : "J'ai tué un homme pour une blessure, un enfant pour une meurtrissure. C'est que Caïn est vengé sept fois, mais Lamek soixante-dix sept fois."
La violence appelle la violence. La multiplication de la violence se passe de commentaires. La civilisation créée par Caïn s'est construite dans la violence et a péri dans la violence.
Nous nous battons pour la liberté et l’égalité, sans nous soucier de la fraternité, troisième colonne de la République Française.
Ce qui est frappant ici, c’est que la fraternité dans l’histoire de l’humanité commence très mal.
Cela nous oblige aujourd’hui de nous poser encore plus de questions sur nous-mêmes, notre civilisation, le sens de notre vie.
Il faut aller chercher très loin une piste pour comprendre la fraternité comme valeur capable de donner un sens à notre vie : Un sens à notre Liberté qui est le fleuron de la dignité humaine et non la licence qui est un abus et l’égalité entre les homme qui est partage des biens et non le nivellement par le bas des dictatures et des systèmes totalitaires fomentés par la rapacité inextinguible d’une oligarchie.
une poignée d’êtres cupides.
Les mots eux mêmes ont une vie, un passé, un présent et un avenir. Parfois ils meurent sans rien laisser et il faut alors faire des recherches comme Champollion qui a ressuscité la pensée de l’Égypte antique grâce au déchiffrement des hiéroglyphes.
Abel était un berger, donc un nomade. Il se promenait tous les jours avec son troupeau et sa flute pour compagnie. Il vivait des produits de son troupeau et s’habillait de la peau de ses bêtes. Caïn était un laboureur. Il cultivait la terre, il vivait des produits de la terre. Il savait cultiver du blé pour fabriquer du pain et produisait du vin avec le raisin, ce qui demande beaucoup de travail. Il était obligatoirement fixé au sol, donc un sédentaire.
À part le mode de vie, quelle est la différence entre ces deux catégories : nomades et sédentaires ?
Nous allons revenir sur ces deux frères mystérieux, mais allons plus loin dans l’observation.
C’est une longue histoire qui vaut le détour. L’humanité évolue dans un temps linéaire pour ceux qui étudient l’histoire, mais aussi sur un temps cyclique pour les grands penseurs et les prophètes. Les événements se succèdent en trois vitesses dans les deux cas : Dans un temps d’une courte durée, analysés et commentés aussi bien que mal par les journaux et les médias, en moyen terme par les hommes qui pensent et qui essayent de comprendre et par de très longues périodes saisies uniquement par des grands visionnaires.
Platon parle de la Grande Année, un cycle de 26.000 ans, divisée à l’âge d’or, l’âge d’argent, l’âge de bronze et l’âge de fer (l’âge noir pour la Tradition Hindou, qui est le notre).
Je me suis tourné ici vers l’histoire, l’anthropologie et la philosophie afin d’explorer le propre du nomadisme et de la sédentarité.
« A partir du néolithique, 8.000 ans avant notre ère, la guerre émerge à travers l’opposition entre nomades et sédentaires. Pourquoi cette invention de la guerre ? Pour l’appropriation des territoires et des ressources, qui va permettre à deux civilisations concurrentes de se développer. La guerre était un phénomène inconnu jusqu’alors. Des conflits entre clans nomades du paléolithique avaient éclaté, mais sans cette permanence des hostilités qui opposera les nomades et les sédentaires pendant presque 10. 000 ans. Cet antagonisme mondial dépassera en importance toutes les guerres qui auront lieu dans chaque foyer de civilisation. Dès le néolithique, le conflit débute avec les razzias des nomades sur les villages sédentaires. Le phénomène de la guerre va s’intensifier avec l’amélioration des armes, à l’âge du cuivre, puis du bronze et du fer. Le conflit se propage avec les vagues d’invasion nomades, qui commencent 3.000 ans avant notre ère avec les Indo-européens et les Sémites. Il culmine avec les invasions mongoles du XIIe siècle et décline jusqu’à l’effondrement de leur empire au XVIe siècle. Après 9.600 ans de conflits, d’invasions et de conquêtes, les sédentaires l’emporteront sur les nomades dans le premier conflit géostratégique mondial. » (2)
“Les sociétés primitives seraient par essence guerrières car chacune se définit par opposition à ses voisines. Chacune d’elles cherchant à préserver son être, sa cohésion, en refusant un développement économique et démographique cumulatif, la division de la société en classes. En refusant également le commandement, la centralisation et la hiérarchisation du pouvoir politique. Dans cette optique, la guerre serait une force centrifuge destinée à maintenir la séparation des sociétés primitives, à maintenir leur indépendance politique, "si les ennemis n’existaient pas, il faudrait les inventer". “(3)
La maîtrise technique du cheval et de l’arc, la maîtrise tactique du harcèlement et la maîtrise stratégique de la mobilité, sont complétées par la cruauté implacable des nomades auxquels les duretés de l’existence ont enseigné la fragilité de la vie. C’est la guerre totale et ses pyramides de têtes coupées. Une supériorité militaire qui vaudra aux nomades la suprématie absolue pendant des siècles. Une fois qu’ils ont pris le pouvoir sur des sociétés sédentaires beaucoup plus riches et sophistiquées, les nomades remplacent la noblesse locale et se laissent facilement séduire par les fastes et le confort d’une vie sédentaire. (Les richesses excédentaires : le pain et le vin, entre autres). Ce faisant, ils ne tardent pas à perdre une bonne part de leurs qualités guerrières et se trouvent bientôt à leur tour à la merci de nouvelles invasions nomades surgissant des steppes. Cette explication vaut aussi bien pour les nomades d’indo-européens puis les turco-mongols au Nord, que pour les sémites puis les musulmans au Sud. (2)
Les conquêtes des Musulmans, puis celles des Mongols, feront de la fameuse « Route de la Soie » la principale artère terrestre du commerce mondial et contribueront à l’accélération des échanges commerciaux entre l’Orient, l’Europe et l’Asie. Les Mongols créeront le plus grand empire de l’histoire en instaurant une « pax mongolika » qui, bien que régulièrement interrompue par les conquêtes, atteindra un niveau de civilisation élevée. L’instauration de la « Yasa », la « grande loi » mongole, avec ses règles de droit civil, pénal et commercial, permet d’assurer la sécurité des populations, la propriété de leurs biens, la libre circulation des marchands et la régularité des transactions. La mise en place d’un service de poste et de relais permettra d’assurer les communications entre l’Asie, l’Europe et l’Orient. (4) Ainsi les nomades sont bien parvenus à construire des Etats pérennes. (4)
Ce conflit géostratégique mondial entre nomades et sédentaires s’achève à l’avantage des sédentaires au début du XVIe siècle, avec l’implosion de l’Empire mongol. Cette implosion est due à trois causes principales :
a) La première est la décadence produite par les rivalités internes des différentes hordes qui se sont séparées et affaiblies.
b) La deuxième est le développement de l’artillerie moderne qui bat en brèche la supériorité militaire des cavaliers nomades. La supériorité technologique des sédentaires l’emportant définitivement sur les qualités guerrières des nomades.
c) La troisième, curieusement, est la “tolérance religieuse” des Mongols. Toutes les grandes religions de l’époque sont présentes dans l’Empire mongol où Tengri, « le ciel très haut », la principale divinité du chamanisme mongol peut, selon les chamans, contenir tous les autres dieux. Pendant que l’Europe passe de l’Inquisition aux Guerres de Religion, tout en poursuivant le combat contre l’Islam, la capitale mongole de Karakorum est le seul lieu au monde où, sans affrontements religieux, les temples bouddhistes voisinent avec les mosquées et les églises chrétiennes nestoriennes. Cette tolérance sonnera la perte des Mongols dont les antagonismes seront exacerbés par les conversions de certaines tribus à des religions beaucoup moins tolérantes que leur chamanisme originel. L’issue de ce conflit géostratégique entre nomades et sédentaires sera la montée des impérialismes religieux qui caractérisent les empires sédentaires. (4)
000
Voici en quelques mots le parcourt de notre monde actuel et dans lequel nous évoluons. Ici, la fraternité est une triste utopie comme celle qui est présentée dans le livre de Jacques Attali, illustre chantre de la pensée unique et de l’impérialisme mondial. (5)
Nous voici enfin devant les frères d’origine, qui ne sont que deux : Le texte hébreu au verset 8 dit exactement : « Caïn dit à son frère Abel /// Et quand ils furent aux champs, il le tua. » La phrase "Caïn dit à son frère Abel" … est rompue. On attendrait qu'il lui dise quelque chose, qu'il est jaloux, mécontent… C’est une rupture qui fait sens, il y a là un grand silence. Caïn dit /// ? Rien du tout. Abel, non plus. Une des causes de la violence, n’est ce pas justement qu'entre les deux frères, il n'y a pas eu de parole ? Quand il y a de la jalousie qui n'est pas exprimée par des mots, quand il n'y a pas d'explication entre les frères, cela débouche sur de la violence.
Comment accueillons-nous la différence d'autrui ? C'est le message essentiel de cette histoire. Le pain et le vin produits de la sédentarité, sont-ils des privilèges à partager ? Alors ils ne sont plus des privilèges, mais des bénédictions. Une véritable offrande. L’offrande du meilleur de nous-mêmes.
Une petite histoire pour finir : Un athénien arrêta Socrate et lui demanda ce qu’il pensait de sa laideur. La réponse de Socrate est unique : « La laideur est toujours là pour me rappeler le chemin que j’ai dû parcourir pour découvrir la vraie beauté qui elle, est intérieure. »
Biblio :
(1) Platon Le Timée
(2) Bernard NADOULEK (sur internet)
(3) Pierre Clastres : Archéologie de la violence (1997)
(4) Chantal Lermercier-Quelquejay : La paix mongole (1970)
(5) Jacques Attali Fraternités, une nouvelle utopie (2002).
Les auteurs que je cite, répondent aux grandes questions qui sont posées à l’humanité depuis la nuit des temps. Mais les réponses données ne nous dispensent point de nouveaux questionnements.
4 réactions à cet article
Ajouter une réaction
Pour réagir, identifiez-vous avec votre login / mot de passe, en haut à droite de cette page
Si vous n'avez pas de login / mot de passe, vous devez vous inscrire ici.
FAIRE UN DON










 sinon commentaire intéressant, merci.
sinon commentaire intéressant, merci.