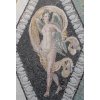Le revenu universel est une condition nécessaire pour l’avenir de la sécurité sociale

1. L'essoufflement d'un modèle social reposant sur l'activité industrielle.
Depuis la création du salaire minimum interprofessionnel garanti (S.M.I.G.) en 1950 et d'un régime général des assurances sociales en 1945, le revenu universel se révèle être le projet économique qui suscite à la fois le plus de curiosité, de moquerie, et finalement des débats politiques les plus intéressants de ces soixante dernières années.
La sécurité sociale a été vécue comme une libération pour des millions de citoyens, parce qu'elle assouplit leur forte dépendance des revenus du travail, seule source de subsistance pour ceux qui avaient quitté la campagne pour la ville, où les prix du logement et de la nourriture sont bien plus élevés. L'adoption de la Sécu, incarnant à elle seule les débuts de l'État-providence, correspondait au moment où les populations dépendaient de plus en plus de l'économie urbaine, faite de concentration industrielle, commerciale et administrative. Après le second exode rural des années 1960-1970, lors de l'instauration de la Cinquième République, la dépendance envers l'État-providence s'est accrue : les aides sociales ont fleuri, les HLM construits en masse et les services sociaux se sont étendus. La politique devenait purement biopolitique, pour reprendre un concept du philosophe Michel Foucault qui éclaire aujourd'hui mieux que jamais ce lien de dépendance entre le gouvernement et ses administrés. La Sécu organisait une prise en charge totale du corps de chaque citoyen sous tous ses aspects physiologiques, mais cette relation entre l'État et le citoyen se faisant par l'intermédiaire des autorités médicales, le mouvement antipsychiatrie les accusait grosso modo de pratiquer un gouvernement des corps par lequel s'exerce in fine une domination de classe ou une vision idéologique qui peut se ramifier à la pensée évolutionniste du 19ème siècle, quand les autorités voulaient domestiquer les paysans pour les rendre conforme à une certaine idée de l'évolution de l'espèce humaine.
Aujourd'hui la société est largement urbanisée, la relation entre le citoyen et le gouvernement s'est distendue, en raison notamment de l'éloignement vis-à-vis des institutions, qu'elles soient traditionnelles ou modernes, et aussi grâce à l'ouverture massive amenée par la mondialisation, structurée autour du capitalisme global. Ces transformations, la sécularisation et la globalisation marchande, remettent en cause les pratiques institutionnelles héritées du 19ème et du 20ème siècles, organisées autour d'une autorité de type pastorale – l'expression de providence pour désigner une nouvelle manière de gouverner s'inscrit encore dans cette vision post-chrétienne de la politique contemporaine, même si les médecins, les syndicalistes et les professeurs ont remplacé les prêtres dans leur rôle d'encadrement de la population.
Depuis leurs créations, la Sécu et le salaire minimum ont depuis longtemps atteint leurs limites. Leur bon fonctionnement a été conditionné par le plein-emploi des Trente Glorieuses, tant que le nombre de salariés travaillant à temps-plein était suffisant pour financer le système. Avec la tertiarisation de l'économie, le chômage et le creusement des inégalités, les aides sociales étaient censées combler le manque de ressources et un revenu minimum fut crée en 1988, le RMI, devenu RSA en 2007. Le changement de qualificatif indique bien l'évolution des mentalités à propos des aides sociales : alors que c'était conçu comme un minimum en vue de l'insertion professionnelle, typiquement salariée, comme une mesure d'assistanat pour les plus nécessiteux qui désirent retrouver un emploi, le revenu minimum est aujourd'hui qualifié d'activité solidaire, un revenu de base que le travailleur continue de toucher en partie lorsqu'il reprend une activité rémunérée. Ce glissement n'est pas uniquement sémantique, il révèle aussi une transformation du rôle de certaines aides sociales qui passent de l'assistanat pour les moments difficiles à une assurance de long terme qui sécurise le parcours du bénéficiaire, même s'il est encore obligé de rechercher ad vitam æternam un emploi salarié qu'il mettra parfois des mois et des années à trouver. Implicitement, les gouvernements successifs ont acté que le chômage de masse est une variable d'ajustement qui guidera pour longtemps les politiques publiques.
Le simple gouvernement des corps de la société industrielle est devenu insuffisant parce que, d'une part, avec l'ouverture des frontières et du marché international, les conditions de vie ne dépendent plus autant des ressources nationales, mais des allocations de ressources partagées à travers le monde, et d'autre part, l'automatisation des industries et des services transforme profondément l'organisation de la production qui s'est déconcentrée, délocalisée et éloignée des centres urbains. L'intervention des citoyens dans les politiques publiques se partage avec de nombreux acteurs internationaux, via les traités, les accords multilatéraux et les stratégies des entreprises multinationales, et les autorités nationales gérant auparavant de grands monopoles publics nationaux sont actuellement contraintes par des structures globales qui, pour des raisons évidentes d'organisation, ne peuvent pas encore garantir une assurance collective équitable, surtout quand les accords commerciaux du marché global entérinent des rapports de force entre les parties contractantes, inégaux à cause des écarts de développement.
Forts de ce constat, deux solutions sont avancées par les partis politiques : soit une gestion rétroactive, conditionnelle et différée, financée par une capitalisation individuelle semi-privatisée où chacun reçoit en proportion des moyens qu'il réussit à gagner, avec des petites aides publiques de base qui ne creusent pas les déficits sociaux et publics. C'est la version plutôt libérale et en partie social-démocrate, influencée par un modèle auto-entrepreneurial microéconomique, fondé sur le mérite individuel. L'inconvénient de cette pratique est, comme souvent chez les libéraux, d'appliquer en tout point une échelle microlocale, creusant les différences contextuelles, qui sont naturellement censées s'autoréguler entre elles. Cela engendre un processus qui rend imprévisibles les ajustements, et qui oblige à prendre en compte a posteriori les risques qui somme toute sont assez fréquents, finissant par creuser les budgets et alourdir la dette – risques sanitaires, reconversion industrielle, accidents du travail... C'est le choix de la société du risque financé par la dette privée. Soit – deuxième choix – une gestion proactive, inconditionnelle et immédiate, avec une socialisation a priori de tous les aléas grâce à un dispositif financier collectif généralisé, à guichet unique, prenant en charge les types de risque les plus courants, où chaque citoyen reçoit à la base une part égale malgré la diversité des parcours et des contextes, en dédiant seulement les ajustements aux risques extrêmes (réanimation hospitalière, catastrophe naturelle ou industrielle...), ce qui limiterait la gabegie d'une gestion administrative rétroactive (down/top) qui chercherait à équilibrer tous les particularismes afin de retrouver une certaine cohésion. C'est le choix de la société de la sécurité sociale financée par le déficit public, influencé par le modèle keynésien et fondé sur une vision macroéconomique globale, qui pourrait être social-démocrate, mais reste simplement socialiste et irréaliste pour le moment.
2. Avenir utopique contre réalisme dépassé : enjeux sociopolitiques actuels.
Voilà qu'arrive un candidat socialiste – Benoît Hamon –, a priori relégué au banc des seconds couteaux de la primaire du Parti Socialiste, dont le tempérament assez pondéré le distingue des autres candidats aux présidentielles qui parlent de plus en plus fort pour être entendus, distille tranquillement des idées qui sont assez en pointe dans les recherches en sciences sociales – cas assez rare pour ne pas être signalé –, mais qui paraissent si incontrôlables et imprévisibles que les adversaires en ont les jambes coupées, les supporters devenant plus en plus galvanisés. C'est aussi une victoire idéologique dans l'ensemble du champ des compétences de la gauche, partagé entre d'un côté les gestionnaires du système social hérité des Trente Glorieuses, aujourd'hui en collaboration avec le néocapitalisme transnationalisé, et face à eux des élites culturelles libertaires généralement affublées de l'insigne suprême de bobo, aujourd'hui menacées de déclassement et tentant de reprendre l'initiative avec des projets de réforme audacieux.
Une revanche sociologique, en somme, car on l'oublie trop souvent la politique est avant tout sociologie, avant d'être morale, justice ou idéologie. Alors que même un dictateur croupion de bas étage le comprend assez vite, la plupart des grands commentateurs qui tonnent dans les médias comment il faut penser, voter, réfléchir, analyser et agir, sont focalisés par l'image fixe de l'éternel pouvoir suprême – entendre : le réalisme politique – et font l'économie de ne pas mettre en perspective les grands débats économiques avec les micropouvoirs, pas seulement entre tel et tel ministre comme ils le font habituellement, mais entre tel salarié et tel employeur par exemple, ou alors entre un élève et son professeur. Désolé, mais le gouvernement n'a toujours été, sauf à de rares moments de tension aiguë, qu'une coquille vide ou résonnent des volontés particulières. Parler de gouvernement réaliste n'a de sens que si et seulement si ces volontés particulières sont entendues et entremêlées dans une action commune qui ne peut pas être du seul ressort légal des meilleurs professionnels de la politique. Le pouvoir est quelque chose de diffus, microlocal, quasiment indicible, diffracté et polarisé en tous sens et à tous les niveaux. Et le gouvernement n'est qu'un grand miroir déformant de cette réalité, une superstructure imaginaire qui cumule les effets d'annonces, les capitalise dans une grande cassette médiatique dont le ronron est entretenu par des conseillers en communication qui se ressemblent. La vrai politique singulière est la plupart du temps locale. Peu importe que le gouvernement soit réaliste, irréaliste, de gauche ou de droite, même si dans certains cas cela est plus avantageux pour donner de l'envergure à une action politique.
Un cas récent démontre assez bien que la sociologie rattrape la politique politicienne et la recouvre par la même occasion : la loi El-Khomri. La plupart des partis politiques sont d'accord pour réformer le marché du travail, le gouvernement discute un peu avec les patrons et les syndicats, il y a quelques blocages comme d'habitude, et on appuie sur quelques boutons : le 49-3, la menace de sanctions et l'affaire est considérée vite réglée quand la loi est adoptée. Pourtant, dès le lendemain, plus personne n'y croit et la loi elle-même ne devient qu'un tuyau de plus dans la machinerie ingérable du marché du travail. Pourquoi ? Parce que dans une telle instabilité juridique, chacun, quel qu'il soit, craint les représailles de tous les autres et préférera sans doute adopter les règles les plus anciennes, et donc les plus solides : CDD et CDI.
L'encadrement humain de la population française n'est pas assez puissant pour lui faire courber l'échine et accepter une diminution de ses salaires et de ses conditions de vie, voilà la réalité. Vieillissants, la plupart des cadres actuels des administrations et des entreprises ont commencé leurs carrières dans les années 1970, 1980 et 1990, et ils savent pertinemment qu'ils sont les privilégiés d'un modèle social qui est à bout de souffle, et certains sont bien conscients d'être pris entre deux feux. Ce que les réformateurs veulent retirer du code du travail est justement ce qui a permis à beaucoup de ces cadres d'arriver là où ils sont, et sauf dans le cas de certaines grandes structures qui peuvent amortir les chocs (comme l'entreprise Nissan-Renault), l'encadrement socioprofessionnel français ne dispose pas de la force suffisante pour imposer des sacrifices en vue de se maintenir elle-même dans sa propre position, tout en rétrogradant ceux d'en-dessous. Pour faire bonne mesure, ajoutez à ce problème de domestication des masses, cette impuissance manifeste qui se fait passer pour de la grande politique avec force d'autorité, une touche complotiste droitière de choc culturel ou de grand remplacement, et la population, paniquée, se dirige aux endroits où les grands médias la conduisent : vers les extrêmes, pour que la hiérarchie actuelle reste en l'état et ne soit pas menacée dans ses positions les plus élevées. Reste un centre pétrifié idéologiquement dans le ni-gauche ni-droite, invités à partager leurs négations mutuelles. Pour faire de la politique, il ne suffit pas d'afficher au-dessus d'un fauteuil vide un organigramme de gens qui ont l'air raisonnables et, qui plus est, sortis tout droit du moule technocratique. Sentir dans la banalité du quotidien quels sont les discours qui dominent, les comportements qui se répandent et les modes qui sont adoptées, est indispensable pour organiser le dialogue social et appliquer des mesures concrètes qui satisfassent le plus grand nombre. En France, l'autorité ne tient qu'à la force de l'argent, c'est simple, tout le monde est d'accord là-dessus, mais qu'advient-il lorsque le rapport s'inverse, quand l'argent ne tient plus qu'à la force de l'autorité ?
En premier lieu, le régime politique de la France fait face à un problème de violence culturelle qui n'est pas nécessairement ethnique et religieux – le concept d'identité en est une formulation plébéienne malheureuse qui fait le succès du Front National. Quand-est ce que les gestionnaires de gauche réaliste vont enfin le comprendre ? Que l'économie n'est pas tout dans la vie ? Par culture j'entends à la fois la manière de vivre, les traditions, l'imagination et les projets collectifs, la recherche scientifique et les arts, en opposition contradictoire avec le consumérisme, la grande industrie, la mécanique, la physique appliquée, le conformisme à un modèle unique standard, la bureaucratie gabegique remplie de bullshit jobs et d'emplois fictifs (suivez mon regard), c'est-à-dire tout le fonds inusable du néocapitalisme financier. Se proclamer et hurler à tue-tête réaliste est comme réciter une incantation religieuse face à un robot géant qui ne répondra à aucun vœu. Le gouvernement réaliste ne s'adresse pas à des êtres humains, mais à des machines qui transforment tout ce qui est superflu en réalité intelligible pour les humains.
Le réalisme en politique est tout de même nécessaire parce qu'il est le principe moteur du productivisme depuis plus de 50 ans en France, et se passer de la production serait bien difficile, mais la singularité des êtres humains, ces primates récalcitrants, est d'en vouloir toujours un peu plus, d'avoir une étoile à leur nom, ou que sais-je ? Un objet particulier qui les sorte de leur animalité quotidienne, pas des mots creux qui ne veulent plus rien dire ou des concepts tellement réifiés et usés par le temps et la production en masse des industries culturelles – la presse à grand tirage en fait parti. Une douce utopie singulière et irréaliste est justement la plus à même de mobiliser la population, notamment jeune : parce que l'utopie est justement irréalisable, elle donne ce continuum infini dont seul est capable les grandes idées prometteuses qui ont mobilisé tant de millions d'êtres humains : le progrès, la justice sociale, l'égalité, la liberté, la richesse (dans sa manifestation collective et populaire), l'immortalité, le divin, le beau, le bien. Trop fini dans sa conception, le réalisme ne fait pas parti de ces idées-là, de même que le racisme ou le nationalisme, un temps prometteur mais insuffisant dans le long terme car trop discriminant et destructeur. C'est la direction qui est en train d'être suivie aux États-Unis et espérons qu'ils se réveillent bientôt et nous redonnent le visage d'une nation consciente de sa responsabilité dans les relations internationales.
3. Une société post-industrielle qui ne s'assume pas.
L'expression fin du travail que Benoît Hamon reprend du célèbre ouvrage de Jeremy Rifkin qu'il publia en 1995 (The end of work : The decline of the global labor force and the dawn of the post market era), n'est pas tirée d'un mode d'emploi sur le désœuvrement dans une société insoucieuse du capitalisme industriel. Assez des caricatures régulièrement entendues que les bénéficiaires d'aides sociales sont payés à ne rien faire, que seul le travail (salarié) vaut quelque chose, que l'horizon futur de la société contemporaine est impensable en dehors du système salarial. Cette réaction peut se comprendre, parce que la vie quotidienne était bien plus difficile avant que le salariat se généralise, mais cette peur de revenir en arrière est davantage devenue une justification pour conserver une routine usée que de mettre en place un projet de société viable pour le futur. C'est en raison de la performance du système actuel que nombre d'individus sont payés à ne rien faire, il ne faut pas se tromper sur le constat. C'est en raison de l'efficacité productive de notre économie que nombre d'actifs ne soient plus obligés de travailler pour assurer le bon fonctionnement de l'ensemble.
La promesse du revenu universel surgit alors comme l'apparition d'une nouvelle grande idée utopique qui propose la conciliation entre le fini et l'infini, l'animal et l'humain, le gestionnaire et l'artiste. Il faut remonter au moins jusqu'aux années 1960 pour retrouver un projet politique aussi audacieux en matière sociale. C'est une nouvelle chance historique pour la gauche de sensibiliser tous les citoyens jusqu'à l'extrême-droite. Le revenu universel est un accord a minima qui nous concerne tous sans exception. Il faut le lui reconnaître : Benoît Hamon, engoncé au milieu d'un parti de notables assez conservateurs, a eu le sacré culot de s'en faire le porte-parole, et Jean-Luc Mélenchon, aussi en pointe sur pas mal d'idées programmatiques, pourrait lui tendre un chapeau. Le potentiel de cette nouvelle grande idée n'est pas tant de permettre de faire vivre décemment des millions de pauvres que d'autoriser tous les ajustements possibles et inimaginables, de mettre toutes les choses à plat sur une ligne continue en n'étant pas toujours bloqué par tout ce qui est nécessaire, tous les contre-mouvements qui enterrent si facilement les projets politiques, notamment écologiques. Le revenu universel permettrait aussi une libération phénoménale d'énergie insoupçonnée : la subsistance étant découplée du travail, et l'enrichissement de la nécessité, l'agriculture, le secteur primaire, disposera enfin des marges suffisantes pour offrir une production de qualité. Cette libération partielle du travail salarié par lequel les employeurs se substituent à la force publique en disposant de facto le droit de vie ou de mort sur ceux qui lui sont dépendants, permettrait d'assouplir largement le marché du travail, et dans les cas où cela est nécessaire, d'appliquer la flexibilité maximale que les patrons libéraux recherchent tant. Si la vie quotidienne de l'actif ne dépend plus autant de son contrat de travail, les employeurs disposeraient de plus de liberté dans le domaine contractuel. En outre, le travail ne serait plus cette éternelle cage de fer qui bloque les initiatives et brise tant de projets de reconversion, d'engagements familiaux, et d'actions bénévoles qui sont essentielles à la vie sociale du pays. Ceux qui ne devraient pas être là où ils sont, quand d'autres aimeraient prendre leurs places : ceux qui font le travail à moitié, posent des congés maladie à rallonge et font de l'absentéisme pour se faire licencier parce qu'ils veulent changer de travail ou se former mais ne le font pas, de crainte de ne pas trouver de débouchés ; beaucoup d'étudiants modestes obligés de faire un travail pénible alors que les postes qu'ils occupent pourraient être donnés à des immigrés pauvres, des individus désocialisés ou des jeunes actifs débutants ; tous ces entrepreneurs et ces cadres hautement qualifiés, obligés de faire au moins 50 heures par semaines pour faire toutes les tâches nécessaires, qui pourraient parfois diminuer leur quota en ayant recours à des contrats plus flexibles pour recruter des subalternes qui les déchargeraient le moment d'une surcharge de travail. Enfin, toute la pluralité phénoménale des aides existantes, confinant à la schizophrénie analytique, dont l'attribution nécessite une administration pléthorique, et qui font souvent l'objet de fraudes massives implicitement tolérées pour éviter une guerre sociale permanente, pourrait être unifiée dans un revenu universel, à l'exception des allocations familiales, selon moi, parce que les mineurs ne peuvent pas être comptés comme bénéficiaires du revenu de base, et par conséquent doivent conserver les aides qui leur sont normalement allouées.
J'oserais même dire, avec provocation, que le revenu universel, concept plutôt considéré de gauche, est compatible avec l'ultralibéralisme qui a besoin chaque nanoseconde d'acheter et de vendre grâce à un marché super fluide où il n'y a aucun blocage.
Avec cette nouvelle allocation, c'est aussi la reconnaissance que tous les types d'activité utiles à la société se valent, que les rapports commerciaux ne soient pas le seul dénominateur commun que partagent les citoyens. Que serait un pays sans artistes, sans bénévoles, sans tous ces agents sociaux précarisés qui favorisent la paix civile ? Indirectement, les activités qui ne sont pas rémunérées habituellement le deviennent et ce qui est superflu dans le système de travail, notamment les bullshit jobs de la bureaucratie et des services, est renvoyé vers le tissu associatif et auto-entrepreneurial, comme c'est déjà le cas dans nombre de communes françaises avec les délégations de service public en tous genres.
Toutes sortes de correspondances peuvent être imaginées à partir du moment où chacun est assuré de retrouver la même mise de départ, égale en tout point dans le temps et l'espace, c'est-à-dire infinie, traversant toutes les frontières sociales, territoriales et politiques, et bénéficiant autant à un riche héritier qu'à un sans-abris. Seule la sécurité sociale votée en 1945 peut se targuer d'avoir conquis une telle étendue, et comme la France actuelle cherche un peu la solution qui résolve toutes les questions, un vrai revenu universel permettrait enfin d'appliquer une véritable réforme du marché du travail à laquelle tiennent tant les élites gestionnaires du pays. Vous ne pouvez pas dire à un pauvre de renoncer à son assiette pour l'obliger à manger dans ses propres mains. Même un chien dispose du luxe d'avoir sa propre gamelle. Et si d'autres pays en Europe ont réussi à réformer leurs régimes sociaux, c'est en vertu d'autres compromis socio-historiques qui ne nous concernent que partiellement. De plus, il est quand même utile de rappeler que certains pays ont été purement déclassés, comme la Grèce, l'Italie et le Portugal, avec une misère qui s'est répandue à travers tout le continent. En voulant continuer cette politique européenne d'austérité en l'appliquant aussi chez elle, la France n'a t-elle donc plus autre chose à proposer que de diminuer les conditions de vie de la population ? Est-elle définitivement déclassée, à ranger parmi les vieilles armoiries de l'époque médiévale, sans un avenir digne de son héritage moderne et révolutionnaire ?
Allez, chiche ! Cassons la baraque !
Vive le revenu universel européen !
Ilustration : www.terresacree.org, Revenu universel de base – La Finlande a commencé, le Monde entier en parle ! Écrit par Jacky.
15 réactions à cet article
Ajouter une réaction
Pour réagir, identifiez-vous avec votre login / mot de passe, en haut à droite de cette page
Si vous n'avez pas de login / mot de passe, vous devez vous inscrire ici.
FAIRE UN DON