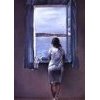Les chasseurs d’immortalité
Anne Rice, à travers sa série de livres consacrée aux aventures de Lestat, et notamment « Entretien avec un vampire », abordait le thème de l’immortalité et des interrogations spirituelles et philosophiques qui en découlent. Comment vivre en sachant que l’on a l’éternité devant soi ?
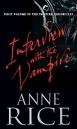 Comment concilier la sensation exaltante d’être l’égal d’un dieu, d’être enfin débarrassé des peurs liées à la maladie, à la souffrance et à la mort, avec celle vertigineuse de devoir vivre des siècles sans savoir quoi faire de ces milliards de jours et de nuits d’éternité. Il est vrai que dans ses romans, le mythe romanesque du vampire, buveur de sang, qui garde néanmoins la conscience de ce qu’il fut, est aussi associé à la solitude, ou à la seule compagnie d’êtres lui ressemblant. Fatalement tout n’est que lassitude suivie de mélancolie, humeur très humaine s’il en est. Et au final, cette immortalité-là n’apparaît guère enviable.
Comment concilier la sensation exaltante d’être l’égal d’un dieu, d’être enfin débarrassé des peurs liées à la maladie, à la souffrance et à la mort, avec celle vertigineuse de devoir vivre des siècles sans savoir quoi faire de ces milliards de jours et de nuits d’éternité. Il est vrai que dans ses romans, le mythe romanesque du vampire, buveur de sang, qui garde néanmoins la conscience de ce qu’il fut, est aussi associé à la solitude, ou à la seule compagnie d’êtres lui ressemblant. Fatalement tout n’est que lassitude suivie de mélancolie, humeur très humaine s’il en est. Et au final, cette immortalité-là n’apparaît guère enviable.
Frankie a revu récemment un épisode d’X-Files dans lequel il est aussi question d’immortalité : un homme, oublié par la mort, la traque indéfiniment avec ses appareils photos partout où elle frappe dans le seul espoir qu’elle le voie enfin et le prenne. Les souvenirs des temps heureux lui font défaut et il ne sait même plus ce qu’il fait sur Terre.
Les souvenirs des temps heureux lui font défaut et il ne sait même plus ce qu’il fait sur Terre.
Dans ces deux cas de figure, il y a solitude parce que l’immortel se trouve seul, perdu dans le vaste monde. Mais qu’en serait-il si nous devenions tous immortels ?
Sigmund Freud disait : "Au fond, personne ne croit à sa propre mort, et dans son inconscient, chacun est persuadé de son immortalité". Cette sensation d’invincibilité que procure souvent la jeunesse où l’on croit que demain sera toujours suivi de lendemains, incertitudes et réflexions lorsque la mort nous rattrape de façon sournoise, frontale et abjecte. Et une prise de conscience cruelle de cette finalité pour tous : ce qui vit, meurt. Si vous demandez autour de vous que l’on vous donne le contraire du mot "mort", souvent vous entendrez spontanément, la vie. Or il y a un mot bien plus approprié : c’est "naissance". Considérer la mort comme la fin naturelle d’un cycle et l’accepter comme telle incite les êtres à vivre chaque instant intensément, sachant qu’il peut être le dernier ; mais dans nos sociétés occidentales, la mort reste un sujet tabou et lorsqu’enfin on ose l’aborder de face, c’est souvent qu’un drame personnel nous y a obligé. Et là forcément, nos interrogations se tournent vers la philosophie ou la religion. Rarement vers la science.
Rarement vers la science.
Il existe pourtant un petit groupe de scientifiques que l’on pourrait baptiser les "chasseurs d’immortalité", des prophètes d’un genre nouveau qui se situent à la frontière de la science et de la science-fiction, et qui partagent un même objectif : "tuer la mort !" Utopie ? Folie ? Leurs expériences et leurs projections dans le futur ne le sont peut-être pas autant que cela. Apprentis sorciers certes, mais les hommes de science ne le sont-ils pas tous un peu ?
Pour ces traqueurs de la mort, le vieillissement ne serait pas une fatalité, mais une maladie qu’il faut combattre. Ce sont des scientifiques ayant une expérience en biologie, en génétique, en informatique, qui visent la "longévité éternelle", credo s’il en est de notre société moderne.
Le premier se nomme Aubrey de Grey : il a publié en 97 dans Bioessays sa première découverte où il mettait à jour des processus avant lui inconnus dans les "mitochondries" : des structures internes à la cellule qui libèrent de l’énergie. Cet homme est informaticien au département de génétique de Cambridge. Il estime que notre vision de la vie est imprégnée de fatalisme et que cela empêche les scientifiques de réfléchir au moyen de traiter le vieillissement alors que les avancées de la science le permettent. Il a identifié sept phénomènes principaux détruisant à terme nos cellules et a proposé sept stratégies pour les combattre. L’expérience qu’il rêve de concrétiser et qu’il juge réalisable d’ici sept à vingt ans : faire vivre une souris plus de cinq ans ce qui équivaudrait à 150 ans pour un être humain.
Max More, lui, est certain que la science peut pulvériser toutes les limites. Il est docteur en philosophie et a formé un groupe appelé les "Extropiens", ("extropie" étant le contraire de l’entropie qui est la dégradation de l’énergie) réunissant spécialistes de  l’intelligence artificielle, mathématiciens, théoriciens : tous estiment que l’humanité n’est qu’une phase transitoire et que la mort est un problème que la science peut résoudre. En conclusion pour les "Extropiens", l’immortalité serait de l’ordre des mathématiques et non du mystique...
l’intelligence artificielle, mathématiciens, théoriciens : tous estiment que l’humanité n’est qu’une phase transitoire et que la mort est un problème que la science peut résoudre. En conclusion pour les "Extropiens", l’immortalité serait de l’ordre des mathématiques et non du mystique...
Max More combat le pessimisme stagnant comme il le nomme représenté par les religions notamment qui font accepter aux hommes leurs limites. Selon lui grâce aux nouvelles technologies nous allons devenir des "post-humains" : il deviendrait possible alors de suppléer à nos maladies qu’il considère comme des bugs, des défauts de programme, en réparant nos corps grâce à des implants d’organes bioniques. Le contenu du cerveau serait transféré dans des réseaux informatiques, comme on sauvegarde un disque dur, réalisant la symbiose entre esprit et machine. Et après tout pourquoi pas ? Nous portons bien des lentilles de contact, des prothèses de hanche ou des pacemakers, et il existe aujourd’hui des prothèses du bras et de la main intelligentes dites "myoélectriques".
Quant à Ray Kurzwell, ingénieur de son état, il écrit dans son dernier livre L’Age des machines spirituelles : "Beaucoup de choses vont se passer dans les cent années qui viennent. Les avancées technologiques s’accélèrent et le prochain siècle en produira autant que les dix siècles précédents. Bien avant 2099, nous aurons par exemple les moyens de scanner mon cerveau et d’en enregistrer le moindre détail, chaque connexion neuronale, chaque concentration de neurotransmetteurs, chaque fente synaptique, chaque cellule. Puis nous pourrons le reproduire, le copier dans un ordinateur neuronal de capacité suffisante, afin de fabriquer une copie parfaite de mes pensées, de mes souvenirs, de tout ce que je sais faire."  En conclusion, il affirme que vers 2040/2050, nous aurons une grande quantité d’intelligence non-biologique dans le cerveau introduite sans opération chirurgicale, mais grâce à la nanotechnologie, de petits "nanorobots" qui suivront la circulation sanguine. L’immortalité enfin atteinte sous la forme d’une fusion de l’homme et de l’ordinateur.
En conclusion, il affirme que vers 2040/2050, nous aurons une grande quantité d’intelligence non-biologique dans le cerveau introduite sans opération chirurgicale, mais grâce à la nanotechnologie, de petits "nanorobots" qui suivront la circulation sanguine. L’immortalité enfin atteinte sous la forme d’une fusion de l’homme et de l’ordinateur.
Et tout à coup, cela fait froid dans le dos, car si un gouvernement se mettait à nous implanter un "nanorobot", pas plus gros qu’une tête d’épingle, dans le cerveau, Frankie pense immédiatement au pire scénario qui soit : "la centralisation du pouvoir de contrôle".
D’autres hommes avant eux ont cru à l’immortalité du corps : Alexandre le Grand, le médecin et philosophe arabe Avicenne, le théologien, mathématicien et astronome anglais Roger Bacon, ils ont tous partagé la même espérance d’une immortalité physique. Mais aucun d’eux n’a trouvé la formule magique.
Entre lectures vampirique où les immortels ont des états d’âme au point de vouloir redevenir humains, et films de cinéma où certains répliquants sont plus humains que ceux qui les exterminent, Frankie flippe à l’idée de se trouver un jour transformée en femme bionique de série TV. Quant à la vision de ce monde transposé à l’infini, elle ne l’envisagera que si on lui garantit la parole de Dieu dans l’Apocalypse de saint Jean : "De mort, il n’y aura plus. De pleurs, de cris et de peine, il n’y en aura plus, car l’ancien monde s’en est allé."
où les immortels ont des états d’âme au point de vouloir redevenir humains, et films de cinéma où certains répliquants sont plus humains que ceux qui les exterminent, Frankie flippe à l’idée de se trouver un jour transformée en femme bionique de série TV. Quant à la vision de ce monde transposé à l’infini, elle ne l’envisagera que si on lui garantit la parole de Dieu dans l’Apocalypse de saint Jean : "De mort, il n’y aura plus. De pleurs, de cris et de peine, il n’y en aura plus, car l’ancien monde s’en est allé."
Restons raisonnable, car entre menaces en tout genre et autres absurdités humaines, on ne sait pas encore ce qui va nous tomber sur le coin de la gueule. Immortalité ou non, il y a aura toujours un affreux jojo pour faire buguer les circuits !
24 réactions à cet article
Ajouter une réaction
Pour réagir, identifiez-vous avec votre login / mot de passe, en haut à droite de cette page
Si vous n'avez pas de login / mot de passe, vous devez vous inscrire ici.
FAIRE UN DON








 bien vu pour la 3e personne...
bien vu pour la 3e personne...