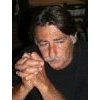Les clés (contradictoires) d’une élection

Le président Sarkozy « serait prêt à inclure le mariage gay à son programme ». François Hollande « va utiliser des personnalités non politiques et de manière non conventionnelle durant sa campagne ». Eva Joly se propose de créer deux journées fériées supplémentaires, l’une musulmane, l’autre juive. Marine Le Pen, tout comme Villepin ou Boutin offrent une augmentation chiffrée (et significative) des salaires, Le Pen et Dupont d’Aignan font de la sortie de l’euro leur cheval de bataille. Le candidat socialiste imagine une augmentation par milliers des enseignants, Sarkosy voudrait instaurer, (seulement) ici mais maintenant une TVA sociale et une taxe Tobin. Bayrou, lui, mène campagne pour « acheter français »…
Il y a certainement du pour ou du contre à toutes ces mesures, ces propositions, ces manières de faire de la politique. Elles ont cependant un point commun (et elles ne sont pas les seules) : elles répondent de manière ponctuelle - irrationnelle souvent -, aux angoisses, aux peurs aux préoccupations de la société française (et/ou à certains de ces secteurs). On leur donne un nom commun et fourre tout : la crise. Or, celle ci est (et restera) polymorphe. La crise économique et financière est éminemment politique : qu’elles soient bonnes ou mauvaises, « réalistes » ou « irréalisables », les propositions, qu’elles viennent du FN ou du Front de gauche, ont le vent en poupe par ce que elles sont holistiques : elles sous tendent une solution frontale, globale, une rupture. Rupture donc, voilà la première clé. Même si cela reste au niveau des intentions et, déclinées, elles feront apparaître un nombre de contradictions insurmontables, les propositions qui remettent en cause le système apparaissent - saut vers l’inconnu -, comme alléchantes. C’est dire à quel point ce qui existe aujourd’hui paraît de plus en plus invivable. Cela amène à une deuxième clé : le rejet. Le rejet touche principalement le pouvoir en place, mais aussi, à des degrés divers l’ensemble de la classe politique et plus particulièrement les partis les plus importants, ceux qui proposent d’agir sur le système, le contrôler, le rendre plus juste et plus humain mais ne le contestent pas comme une globalité, un holos. Une contradiction classique entre « gestionnaires » (bons ou mauvais) et « révoltés » (réels ou putatifs). Il existe chez les « gestionnaires » une frange qui s’inquiète de cette tournure des choses, qui l’explicite, et qui pense que si les changements restent dans un cadre classique, les « révoltés » auront, tôt ou tard, le dessus, deviendront des indignés, des protestataires, des 99%. Il existe aussi chez les révoltés ceux qui pensent que sans cohérence, sérieux, sens des responsabilités, leurs objectifs ne seront pas suivis. Cela amène à une troisième clé, celle qui gère la relation entre le désir (de changement) et la peur (de l’inconnu). En effet, avec la « crise », les deux sentiments coexistent aussi bien au sein de la société que à l’intérieur de chaque citoyen. Ceux qui misent exclusivement sur la peur, et ceux qui misent, aussi exclusivement, sur un désir compulsif de changement, seront, d’une manière ou d’une autre, éliminés. Car, et une autre clé réside là, individus et société, hypersensibilités, décèlent en un clin d’œil l’hubris, la démesure, le surfait et l’instrumentalisation. Les vendeurs de rêves illimités, come ceux qui prévoient le déluge hors eux mêmes et leur action - la guerre disent certains -, sont d’emblée inaudibles, incapables désormais d’influencer quoi que ce soit. Le messianisme (sous toutes ces formes) sera battu lors de ces élections. Tour comme les apprentis sorciers (même ceux qui, à cent jours des élections, pensent avoir le vent en poupe).
On dit souvent qu’une société moderne devient ingouvernable, tant les demandes, les désirs, les revendications des groupes et des corps constitués, tant la société morcelée et privée d’objectifs partagés, court-circuitent le projet commun. Cela amène le politique à décliner à l’infini et selon les désirs des uns et des autres, des propositions sectorielles, qu’elles se situent au niveau professionnel, économique, culturel, confessionnel, sexuel, coutumier, régional, local, etc. Cette mécanique, qui transforme le politique en commercial vantant des produits incompatibles les uns aux autres et qui renforce l’éclatement sociétal, était jusque-là efficace pour gagner une élection mais rendait la gouvernance un exercice frustrant et paralysant, tout en cultivant chez le citoyen le sentiment d’avoir été berné ou, pire, d’être gouverné par des incapables. Ces sentiments, font aussi partie de la « crise », et, l’expérience aidant, rendent tout projet centrifuge suspect. Aujourd’hui, vouloir donner une réponse positive à tous devient synonyme de ne pouvoir rien régler du tout. Voilà ici une autre clé, elle aussi contradictoire : la divergence entre le plus petit et le plus grand dénominateur. Car au sein de chacun il existe un désir de bien (et de programme) communément partagé mais aussi un désir de reconnaissance et de réponse à ses besoins les plus intimes. Si les propositions penchent trop d’un côté ou de l’autre elles deviennent suspectes, irréalisables, prennent surtout une connotation de déjà vu, d’arnaque annoncée. Surtout si ces propositions se veulent divergentes (voir étonnantes) par rapport à l’idée que se fait le citoyen du rôle global que joue celui qui les propose : lorsqu’on est incapable de résoudre les souhaits de son supposé propre camp, comment ose-t-on proposer des solutions appartenant à un autre ? Ici réside une autre clé : à chacun sa place (réelle ou supposée). La « fracture sociale » chiraquienne et ce qui en suivit, ont donné un coup fatal aux expéditions idéologiques d’un camp vers un autre.
A suivre…
11 réactions à cet article
Ajouter une réaction
Pour réagir, identifiez-vous avec votre login / mot de passe, en haut à droite de cette page
Si vous n'avez pas de login / mot de passe, vous devez vous inscrire ici.
FAIRE UN DON