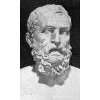Les ROHINGYA au Myanmar ; victimes des Birmans ou des dominions de l’empire britannique, du Pakistan, du climat, de leur religion ?

Les insupportables violences d’aujourd’hui envers les Rohingya sont les éternelles résurgences de conflits que les britanniques avaient pourtant limités pour une grande part lors de la partition de l’empire des Indes en 1947 entre l’Inde et le Pakistan, en considérant leurs religions.
Après le déplacement de 12 millions d’individus et 3 millions de morts, des frontières apparaissent. L’Inde regroupe les territoires des populations hindouistes et le Pakistan ceux des musulmans. Ces états deviennent des dominions britanniques quasiment indépendants.
Le Pakistan d’alors comprend deux territoires distincts éloignés de 1600 km, le Pakistan actuel et le Bengladesh qui, négligé par le pouvoir pakistanais, déclarent son indépendance en 1971.
Les conditions de vie des bengalis dans un pays surpeuplé, d’une grande pauvreté et soumis à des conditions climatiques sévères peuvent expliquer pour une part les motifs de leur immigration en Birmanie.
L’origine du territoire des Rohingya, musulmans, est encore discutée mais pas celle de leur dialecte proche du bengali.
Comme toujours (*), le marqueur religieux contribue notamment à isoler les communautés. Elles grandissent, veulent imposer leurs modes de vie différents de celui du pays d’accueil. Des étincelles culturelles suffisent alors à exacerber les tensions sous-jacentes.
D’où viennent les torts ?
Des britanniques qui auraient dû organiser différemment les frontières et permettre aux bengalis musulmans de rejoindre l’actuel Pakistan ?
Des pakistanais qui ont délaissé un Bengladesh enfoncé dans la misère ?
Des bengalis dont le pouvoir n’a pas su (ou pu) gérer son développement et sa démographie ?
Des birmans incapables de gérer une immigration clandestine massive, culturellement différente, qui souhaite obtenir la citoyenneté birmane ?
Des institutions internationales ?
….
Avant de porter un jugement sur les décisions Birmanes, deux considérations :
- Rappelons-nous le point de vue français de 2013 à propos des Roms apatrides (comme les Rohingya).
Le ministre de l’intérieur s’interrogeait sur la « vocation » des Roms et déclarait : ils « ont des modes de vie extrêmement différents des nôtres et (ils) sont évidemment en confrontation » : « nous le savons tous, la proximité de ces campements provoque de la mendicité et aussi des vols, et donc de la délinquance… les Roms ont vocation à revenir en Roumanie ou en Bulgarie ». Des Roms ont alors été expulsés de France.
- Le seul fait que M Erdogan adresse, avec d’autres pays musulmans, les mêmes reproches au Myanmar qu’Al Qaïda prolonge par des menaces à l’encontre du Myanmar doit nous rendre circonspects quant aux réelles motivations de ces critiques.
Essayer de comprendre le silence de la présidente Madame Aung San Suu Kyi est une politesse à lui rendre avant de se ranger derrière les vives critiques qu'elle reçoit. L’histoire de cette femme et son combat pour les droits démocratiques des birmans lui ont valu le respect et un prix Nobel de la Paix, preuves de sa conscience.
Alors ?
Comme celle des Rohingya, l’histoire des birmans est à considérer avant de se limiter à la lecture des articles alarmistes incomplets ou faux que la presse « rapide » recopie en boucle. Le Monde (http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2017/09/12/crise-des-rohingya-en-birmanie-fausses-informations-a-tous-les-niveaux_5184585_4355770.html) nous livre opportunément des informations qui éviteront certains à crier aveuglément avec les loups…
Indépendante en 1948, la Birmanie s’étend sur un territoire de 2000 km composé de très nombreuses minorités culturellement hétérogènes parlant des langues différentes mais cimentées par la même religion, le bouddhisme
Aung San Su Kyi dirige donc une mosaïque ethnique source de conflits, avec le nord du pays encore sous le contrôle des rebelles trafiquants d’opium avec la Chine. Les militaires restent incontournables et surveillent les évolutions et les décisions politiques. Le gouvernement a fait preuve de sa volonté d’unification. Il n’a pas hésité à changer le nom du pays devenu Myanmar, abandonnant la référence à l’ethnie dominante des Birmans (60% de la population) et à créer une nouvelle capitale ex nihilo Naypyidaw située au milieu du pays. La volonté de créer un nouveau pays sans privilégier une composante ethnique est donc manifeste.
Les limites de cette volonté d’intégration des différentes populations semblent cependant atteintes. A l’évidence, le pouvoir est embarrassé par « l’union nationale » de fait à l’encontre des Rohyngya musulmans, soutenue par l’influent pouvoir religieux bouddhiste. L’unité du Myanmar risquant d’être fragilisée par l’intégration d’une minorité immigrée illégalement, apatride, sans aucun droit et rejetée par la population birmane. La partition du territoire deviendrait alors un risque possible, ici comme ailleurs (*).
Jusqu’au XXe s. le déplacement des populations, solution brutale, s’accomplissait dans la douleur et réglait les conflits, cette solution n’est plus envisageable par nos sociétés modernes respectueuses des droits de chacun.
Ceci dit, qu’elle solution ? Forcer des populations aux paradigmes si dissemblables à vivre ensemble alors que leurs différences culturelles les a conduit à se haïr au point de ne plus pouvoir jamais s'entendre ?
L’Europe finance la Turquie pour accueillir les réfugiés du Moyen-Orient. Une aide internationale ne pourrait-elle pas encourager le Bengladesh, sous réserve de son accord, à recevoir les Rohingya ?
(*) https://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/l-immiscibilite-historique-des-189285
51 réactions à cet article
Ajouter une réaction
Pour réagir, identifiez-vous avec votre login / mot de passe, en haut à droite de cette page
Si vous n'avez pas de login / mot de passe, vous devez vous inscrire ici.
FAIRE UN DON