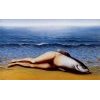Lobbying, ton univers impitoyable
Pressions, manipulation, pots-de-vin… On prête beaucoup d’influence – souvent néfaste - aux lobbies et techniques de lobbying dans nos démocraties. Défense des intérêts privés, à but lucratif ou non, cette pratique professionnelle n’épargne aucun secteur. Souvent critiquée, à la réputation sulfureuse, le lobbying a une image négative… d’autant que le lobbying à la française en accentue encore les travers et renforce la nécessité d’un code de bonne conduite pour une profession et des professionnels controversés. Analyse.
Le lobbying, pratique omniprésente et composante de l’économie de marché
La définition du lobbying est claire : représenter et la défendre des intérêts propres à un groupe donné, en exerçant influences et pressions sur des personnes ou institutions détentrices de pouvoir. Dans les faits, cela concerne principalement une cible politique, les pouvoirs exécutif et législatif. Pour le profane, il s’agit de scruter et d’anticiper toutes les décisions d’importance, et d’intervenir à tous les échelons du processus pour défendre les intérêts de ses clients. Pour le lobbyiste, l’objectif est simple : faire en sorte que l’impact soit le plus positif possible – ou le moins négatif – pour ses clients.
A tort ou à raison, le lobbying est largement associé aux grandes entreprises. Ces dernières ont des intérêts et enjeux tels qu’ils ne peuvent être laissés au hasard. Via les agences de lobbying, de plus en plus nombreuses, ces entreprises sont présentes dans les antichambres du pouvoir, et principalement à Washington et Bruxelles, hauts lieux des groupes d’intérêts. Aucun secteur ne peut se targuer de pouvoir se passer de cette pratique, associations à but non lucratif incluses. Le lobbying fait partie intégrante du processus démocratique et de l’économie de marché.
De fait, dans le monde anglo-saxon, le lobbying est une activité publique, scrutée et très réglementée. Au niveau européen, si la pratique est reconnue par les pouvoirs publics, son encadrement est néanmoins récent et embryonnaire. A cet égard, il existe des différences significatives entre lobbying anglo-saxon et français. Dans des pays comme les Etats-Unis ou le Royaume-Uni, ces métiers sont exercés autour d’une méthodologie et avec des structures et limites bien définis. La régulation du lobbying par la Commission européenne est à cette image, avec la mise en place d’un registre volontaire où l’inscription est pourtant systématique. En France, a contrario, le lobbying se rapproche encore beaucoup du « réseautage » pour ne pas dire du « copinage ». On utilise son carnet d’adresses, on se présente en « visiteur du soir » et on fait jouer des connivences – avec toutes les dérives, tous les risques liés au manque de professionnalisme de l’approche.
Les risques du lobbying à la française
En France, le meilleur symbole du lobbying qui ne dit pas son nom est certainement Alain Minc. Célèbre essayiste et touche-à-tout, rares sont les grands patrons à ne pas connaître sa ligne directe. Esprit vif, culture politique et économique étendue, Alain Minc est le conseiller des décideurs. Avec lui, le lobbying est une affaire de relations. Néanmoins, son action a montré ses limites tant la réalité de l’histoire économique a souvent été à l’encontre de ses augures… Sans doute parce que l’on n’a pas bien écouté ses conseils clamera-t-il ? Reste que sur un plan professionnel, l’homme est peu entouré, une absence de structure et d’équipe révélatrice d’une conception du lobbying plus proche de l’affairisme que de l’éclairage des décideurs.
Autre incarnation du lobbying à la française : Stéphane Fouks, patron d’Havas Worldwide France. Avec M. Fouks, il n’est plus question de traiter les clients au cas par cas, et de glisser les conseils à l’oreille comme Alain Minc. Le lobbying prend ici une dimension industrielle, avec un grand nombre de consultants et des honoraires qui crèvent le plafond. Fouks est un homme de coups, prend ce qu’il y a à prendre et peu importe si on ne travaille pas dans la durée. Avec ce fonctionnement à grande échelle, le risque de conflit d’intérêts est grand. Un problème ? Pas du tout. Et Stéphane Fouks d’avancer : "Quand on a deux clients dans le même secteur, c’est un conflit d’intérêts ; quand on en a quatre, c’est une expertise." La formule est croquignolesque… L’homme est talentueux. Seule ombre au tableau : la poisse ! Après DSK, auprès duquel il se voyait déjà en haut de l’affiche, Stéphane Fouks la scoumoune a enchaîné avec une autre « catastrophe industrielle » : Jérôme Cahuzac. D’un côté comme de l’autre, deux fiascos pour le communicant. Mais peut-on vendre un mauvais produit ?
Enfin, autre option très française, le recyclage de conseiller ministériel en guise de lobbyiste maison. Mais, au-delà du risque bien connu d’alternance - et voilà le réseau de votre lobbyiste d’élite tout à coup délité - attention à ceux qui tournent casaque ! Et l’on pourra s’amuser du cas d’Yves Trévilly dont le cas a notoirement défrayé la chronique. Porte-parole flamboyant plusieurs années durant de British American Tobacco (BAT), fervent défenseur de cette industrie, il n’est plus de jour où ce dernier, aujourd’hui à la tête de sa petite entreprise, n’égratigne ses anciens employeurs, détournant à son bon compte les mêmes réseaux et outils qui lui avaient été confiés. C’est ainsi qu’Yves Trévilly se retrouve interviewé par Pauline Delpech, une habituée des loges de British American Tobacco soudain très disserte sur les méfaits du tabac en France, ou se répand sur son compte Twitter en petites phrases assassines pour l’industrie du tabac. Une attitude peu rassurante pour ses clients actuels, mais très révélatrice des faiblesses du lobbying à la française, sport de retraités de cabinets (ministériels), trop heureux d’essayer de faire prospérer leurs relations (encore) haut placées. Se retournera-t-il contre eux demain lorsqu’un autre le payera ? Peut-être faut-il prendre un abonnement à vie…
Le lobbying participe à la vie démocratique et économique de nos sociétés. La part d’ombre qui lui est attachée n’est pas infondée et elle tend même à faire oublier son professionnalisme et sa réglementation. Cela est dû à certaines pratiques qui disparaissent progressivement et à des comportements défiant la déontologie et l’éthique. L’opportunisme vénal d’un Yves Trévilly discrédite la profession en rompant la relation de confiance instaurée entre le lobbyiste et son client. De l’urgence d’un code de bonne conduite ?
3 réactions à cet article
Ajouter une réaction
Pour réagir, identifiez-vous avec votre login / mot de passe, en haut à droite de cette page
Si vous n'avez pas de login / mot de passe, vous devez vous inscrire ici.
FAIRE UN DON