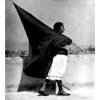Mon ignorance
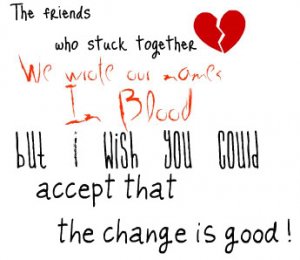
L'ignorance ne serait pas un fléau si celui qui l'abrite ne cherchait à la masquer, la déguiser en certitude. La certitude n'est pas le contraire de l'ignorance, elle en est son avatar le plus utilisé. Aucune connaissance n'est certaine ni aucun savoir pour la bonne et unique raison que tout bouge tout le temps ; l'immobilisme n'existe pas et si ce qu'on nomme ainsi peut être accepté comme tel, en politique notamment ou dans les attentes personnelles d'un choix à faire, ce n'est là que la surface des choses : en dessous tout se meut.
Rien n'est jamais acquis, rien n'est jamais sûr.
Alors, il nous faut bien naviguer à vue entre ce constat et notre besoin de sécurité.
La première chose que l'on puisse faire, c'est l'accepter ; à un temps T, qui peut durer, on appuie notre existence sur des données qui nous conviennent, et ceci, même si on vit chaque jour la douleur de leur contradiction apportée par le réel.
On pourrait presque dire que le réel, hormis quelques confirmations, souvent temporaires, n'est que contradiction.
On imagine donc bien la grande difficulté que nous donne notre manque de souplesse ; pourtant, il n'est pas question d'abandonner notre terreau pour le mélanger ou le dissoudre, au gré du temps qu'il fait, à d'autres. Seulement, savoir que cela se produira, sous peine d'un clash, nous prémunit de pas mal de souffrances.
Il est pourtant flagrant qu'un seul être ne peut, à lui seul, détenir La Vérité ; cette Vérité n'est que moments, portés par tous, depuis la nuit des temps et dans tous les continents et dans toutes les sphères de toutes les sociétés. Si cela tombe sous le sens, cela n'en reste pas moins un sens qu'on utilise peu.
Face à cette ignorance, personnelle, si effrayante, nous opposons nos certitudes, jusqu'à la mort parfois, que l'on trouve ou que l'on donne. Ceci devrait nous interpeller.
Si on schématise un ensemble, notre monde, notre univers, et si l'on s'y situe avec humilité, nous comprenons très bien que notre place est infime, vite oubliée ; mais aussi partie d'un Tout qui, sans nous, ne serait pas le même.
Personnellement, j'ai trouvé mon « home » dans une des écoles matérialistes de l'Inde antique, celle du lokâyata ; ce terme signifie « dévoué au monde terrestre », ou « se rapportant au peuple », « de la vie du peuple ». Il s'agit d'une doctrine anti-idéaliste, qui s'appela plus tard « cârvâkas » sans que cela change quoi que ce soit au fond ; on la fait correspondre aux conceptions archaïques de la population aborigène, ce qui explique le conflit qui l'opposait aux traditions brahmaniques orthodoxes. Cependant cet enseignement dénote un degré supérieur de la pensée philosophique et ses principes fondamentaux ne correspondent nullement aux croyances primitives.
La veine matérialiste des Upanishad est très proche de ses idées.
Dès l'Antiquité, en Inde, on introduisit un système de calcul employant le zéro, ce qui fut ensuite repris par les Arabes puis par d'autres peuples. On savait que la terre était ronde, qu'elle tournait sur elle-même et on connaissait, de ce fait, le principe des éclipses du soleil et de la lune. Cette connaissance antique était si contraire aux vues traditionnelles, elle était si osée dans les conditions d'une influence croissante des idées religieuses, que plusieurs siècles après, même ses disciples s'en écartèrent pour rester conformes à l'interprétation brahmanique.
C'est beaucoup plus tard, qu'en occident, nous avons jugé et condamné Galilée !!
On le voit, partout, toujours, le savoir gêne. Et, paradoxalement, l'ignorance est dépréciée ! L'obscurantisme n'est pas ignorance, il est conviction qui remplacent l'ignorance. Et cela n'a rien à voir !
La science actuelle elle-même, qui se veut performante et prouvée, n'est, par bien des côtés, et peut-être simplement parce qu'elle est appliquée par des êtres incomplets, de fait, qu'une conviction. Cette conviction, scientifique, cette conviction, religieuse, cet irrationnel ( croyance), obscurantiste, ne sont en fait que les avatars d'une même insécurité de l'homme, faible et perdu dans la nature.
On construit des châteaux de cartes, ou de sable, sur des ignorances, cela devient croyances, et comme chacun sait la croyance ne se remet pas facilement en question.
On a donc, après les croyances les plus folles, essayé de compenser par ce que l'on nomme aujourd'hui la science ; on la pose comme réelle, alors que demain elle sera démentie. Mais la science ne fait que nommer les choses, donner des noms pour qu'on se repère ( qu'on se rassure), qu'on mette en case, qu'on mette en boîte, qu'on classifie, qu'on dissèque, on nie la Vie, on tue la vie. Car la vie échappe à tout ça. La vie ne supporte pas le morcellement, elle est Tout.
Mais la vie n'est pas une sécurité, à chaque instant on peut mourir et, on finit toujours pas mourir.
Le lokâyata me convient – et sachez que je ne prononce pas ce mot tous les jours, ce n'est pas une appartenance d'école- car il donne à l'homme la place qui est la sienne ; ce qui me plaît, c'est l'absence totale de l'individualisme ; car « on » ne croit pas à la réincarnation, mais au passage naturel de certaines formes de vie à d'autres, suivant les lois de la nature. Et, comme par hasard, cette conception rationaliste et matérialiste est concomitante d'un progrès considérable des connaissances scientifiques et avant tout des mathématiques, de la physique et des sciences naturelles. On y soulignait que la recherche avait pour objet le monde tel qu'il est appréhendé par les sens et que seul un être susceptible d'être analysé peut donner lieu à des déductions philosophiques. Les phénomènes surnaturels étant niés parce que l'expérience n'en donne aucun témoignage.
Nous sommes des êtres de chair et de sang, et de sens, qui seuls peuvent nourrir véritablement notre cerveau. Tout le reste est phantasme, délire ou névrose. Toutes les connaissances développées depuis lors nous le prouvent. Mais cela nous réduit.
Les adeptes du lokâyata comprenaient la complexité du problème de l'origine de la vie, et de la pensée, mais n'essayaient pas de ramener les formes supérieures de la vie à ses formes inférieures. Ce que font toutes les religions.
L'éthique de ces matérialistes n'était pas tant d'aimer les plaisirs et les joies de la vie terrestre, ce qui pourrait faire croire à un certain amoralisme, ou à une débauche morale, non, on y prône aucune attitude égoïste envers la réalité ambiante, au contraire, une existence normale des hommes ne se concevait qu'en harmonie avec la nature. La tempérance était la vertu principale et ses normes réglaient « l'hédonisme » naturel de l'individu.
Cela nous rapproche des épicuriens, plus tard, en Grèce.
Je ne vois que la deep ecology, dans sa dimension non démentielle, qui se rapproche de ce courant.
Les matérialistes du lokâyata refusaient l'idée du salut religieux. Donc refus de tous les rites et de tous les cultes.
Une telle base de perception du monde laisse sa place à l'ignorance, ne veut pas la combler par de bien nocives convictions. Mais elle est le contraire d'une errance puisqu'elle s'appuie sur le réel et sa perception.
Malheureusement, les idées, le mental, les croyances et les certitudes furent plus fortes, et sont encore plus fortes qui organisent autour de l'ignorance de l'individu, non pas la connaissance universelle de l'Homme, qui lui est inaccessible , mais des ersatz, des schémas temporels indépassables, et que l'on fait durer autant que la mémoire subsiste. On restreint, on réduit, on sécurise, on sépare, on combat.
Pourtant c'est bien en acceptant notre ignorance qu'on peut la réduire ; c'est bien en ne cherchant pas à la nier, à l'occulter, qu'on peut la transmuter ; et, baissant le nez, sans obséquiosité ni servitude, on peut rencontrer la vérité, fulgurante, éphémère, et qui laissera ses traces de lumières dont on se nourrira. Précieux instants éblouis.
Accepter de ne pas savoir, c'est laisser vivante notre curiosité d'enfant et peut-être garder son intelligence vive.
Accepter de ne pas savoir, et quels que soient les savoirs, c'est vouloir apprendre, mais on ne peut apprendre tous azimuts car nous sommes bel et bien limités.
Accepter de ne pas savoir, c'est accepter l'autre.
Alors, il nous faudrait changer de mode, changer de modèles, changer de valeurs et plutôt qu'anticiper la dépréciation de notre ignorance, l'offrir au contraire, pour la combler. Cela est tellement plus sécurisant ! Et cela est surtout plus jouissif.
Cela nous empêche de nous en remettre à un autre, aveuglément ; cela nous construit et nous en apprend sur nous-mêmes. Ainsi, nous pourrons désobéir, nous rebiffer, créer et oser.
Alors qu'un mot peut-être dit, comme un savoir qui tranche, un acte peut être fait, comme une évidence qui blesse ; mais ce n'est qu'un mot, ce n'est qu'un acte, fatals.
Nos sens sont bien tout ce que nous avons pour nous relier au Tout, mais ce tout, ces petits bouts que nous en percevons...
Ainsi, notre ressenti est le seul moteur à nos actes, puisque nous ignorons tout de l'avenir.
Dois-je partir ? Changer de vie ?
Pour ce faire dois-je faire des comptes, des hypothèses, des scénarios ? Un calcul de probabilités qui me donnerait partir ou rester comme gagnant ?
Non, je sais que c'est le ressenti qui nous fait agir, nous battre, s'exiler ou bien se résigner ; alors, si nous nous connaissons bien, le choix ne sera jamais regretté, malgré toutes les embûches, ou les ennuis, les déceptions, ou les regrets. Les regrets sont ceux d'un rêve, et les déceptions aussi, et partout il y aura embûches ou ennui.
À la fin, on dira de son destin : je ne pouvais pas faire autrement. Parce que s'il y a doute, trop gros doute, c'est que nous ne sommes pas prêts. Que chaque chose vient à son heure et que cela ne dépend pas de nous. Je veux dire de notre volonté, de notre rationalité.
Bizarrement, être matérialiste, c'est ça, non pas un pion errant mais non plus une ligne déterminée à laquelle on s'accroche envers et contre nous. L'acceptation d'un abandon dont le sol que nos pas foulent est ferme. Un sol ferme, des racines, et nos feuilles, notre esprit dans le vent.
Nous sommes arbres – le temps, la patience d'une croissance-, nous sommes animal – l'espace que l'on couvre, où l'on court, où l'on se repose.
Nous sommes de ce monde et il nous faut l'accepter. Et cela est beaucoup plus jouissif que frustrant car la vie, toujours, est plus riche et plus belle que la plus merveilleuse production mentale.
NB : je me suis rafraîchie la mémoire en relisant des passages de l'Histoire de l'Inde de Antonova, Bongard-Lévine et Kotovski ; éditions du Progrès, Moscou, 1979.
La bande annonce de ce film m'est venue comme association d'idée et non comme illustration :
20 réactions à cet article
Ajouter une réaction
Pour réagir, identifiez-vous avec votre login / mot de passe, en haut à droite de cette page
Si vous n'avez pas de login / mot de passe, vous devez vous inscrire ici.
FAIRE UN DON