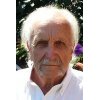Napoléon « pire » que Talamoni ?
1. Napoléon "pire" que Talamoni ?
2. Le drapeau à tête de Maure.
3 L'implantation française en Corse.
I. NAPOLEON NATIONALISTE CORSE "PIRE" QUE TALAMONI ?
A l'âge de 18 ans, au sortir de ses études à l'école militaire de Brienne, de retour en Corse et espérant y jouer un rôle déterminant, le futur empereur des Français fut un ardent patriote corse qui tenait des propos n'ayant rien à envier à ceux des nationalistes d'aujourd'hui.
En tenant compte, cela va de soi, du contexte de l'époque (guerre de Corse menée par Pascal Paoli contre la France, et ambitions locales du jeune Napoléon, le petit florilège ci-après n'est pas dépourvu d'intérêt :
a) cf. Site officiel de la ville d'Ajaccio - Histoire de Napoléon.
"Général, je naquis quand la patrie périssait. Vingt mille Français vomis sur nos côtes, noyant le trône de la liberté dans les flots de sang, tel fut le spectacle odieux qui vint le premier frapper mes regards…Vous quittâtes notre île et, avec vous, disparut l’espérance du bonheur." (Lettre de Napoléon à Pascal Paoli -1786)
b) cf. "Napoléon, une enfance corse" – Michel Vergé-Franceschi - Editions Larousse – 2014
"Les Corses ont pu, en suivant toutes les lois de la justice, secouer le joug génois et peuvent en faire autant de celui des français" (26 avril 1786)
"Quel spectacle verrais-je dans mon pays ? Mes compatriotes chargés de chaines et qui baisent en tremblant la main qui les opprime" (3 mai 1786)
"Français, non contents de nous avoir ravi tout ce que nous chérissions, vous avez encore corrompu nos mœurs" (3 mai 1786)
II. LE DRAPEAU A TETE DE MAURE.
Plutôt que les sornettes et autres légendes plus ou moins farfelues qui courent sur le drapeau à tête de Maure, il est plus prudent de se référer aux études récentes d'un historien peu contestable et peu contesté : Antoine Marie Graziani.
Cf. Histoire de la Corse – Editions Piazzola – 2013 - volume 1 - Page 310
Ouvrage collectif sous la direction d'Ange Marie Graziani.
Aux origines de la tête de Maure sur le drapeau corse, on trouve la décision du Pape Boniface VIII de donner l'investiture de la Corse et de la Sardaigne au roi d'Aragon.
En réalité, celui-ci ne s'implante au début du XIV° siècle qu'en Sardaigne, délaissant la Corse, où les Génois détiennent en réalité le pouvoir.
En 1357, les Corses, soutenus par les Génois, se révoltent contre les seigneurs qui partent se réfugier dans les territoires aragonais. Là, ils organisent leur retour avec l'appui des Aragonais et reprennent le pouvoir en instaurant un drapeau avec une tête de Maure ; Cette tête de maure […] symbole des infidèles vaincus lors de croisades et de la "reconquista" espagnole – devient la représentation de la Corse.
Sur son front trône la représentation d'un diadème, symbole de la monarchie.
Mais dès la fin du XIV° siècle […] le diadème a été remplacé par un long bandeau […]
Désormais […] dans les ouvrages où figurent les armes des différentes provinces et dans la cartographie, la Corse est représentée par cette figure héraldique, […]
Au XVIII° siècle, avec les Révolutions, apparaîtra l'histoire, belle mais fausse du bandeau sur les yeux* [….]
Pascal Paoli, dans sa quête de construction d'un État corse, fera adopter officiellement le drapeau à tête de Maure, qu'il fait déjà arborer sur ses navires corsaires, comme drapeau national.
__________________
* qui aurait par la suite été relevé sur le front en signe de liberté
III. L'IMPLANTATION FRANCAISE EN CORSE.
Il ne faut pas circonscrire le point de départ de la présence de la France en Corse à l'intervention de 1768/69 qui s'est traduite, "in fine" par la défaite des Corses et l'annexion définitive de l'île.
Cette implantation mérite une double approche :
- celle qui prend en compte les efforts déployés dès le XVI° siècle par la monarchie française pour supplanter Gênes en Corse.
- celle qui, met en exergue les "intérêts" antagonistes, au XVIII° siècle, de Gênes, puissance déclinante, de la France, et de l'Angleterre, puissances impérialistes désireuses de s'emparer du "bastion" stratégique" que constituait la Corse en Méditerranée.
Dans ce contexte historique "élargi", et non réduit à celui de l'annexion définitive de l'île par la France, il paraît donc opportun de noter que dès 1529, l'alliance de la monarchie française (contre Charles Quint) avec les Turcs, a permis à ces derniers de naviguer librement à partir d'une logistique portuaire française (Marseille et Toulon) et au roi de France d'envisager (déjà) une conquête de la Corse.
Cela s'est réalisé en partie entre 1553 et 1559. Henri II a tenté de s'implanter en Corse avec l'aide de Sampiero Corso, condottiere local, ….. et de la flotte Turque. La paix de Cateau Cambresis a mis un terme à cette aventure.
En 1768, après une série de révoltes corses qui ont culminé avec l'insurrection de 1730, la proclamation de l'indépendance en 1735, et son avènement effectif avec Pascal Paoli (1755) Gênes, a été contrainte de faire appel à la France pour venir à bout de ce que l'on peut considérer comme une guerre de libération ou d'indépendance.
La monarchie française, qui n'avait jamais abandonné son désir de supplanter Gênes, a répondu favorablement, cela va de soi, aux appels au secours de cette dernière.
En 1768, Gênes, ne pouvant rembourser les sommes engagées par la France lors de ses interventions successives, a abandonné la Corse “en gage” (Traité de Versailles, signé le 15 mai 1768).
La France a alors entrepris de s’établir définitivement dans l’île.
Après avoir défait les troupes françaises à BORGO en 1768, Pascal PAOLI a été écrasé à Ponte Novo le 8 Mai 1769.
Après la défaite de Pascal PAOLI, les ralliements à la France se sont multipliés, dont celui du père du futur empereur Napoléon, Charles Bonaparte, récompensé par des gratifications diverses et par la "prise en charge" des études du petit Nabulione à l'école militaire de Brienne.
Il faut savoir en outre que, de 1794 à 1796, la Corse est devenue un "Royaume anglo-corse" avec l'assentiment de Paoli. Mais la nomination d'un Vice-roi de nationalité anglaise (Sir Gilbert Elliot) a vite fait de rompre l'allégeance de Pascal Paoli et surtout celle du peuple corse. Le retour des français en 1796 a sonné l'exil définitif de Paoli en Angleterre, où il mourra en 1807.
Les dernières tentatives des Corses pour rétablir leur indépendance sont caractérisées par des révoltes suivies d’impitoyables répressions (1774 dans le Niolo, 1809 et 1815/16 dans le Fiumorbu) avant une pacification et une assimilation qui feront désormais se confondre l'histoire de la France et celle de la Corse… jusqu’au réveil du nationalisme actuel.
9 réactions à cet article
Ajouter une réaction
Pour réagir, identifiez-vous avec votre login / mot de passe, en haut à droite de cette page
Si vous n'avez pas de login / mot de passe, vous devez vous inscrire ici.
FAIRE UN DON