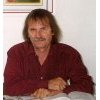Ouvrez-moi le marché du médicament, ou je fais un malheur !
La recherche, c’est bien beau… Mais encore faudrait-il que ça paie, et dès que possible !... Si, au surplus, ça pouvait payer dans des cas de découvertes même un peu douteuses, ce serait déjà un bon début !... Voilà qui répondrait positivement à une interrogation qui n’est peut-être pas aussi choquante qu’il y paraît : en matière de médicament, la Sécurité sociale et les Assurances complémentaires n’ont-elles pas, désormais, pour première tâche de sécuriser les profits des firmes pharmaceutiques ?

Pour l’efficacité et la sécurité des patients, vous repasserez une autre fois…
Une chose est très certaine : les charlatans sont de retour, si jamais il leur est arrivé de ne plus être parmi nous. Pour le vérifier, il suffit que nous nous tournions une nouvelle fois vers Jean-François Bergmann, de qui il faut redire qu’il est vice-président de la Commission d’AMM (Autorisation de mise sur le marché), et donc un témoin de la toute première ligne :
« Quand un nouvel industriel développe un nouveau médicament dans une classe où il y en a déjà, et que nous, on se désole en disant : "encore un bêta-bloquant, encore un truc qu’on a déjà vu", à chaque fois il espère, peut-être avec crédulité, que son nouveau à lui sera meilleur que les autres. Souvent, on est déçu. Donc, qu’est-ce qu’il peut faire ? Il peut faire une étude versus un comparateur qui, au mieux, est un essai qu’on appelle un essai de non-infériorité pour montrer que le nouveau n’est pas moins bien que ce qui existe déjà – ce qui est la moindre des choses –, mais ne montre pas pour autant qu’il est mieux.
Ces essais de non-infériorité, pour les raisons méthodologiques, sont extrêmement faciles à biaiser. C’est des essais fragiles en termes de méthodologie. Donc, on leur demande des essais de non-infériorité qu’ils font par déception, mais qui ne sont pas forcément la garantie de l’absolue non-infériorité. On peut, dans un essai, avoir l’air d’être non inférieur sans pour ça être absolument convaincu que ce nouveau médicament ne sera pas, peut-être, un petit peu moins bien.
Et puis, derrière votre question il y a : est-ce qu’on aurait besoin d’élargir notre arsenal avec des trucs qui n’apportent rien de plus, puisqu’ils sont au mieux non inférieurs. Là, la réponse, c’est que, d’une part, l’industriel, au départ, espérait être mieux, et d’autre part, on est dans une économie libérale, où on a le droit de développer un vingt-quatrième bêta-bloquant s’il y en a déjà vingt-trois sur le marché. »
Histoire un peu longue, mais manifestement, très bonne !
En voici une autre ; elle n’est pas mal non plus. Elle nous vient du président du Collège de la médecine générale, le professeur Pierre-Louis Druais, qui s’inquiète de ce qu’il appelle "l’oubli catastrophique de la médecine générale" :
« Le traitement médicamenteux de la maladie d’Alzheimer est un exemple caricatural de cette dérive. Dans les faits, les médecins généralistes sont mis devant le fait accompli de la prescription des anti-Alzheimer, les anticholinestérases, qu’ils n’ont pas le droit de prescrire en première intention, mais sont supposés entériner, en tant que médecins traitants, la prescription hospitalière spécialisée, devenue systématique, de ces produits coûteux.
Ils ont constaté que l’augmentation considérable du nombre de patients, la pression industrielle pour fournir une thérapeutique dans un marché en expansion massive, la pression sociétale illustrée par un plan ministériel devenaient des justifications pour utiliser massivement des traitements inefficaces et dont le rapport bénéfice-risque est par définition défavorable.
Ces traitements ont eu une AMM puis une évaluation de la transparence surréalistes, avec un avis qui conditionne leur utilisation abusive d’où est absente toute pertinence clinique. Le terme même de médecin traitant traduit ce malaise. Le médecin généraliste n’est plus décideur dans le soin. Il est traitant, c’est-à-dire qu’il est contraint d’appliquer des directives venues d’ailleurs, protocoles, recommandations, décisions hospitalières ou spécialisées, sous peine de déconsidération, voire d’attaques.
Dans la réalité, nous sommes quasi quotidiennement confrontés au dilemme de poursuivre des traitements inutiles, coûteux et iatrogènes, ou de les arrêter avec les difficultés que l’on connaît, soit dans les relations avec les confrères prescripteurs, bien évidemment avec les patients, et encore plus avec les familles pour cette maladie. »
(Extrait de Michel J. Cuny, Une santé aux mains du grand capital ? ‒ L’alerte du Médiator, Éditions Paroles Vives 2011, pages 221‒222)
37 réactions à cet article
Ajouter une réaction
Pour réagir, identifiez-vous avec votre login / mot de passe, en haut à droite de cette page
Si vous n'avez pas de login / mot de passe, vous devez vous inscrire ici.
FAIRE UN DON