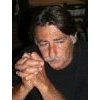Le
très libéral Economist fait sa « une » avec un Nicolas Sarkosy
triomphant et souligne : « Jean-Baptiste
Colbert once again reigns in Paris ». Il explique que le pourfendeur,
pendant la campagne électorale, du « système français » est celui qui
le défend aujourd’hui, souligne ses avantages et en profite, pour mieux s’en
sortir que les anglo-saxons face à la crise financière.
Il faut rendre à César ce qui est à César. Le président français est un opportuniste et aujourd’hui c’est sans doute l’attitude la plus payante. Or, les défenseurs traditionnels du système français, ne le sont pas. Et ils soulignent que le prépondérance de l’Etat est un leurre, que le gouvernement persiste dans sa vision néolibérale, que les voisins s’en sortent mieux qu’ici. Ils demandent plus, c’est normal, mais contestent ce qui est accompli et surtout ce qui est structurellement protégé, ce qui l’est moins.
Mais l’essentiel est ailleurs.
Le Economist conclut (et pourrait-il en être autrement ?), que ce qui semble bien marcher aujourd’hui, ne marchera plus une fois la reprise en vue. Alors, les anglo-saxons auront de nouveau un meilleur système : « Those generous welfare states that preserve people’s incomes tend to blunt incentives to take new work. That large state, which helps to sustain demand in hard times, becomes a drag on dynamic new firms when growth resumes. The latest forecasts are that the United States and Britain could rebound from recession faster than most of continental Europe ». Ceci est un tour de passe-passe irrecevable : Il sous tend la logique que lorsque ça va mal c’est à l’Etat et aux contribuables de payer la casse et quand ça va bien c’est aux entrepreneurs et autres banquiers de faire des bénéfices. Or ce qui s’est passé, c’est qu’au moment ou les liquidités étaient abondantes, il n’y avait chez les entrepreneurs ni goût du risque, ni politique d’investissements productifs. Il n’y avait qu’une malice et une volonté d’inventer les moyens financiers et juridiques adéquats pour concentrer le capital à l’infini le plus rapidement possible, quitte à faire des « investissements hasardeux » et suicidaires. En conséquence, le flux de liquidités n’a pas permis une envolée de la croissance (excepté financière et donc globalement inutile), et celle-ci est restée molle, ne permettant pas une redistribution conséquente. Ainsi, à trop vouloir garder l’argent pour soi, on a fini par le perdre. Le court-termisme c’est à dire le suicide de l’anticipation, l’enterrement du long terme, l’obligation de résultats immédiats, ont tué la croissance qui est pourtant le crescendo officiel de l’économie du marché. L’Etat providence n’y est pour rien, sauf de ne pas avoir réagi plus tôt, de s’être accommodé de la dérive financière et d’une croissance molle en remplaçant les augmentations nécessaires par la politique du crédit. Bref, en ayant capitulé de ses obligations et prérogatives en se lavant les mains. Lors de la reprise, quand elle reviendra (et ce n’est pas demain la veille, quoi qu’on dise), les outils qui empêcheront les dérives suicidaires de l’économie de marché devront être bien en place : désormais il n’y aura pas de croissance sans intervention de l’Etat. C’est peut-être là la leçon principale de cette crise. L’économie est une chose trop sérieuse pour l’abandonner aux banquiers. Contrairement au président français, ils restent les derniers idéologues et les pires anticipateurs.