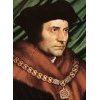Petite introduction à la destination universelle des biens
On constate de nos jours dans de nombreux commentaires un ressentiment agressif envers le catholicisme. Si cette aversion peut être légitimée de la part de certaines générations suite au contact direct avec des structures animées par des personnes qui n’avaient, peut-être, de catholiques que le nom, elle se comprend moins chez ceux qui ne connaissent ce catholicisme que par l’intermédiaire des médias dominants ou de scénarios hollywoodiens. Je voudrais ici contenir quelque peu cette incitation à la haine en rappelant quelques vérités historiques.
S’il est vrai que des structures ecclésiales ont pu ou peuvent encore manifester des copinages mondains avec les puissants établis, trahissant en cela le message dont elles sont par statut porteuses, l’enseignement constant de l’Eglise catholique rappelle un principe fondamental du bien commun authentique, à savoir la destination universelle des biens. Au-delà de l’imagerie pieuse, qui date tout de même du XIXème siècle, il existe un ensemble de réflexion issu de l’expérience humaine et toujours d’actualité. Car il faut savoir distinguer le Vatican, institution humaine, lieu géographique et historique, de l’Eglise bâtie par le Christ et dont l’enseignement fondamental reste fidèle à son Instituteur. De même, si je peux me permettre cette analogie lointaine, qu’on ne peut réduire l’idéal républicain aux décideurs qui ont occupé ou qui occupent les postes étatiques. Ici, nous parlerons des biens en général, sachant qu’il faudrait encore préciser.

Une intention à sauvegarder
Selon la doctrine sociale de l’Eglise catholique, le bien commun bien compris implique la destination universelle des biens. Selon la Genèse, Dieu a donné la terre aux premiers hommes pour qu’ils la maîtrisent par leur travail et jouissent de ses fruits (Gen I, 28-29). Dieu n’a pas donné la planète Terre à une communauté au détriment des autres : le genre humain dans son ensemble est récipiendaire de cette donation divine « sans exclure ni privilégier personne » (Compendium de la Doctrine Sociale de l’Eglise, 2005, p. 96).
Comme l’être humain ne peut se passer des biens matériels pour satisfaire ses besoins vitaux, cette destination universelle des biens est un impératif humaniste. En effet, ces biens sont nécessaires pour se nourrir, croître, fonder une famille, communiquer et s’engager dans la vie sociale. Ce qui est implicite ici, c’est la hiérarchie des biens humains (biens de l’âme, du corps, extérieurs) : ces trois strates indiquent des valeurs objectives mais toutes ne se valent pas.
Ce principe de la destination universelle des biens fonde le droit naturel de toute personne à l’usage des biens humains. Ce principe ne découle pas du droit positif engendré par les circonstances historiques et géographiques mais répond à des invariants anthropologiques que la révélation divine valide. C’est donc un droit antérieur à toute décision humaine, et donc de toute organisation politique, juridique, économique. C’est là un droit primordial en ce sens qu’il est supérieur au droit de propriété et de libre marché.
Mais nous ne vivons pas dans ces droits abstraits et des réglementations juridiques concrètes doivent rendre effectifs cette destination et cet usage universel. Ainsi ce principe ne signifie pas que « tout soit à la disposition de chacun ou de tous » (idem, p. 97) mais ce principe doit animer les échanges humains de telle sorte que les inégalités de richesses inévitables ne servent pas à exploiter certains groupes ou en exclure d’autres de la vie commune. Le but est le partage équitable. Les inégalités constatées dans le domaine du « développement[1] » ne doivent pas profiter à ceux dont certains progrès facilitent des suprématies qui peuvent provoquer l’asservissement de certaines communautés par d’autres.
Et la propriété privée ?
L’origine de la propriété privée est située dans le travail de l’homme qui parvient à dominer la terre. Chacun peut en droit s’approprier une partie de la terre dans la mesure où cette acquisition est le fruit d’un travail effectif et aussi, sans doute, dans la mesure où cette terre n’est pas déjà habitée. Cette propriété privée permet quoi ? D’assurer une zone nécessaire pour l’autonomie personnelle et familiale. La doctrine sociale de l’Eglise catholique légitime l’accession à la propriété privée, considérée comme un droit naturel[2].
Mais la tradition chrétienne ne fait pas de ce droit un absolu puisqu’il est subordonné à l’usage commun des biens qui est un droit supérieur. Ce droit antérieur n’annule pas le droit de propriété mais rend nécessaire une réglementation pour l’équité. Autrement dit le droit de propriété est un moyen pour assurer la destination universelle des biens. Selon l’enseignement social de l’Eglise, il ne s’agit pas de poursuivre son unique avantage personnel ou familial mais le bien commun. C’est ce bien commun qui mesure le droit de propriété : cette propriété a donc un aspect social puisqu’il est recommandé de redistribuer au moins son surplus afin que les biens de ce monde soient partagés équitablement.
Autrement dit, les monopoles issus des circonstances géographiques et historiques ne doivent pas être recherchés ou entretenus car « Ils maintiennent de nombreux peuples en marge du développement » (idem, p. 99).
Comme ce principe de la destination universelle des biens est fondé sur l’autorité de l’Ecriture inspirée, la non-reconnaissance de cet enseignement a tendance à annuler ce principe et à ouvrir la voie à l’accaparement des biens et l’exploitation des individus ou des groupes humains. L’Eglise reconnaît ici que ce caractère instrumental des biens matériels est jugée inévitablement fragile sans la foi et est amené à s’altérer progressivement au profit d’une recherche absolue et exclusive.
L’Eglise catholique s’adresse donc à la liberté et à la responsabilité des gens : elle ne propose pas la redistribution contraignante des biens par des structures étatiques. C’est l’option marxiste[3] qui n’est pas si éloignée que ça de l’enseignement de l’Eglise comme on sait : ce marxisme pouvant être présenté, sous certains de ses aspects, comme un évangile laïcisé[4].
La redistribution des biens vitaux est déclarée humaine et conforme à la révélation divine. « Quand nous donnons aux pauvres les choses indispensables, nous ne faisons pas pour eux des dons personnels, mais nous leur rendons ce qui est à eux. Plus qu’accomplir un acte de charité, nous accomplissons un devoir de justice » Saint Grégoire Le Grand (Regula Pastoris, 3, 21, cité dans le Compendium, p. 102).
Autre citation rapportée par Akplogan : « Le riche n'est qu'un administrateur de ce qu'il possède ; donner le nécessaire à celui qui en a besoin est une œuvre à accomplir avec humilité, car les biens n'appartiennent pas à celui qui les distribue. Celui qui garde les richesses pour lui n'est pas innocent ; les donner à ceux qui en ont besoin signifie payer une dette ».
On voit donc que le principe de la destination universelle des biens inverse la logique du prêt ! Non seulement il y a une obligation morale de remise des dettes, mais une obligation de prêt sans intérêt, et même plus : de don gratuit, qui est qualifié par la doctrine sociale de l’Eglise de droit du pauvre.
Une étude récente
Dans sa thèse passée en 2014 au Canada « L’approche de la doctrine sociale de l’Eglise catholique sur l’effacement de la dette des pays africains[5] », le béninois Pamphile Akplogan, auteur d’un précédent livre en 2010 intitulé « L’enseignement de l’église catholique sur l’usure et le prêt à intérêt[6] » (L’Harmattan), récapitule ce principe général et l’applique au problème de la dette des pays africains. Il faut rappeler ici que cette thèse cite Jean Ziegler comme une de ses sources et autorité en la matière.
Selon l’enseignement constant de l’Eglise, suite aux écritures reconnues comme révélées, nous ne sommes pas propriétaires de la Nature mais gestionnaires ponctuels. Akplogan précise que cette destination universelle des biens était déjà présente dans des écrits vétéro-testamentaires (Ancien Testament) qui dénoncent l’accaparement des biens par des groupes. Le passage cité (Deutéronome 15, 1) mérite d’être retranscrit dans son intégralité : « Au bout de sept ans tu feras remise. Voici en quoi consiste la remise. Tout détenteur d'un gage personnel qu'il aura obtenu de son prochain, lui en fera remise ; il n'exploitera pas son prochain ni son frère, quand celui-ci en aura appelé à Yahvé pour remise. Tu pourras exploiter l'étranger, mais tu libéreras ton frère de ton droit sur lui ». On voit que la remise de la dette concerne exclusivement le frère juif et non l’étranger mais l’exploitation des pauvres par les riches est déjà dénoncée ici.
Dans le Nouveau Testament, en racontant l’histoire de Lazare et du mauvais riche (Luc 16, 19) Jésus de Nazareth affirme que ceux qui possèdent, du fait des circonstances de leur vie, des biens en abondance, doivent en faire bénéficier les plus pauvres. Il faudrait lire aussi la Première Epître de saint Jean (3, 17). C’était d’ailleurs ce qu’avaient compris les premiers chrétiens qui « mettaient tout en commun » (Actes 2, 44-45).
On voit au passage que Jésus brise les barrières du tribalisme pour proposer l’extension vers l’universalité (que l’on relise la parabole du Bon Samaritain dans Luc 10, 25 : c’est l’étranger qui se montre le plus humain selon Jésus). Personne ne peut nier que le Christ ait manifesté dans sa vie une option préférentielle pour les pauvres. Un de ses disciples va vivre cette orientation de façon intégrale : François d’Assise. Malgré des épisodes attristants, on ne peut nier non plus que l’Eglise n’ait continué dans cette voie : il faudrait faire ici l’historique de toutes les congrégations qui se sont créées afin de venir en aide aux malheureux par la création d’hospices, d’hôpitaux, d’écoles gratuites, de banques. L’histoire du Mont-de-Piété est à ce sujet intéressante. L’'idée est née en 1462, quand un moine, Michele Carcano de Milan, cherche un moyen de combattre l’usure et les taux d'intérêt abusifs pratiqués à l'époque. Il est alors à l'origine de la création du Monte di Pietà, à Pérouse en Italie. Dix ans plus tard, le Monte dei Paschi di Siena est établi à Sienne avec le même objectif. On notera aussi, malheureusement, des compromissions inacceptables qui défigurent le message du Christ de la part de certains hommes d’Eglise au cours de l’Histoire.
On voit donc ici que ce principe de la destination universelle des biens a un fondement « religieux », théologique[7], puisqu’il s’appuie sur la foi en un Dieu qui créée le monde. Ce qui ne veut pas dire qu’une réflexion philosophique, qui s’appuie sur la raison par ses seules forces, ne puisse pas parvenir à le poser.
Quand le pape François est invité à faire un discours au parlement européen (25 novembre 2014), c’est cet enseignement qu’il a à l’esprit. La courtoisie élémentaire et la prudence diplomatique n’annulent pas les définitions fondamentales dont il est le serviteur.
Quand il déclare que « la promotion des droits humains joue un rôle central dans l’engagement de l’Union Européenne, en vue de favoriser la dignité de la personne, en son sein comme dans ses rapports avec les autres pays », il n’ignore pas que sa définition de ces droits humains, qui s’appuie sur un droit naturel indépendant d’une révélation qui relève de la foi (confiance), n’est pas forcément la même que celle les fonctionnaire européens[8]. Il précise toute de suite après : « Promouvoir la dignité de la personne signifie reconnaître qu’elle possède des droits inaliénables dont elle ne peut être privée au gré de certains, et encore moins au bénéfice d’intérêts économiques ».
La mise en esclavage de certains peuples, et spécialement des peuples africains, dont certains prêts, précise Alplogan, avoisinent les 20 % d’intérêt (le capital double donc en 5 ans), va bien au-delà de la mise à l’écart du « développement » et se fiche de « la dignité de la personne humaine ». Loin des images pieuses, Jean-Paul II avait dénoncé les « structures de péché » qui maintiennent les peuples dans des situations inhumaines. Il ne faut pas s’attendre à avoir ces informations en écoutant Canal + et autre BFMtv.
[1] Expression ambiguë : à bien des égards, les pays dits "sous-développés" sont largement plus humains que les pays dits « civilisés » à l’occidental.
[2] Léon XIII : encyclique Rerum Novarum, n° 5
[3] K. Marx (1818-1883) a aussi étudié le taux d’intérêt (Capital, III). L’analyse économique marxiste observe que le système de crédit permet à des groupes privés de s’enrichir sans travailler à la sueur de leur front et même sans participer aux échanges économiques légitimes. On voit ainsi des plus-values s’accumuler sur des individus qui se contentent de jeux d’écritures. Boukharine (1888-1938) les nommera les parasites.
[4] Mais Marx est matérialiste, comme Adam Smith : leur politique est une gestion des choses, selon des voies différentes.
[5] Disponible en pdf ici : http://www.collectionscanada.gc.ca/...
[6] Ce livre synthétise tous les textes sur le sujet : Ancien et Nouveau Testament, Pères de l’Eglise, Docteurs, Conciles, Papes, etc.
[7] Rappelé par exemple dans l’encyclique sociale de Benoît XVI Caritas in Veritate, n° 6.
[8] Formés à l’occamisme.
13 réactions à cet article
Ajouter une réaction
Pour réagir, identifiez-vous avec votre login / mot de passe, en haut à droite de cette page
Si vous n'avez pas de login / mot de passe, vous devez vous inscrire ici.
FAIRE UN DON