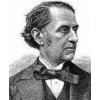Printemps français et prières de rue
Il sera intéressant, dans quelques années, de voir comment les historiens rendront compte des événements de l’hiver et du printemps autour de la question du « mariage pour tous » ; comment les anthropologues décriront les comportements curieux de la « droite, décomplexée » par l’arrivée aux affaires d’un « petit gros usurpateur ».
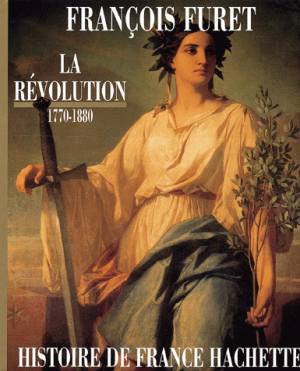
En effet, dans un premier temps, cette droite s’est trouvée une égérie en la personne de Madame Virginie Tellenne, qui avait tenu à garder son nom de scène parisienne : Frigide Barjot. Membre du Groupe Jalons avec son mari et son beau frère, elle avait été initiée à la pratique du détournement et a donc donné à son mouvement ce nom évocateur : « la manif pour tous » . Puis elle a été débordée sur sa droite par une Béatrice au nom prédestiné (Bourges) qui a lancé une campagne qu’on a pu qualifier de plus radicale : « le printemps français ».
Certes, Madame Tellenne, après une vie un peu olé olé, avait fait son retour dans la religion où elle était née, mais le nom qu’elle avait choisi avait un côté soixante-huitard : « la manif pour tous » . En revanche, ce n’était pas à « l’esprit de soixante-huit » que se référait Madame Bourges en lançant son « printemps français ». Elle qui défend un traditionnalisme catholique se référait plutôt aux « printemps arabes » qui avaient émaillé l’année 2011.
On peut être surpris de cette référence qui passerait presque pour une révérence. Mais de la part d’une catholique traditionnaliste, on peut se demander si ses faveurs vont « aux laïcs et aux modernistes » qui ont chassé les rois d’Egypte et de Tunisie (ils risquent de proposer un jour le « mariage pour tous ») ou aux religieux qui ont (provisoirement, peut-être) récupéré ces « révolutions ». Et on peut sourire de voir ce « printemps français » se terminer dans des prières de rue.
Quand j’étais jeune et que je suivais l’enseignement des Révérends Pères, la mode était à l’œcuménisme. Certes ce mouvement se limitait aux chrétientés de diverses obédiences, mais, face à une modernité troublante, ce qui réunit les croyants, chrétiens et musulmans, est plus fort que ce qui les sépare et les oppose (dogmes, rituels, susceptibilités, préséances, etc…). Et quand je vois à la télévision le théologien Tarik Ramadan, je me dis que l’enseignement des Frères Musulmans n’a rien à envier à celui des Pères Jésuites.
Ces considérations ont un regain d’actualité aujourd’hui en raison de deux événements. Le premier, c’est le retour en Egypte du printemps ou du bâton, selon le point de vue où l’on se place. Le président Morsi, le premier président élu démocratiquement en Egypte, a été écarté de pouvoir par le général Abdel Fattah al-Sissi. Certes, cet officieux est connu pour sa piété, mais il a promis des élections libres. Il n’est pas certain que les laïcs triomphent, mais on ne sait jamais. Au train où vont les choses, ce n’est pas demain qu’un pouvoir issu des urnes en Egypte envisagera le « mariage pour tous ». Mais si une telle chose devait advenir, on ne sait pas ce que diraient Mesdames Tellenne et Bourges.
Depuis quelques jours, je lis le quatrième volume de l’Histoire de France publié par François Furet en 1988. Il raconte comment le « printemps français de 1789 » fut plombé par la question religieuse quand l’Assemblée Constituante voulut étendre sa compétence à la Constitution Civile du clergé[1]. Cette posture réfractaire est depuis constitutive de la droite française. Mais au printemps 2013, une partie de cette droite est allée jusqu’à prétendre imposer à l’Etat laïc ses convictions religieuses.
L’autre événement qui a fait l’actualité est en réalité un pseudo-événement : c’est la levée de l’immunité parlementaire de Madame Le Pen, qui ne s’était pas beaucoup engagée sur le « mariage pour tous », mais qui avait comparé précédemment les prières de rue (musulmanes, s’entend) à une « nouvelle occupation ».
Elle pourra dire au tribunal, avec l’humour qu’on lui connaît, qu’elle a une grande admiration pour l’auteur de Triporteur.
A la question « Quelle est votre occupation préféré, René Fallet répondait généralement : « l'occupation allemande. »
[1] 12 juillet 1790 : vote de la Constitution Civile du clergé ; 10 mars et 13 avril 1791 : brefs pontificaux la condamnant.
8 réactions à cet article
Ajouter une réaction
Pour réagir, identifiez-vous avec votre login / mot de passe, en haut à droite de cette page
Si vous n'avez pas de login / mot de passe, vous devez vous inscrire ici.
FAIRE UN DON