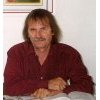Quand De Gaulle organisait le pourrissement du franc pour sauver les prévaricateurs
Reprenons la situation de la France à la veille de la démission de Charles de Gaulle, le 20 janvier 1946, de la présidence du Gouvernement provisoire.

Il prend connaissance de la note que Michel Debré a rédigée pour lui :
« Dans le courant de l’année 1946, et sans doute dès les premiers mois, nous subirons, non pas une crise, mais plusieurs crises. » (Jean-Louis Debré, page 408)
De fait, le conseiller en indique cinq : une crise de ravitaillement, une crise financière, une crise administrative, une crise économique, une crise sociale.
Voici ce qu’il écrit à propos de la crise financière :
« Le processus de l’inflation paraît largement commencé. Le Trésor a et aura des difficultés à trouver des souscripteurs et l’État connaîtra une situation difficile pour ne pas dire plus. » (page 408)
Cette inflation ferait partie de l’héritage reçu par la Quatrième République : celle-ci ne s’en remettrait jamais. En ce domaine ‒ comme dans le cas du déclenchement de la guerre d’Indochine ‒, la responsabilité de Charles de Gaulle est entièrement engagée. Il apparaît aussitôt qu’il savait très bien ce qu’il faisait.
Comme il devait le rappeler à Yvonne de Gaulle, le 24 novembre 1946, en présence de son officier d’ordonnance, Claude Guy :
« J’ai vu l’inflation en Pologne : c’était horrible. Chaque visage était hanté. Levées à quatre heures du matin, les ménagères faisaient la queue pour le pain, espérant acheter avant la hausse, car le prix du pain, vers la fin, changeait trois fois par jour. Le désespoir était présent. On ne pensait plus qu’à cela. » (Claude Guy, page 161)
Rappelons ce que Georgette Elgey nous a dit de la situation française des lendemains de la Libération, un mois avant la démission de De Gaulle :
« Le 28 décembre 1945, la carte de pain, qui avait été supprimée le 1er novembre, est rétablie : les adultes ont droit chaque jour à 300 grammes, ce qui est inférieur à la ration en vigueur avant la suppression des tickets. » (La République des Illusions, page 30)
Mais De Gaulle en sait encore un tout petit plus sur les effets ravageurs de l’inflation dans le domaine tout particulier des rapports de classe. Écoutons-le attentivement, comme a dû le faire son épouse découvrant le drame de l’inflation en Pologne vers 1920 :
« Au début, la production se poursuivit, puis les agriculteurs et les industriels, lassés de ne plus trouver, en échange de leurs produits, que du papier ou de mauvais godillots, renoncèrent à produire. "À quoi bon ?" pensaient-ils… Nous en arriverons bientôt là. Vous savez que notre cheptel, au lendemain de la Libération, se trouvait réduit à fort peu de chose. Oh ! certes, les réquisitions, les bombes, etc., y étaient pour une bonne part. Mais il y avait aussi, j’en suis sûr, beaucoup de calculs de la part des éleveurs. Que les producteurs réduisent leur production, ce n’est pas là ce qui est tragique : s’ils la réduisent, c’est qu’ils le veulent bien ! Non, la tragédie d’une inflation est pour ceux qui ne peuvent rien offrir d’autre que la prestation de leurs services. En Pologne, c’était, parmi ceux-ci, la misère noire. "Nous en serons bientôt là", affirme-t-il sans émotion apparente. » (Claude Guy, pages 161-162)
Autrement dit : les ouvriers et les employés en seront bientôt là… Quant au commentaire, il est de Claude Guy.
Et c’est dans ce contexte, on ne peut plus politisé, qu’une vingtaine de jours plus tard, madame de Gaulle devait rappeler, à son époux, sa très significative formule londonienne :
« En rentrant en France, je les mettrai tous à la gamelle ! » (page 173)
Tous ? Le mot est un peu exagéré… Tous, sauf quelques-uns, serait mieux dire.
En effet, pour le bon peuple, voilà ce que cela pouvait donner, selon Georgette Elgey :
« Jamais, même sous l’Occupation, la mortalité infantile n’a été aussi élevée. En 1943, son taux était de 66 p. 1000, soit soixante-dix décès d’enfants de moins d’un an pour mille naissances. En 1945, il atteint le chiffre catastrophique de 100,5 p. 1000. » (page 30)
Mais Vichy avait également eu du bon…, de l’excellent, même. Il suffit, pour s’en faire une petite idée, de lire la lettre adressée par Claude Bouchinet-Serreulles ‒ l’homme devenu l’adjoint de Jean Moulin tout juste au moment où celui-ci allait tomber dans les griffes de Klaus Barbie ‒ à Geoffroy Chodron de Courcel, le cousin de la future Bernadette Chirac (née Chodron de Courcel) : il avait été le premier officier d’ordonnance de De Gaulle à Londres en juin 1940…
Notons tout de suite que cette lettre, datée du 8 novembre 1943, est contemporaine de la prise de fonction de Pierre Mendès France auprès du général de Gaulle dans un domaine qui ‒ comme nous le verrons ‒ concernait directement les questions… d’inflation.
Pour l’instant, nous découvrons un Claude Bouchinet-Serreulles complètement traumatisé par la situation qu’il découvre à Paris :
« L’idée que de loin l’on se fait des choses est artificielle et sommaire, naturellement, en dépit des récits les plus imagés. Je m’attendais, entre autres, à trouver quatre-vingt-quinze pour cent de Français hâves et misérables. Il n’en est rien. Les malheurs qui frappent l’immense majorité de la population des villes n’atteignent en rien les gens riches ni les gens des campagnes. Jamais l’injustice ni l’inégalité sociale n’ont atteint un tel paroxysme. Jamais l’argent n’a été gagné plus vite ni de façon plus immorale. Il n’en est pas nécessaire pour cela de s’aboucher directement avec les Allemands, il suffit de s’improviser intermédiaire dans la vente de n’importe quel produit rationné. C’est immédiatement la course aux millions. On cite des négociants en laine, en cuir, en volailles ou en peaux de lapin qui ont atteint le milliard. Aussi le luxe le plus éhonté et le plus voyant voisine-t-il partout avec la misère. Les masses ouvrières, les employés, tous les gens à salaire ou à revenu fixes meurent de faim. » (Claude Bouchinet-Serreulles, page 395)
Tiens, comme en Pologne vers 1920… Et puis, en face :
« Les paysans, les industriels, les commerçants (alimentation, vêtements, etc.), les débrouillards de tout poil regorgent d’argent. À ceux-là rien ne manque : on trouve tout comme avant-guerre. Les paysans, à vendre aux innombrables démarcheurs du marché noir qui se battent à qui achètera le plus cher, ne savent plus où mettre leur argent : ils l’empilent dans leurs lessiveuses. » (page 365)
Voilà ce que pouvait savoir l’entourage rapproché du Général depuis la fin de 1943 au plus tard.
Alors, pour qui, la gamelle ?... Charles a répondu par des mesures parfaitement ciblées que nous reprendrons dans le détail...
Quel grand homme !
28 réactions à cet article
Ajouter une réaction
Pour réagir, identifiez-vous avec votre login / mot de passe, en haut à droite de cette page
Si vous n'avez pas de login / mot de passe, vous devez vous inscrire ici.
FAIRE UN DON