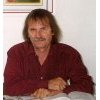Quand la bourgeoisie biaise elle-même avec les institutions qui ne la protègent pas du suffrage universel
Dans le Rapport fait au nom de la Commission du travail de la Chambre des députés et présenté par Charles Benoist le 22 février 1905, il est donc question d’établir un code du travail entièrement indépendant du Code civil (1804) ; la propriété doit être protégée des agissements du travail, nous a-t-il expliqué.
Selon lui, cela rejoint un principe général que son Rapport énonce ainsi :
« Dans toute législation, en tout temps et en tout pays, il y a deux parties distinctes, mais qui tendent à se rejoindre et à s’unir : une partie fixe et une partie mouvante ; une partie solide et une partie en quelque sorte liquide encore ; un noyau et une nébuleuse. » (Plon-Nourrit 1911, page 170)
Le noyau, c’est le droit de la propriété ; la nébuleuse, c’est le droit du travail.
Pour appliquer ce schéma de base, est-il pensable de s’en remettre à ce suffrage universel qui engendre la Chambre des députés en ce temps de Troisième République ? Ce serait laisser la part belle à ce que Charles Benoist déteste par-dessus tout : la loi du Nombre… Nombre dont il imagine, par ailleurs, qu’il serait beaucoup trop favorable… au travail.
Deux ans plus tôt, Charles Benoist et ses amis s’étaient déjà engagés sur une piste prometteuse définie dans un document "tendant à inviter le gouvernement à soumettre à la Chambre un projet de Code du travail". Voici ce qu’il en dit lui-même :
« Une telle œuvre, faisions-nous observer dans l’exposé des motifs de notre proposition de résolution du 15 janvier 1903 - œuvre de confrontation, de coordination, de classification, de codification - n’est guère du ressort, ni - pourquoi ne l’avouerions-nous pas ? - de la compétence du Parlement, agité par trop de passions, absorbé par trop de soucis ; et nous ne dirons pas qu’il ait de quoi mieux employer son temps ; toutefois, il a de quoi l’employer autrement. » (page 176)
Pour réaliser ce délicat travail, Charles Benoist avoue avoir d’abord pensé au Conseil d’État. Mais son choix s’orienterait bientôt vers la Commission extraparlementaire, instituée par Alexandre Millerand en novembre 1901, et qui se réunissait… au ministère du Commerce et de l’Industrie : tout un programme.
En lieu et place des parlementaires terriblement dépendant du suffrage universel, fief du Nombre selon Charles Benoist, celui-ci souhaite remettre la confection initiale du code du travail à des personnages bien plus susceptibles de ne pas céder à quelque vilaine passion tournée contre la propriété :
« La commission parlementaire offre, par sa composition, les garanties les plus sérieuses, puisqu’elle comprend, outre deux ou trois membres du Conseil
d’État, deux conseillers à la Cour de cassation, deux professeurs à la Faculté de droit de l’Université de Paris, le directeur du travail, celui de l’assurance et de la prévoyance sociales. » (page 178)
L’essentiel étant à peu près mis au point dès ce moment, Charles Benoist évoque la deuxième, puis la troisième étape :
« De cette commission extraparlementaire, le projet de code passerait ensuite à la commission du travail de la Chambre des députés ; et enfin les Chambres elles-mêmes seront appelées à le consacrer, puisqu’il n’y a point de loi sans elles, et qu’il n’y aurait point de Code du travail sans une loi qui autorise sa promulgation, ce code fût-il exclusivement formé, comme il le serait, de lois anciennes et déjà promulguées séparément. » (page 178)
Ici, un danger extrême se présente, en l’absence, bien sûr, d’un… parlementarisme dûment rationalisé :
« Le Parlement, incompétent pour préparer la codification réclamée, pourrait faire échouer l’œuvre s’il prétendait la suivre et la reprendre en tous ses détails, s’il en usait avec ce recueil de lois ainsi qu’il a coutume d’en user avec les lois nouvelles, à coups de propositions et de contre-propositions, s’il n’avait pas la sagesse de suspendre volontairement dans l’occurrence, en considération de l’objet à réaliser, son droit d’initiative, que personne ne conteste, mais que, pour le succès d’un tel effort, tout le monde désire ne pas lui voir exercer. » (page 178)
Évidemment, "tout le monde" du Code civil et de la propriété…
Par conséquent, poursuit Charles Benoist :
« Le rapporteur mettrait donc tout son exposé des motifs […] ; et il ne mettrait rien, aussi peu que possible, juste l’indispensable, le mot qui créerait la loi, dans le dispositif, qu’il ferait tenir en un seul article ; ceci par exemple (tiré de la formule usitée pour la ratification des conventions diplomatiques) : "Est adopté le projet de Code du travail dont le texte est ci-annexé", ou une formule équivalente. » (page 179)
Charles Benoist en convient aussitôt : tout ceci est parfaitement frauduleux. Mais c’est à quoi le suffrage universel condamne la belle et bonne bourgeoisie, en attendant des jours meilleurs :
« Constitutionnellement, parlementairement, il n’y a pas à se dissimuler que l’opération est délicate ; si l’on n’y mêle pas du tout le Parlement, il n’y a point de Code, et s’il s’en mêle trop, il n’y en a plus. C’est une mesure à garder, et c’est au Parlement lui-même à s’y renfermer. » (page 179)
En attendant que la Constitution de 1958 l’y renferme elle-même de toute la puissance du coup d’État concomitant.
6 réactions à cet article
Ajouter une réaction
Pour réagir, identifiez-vous avec votre login / mot de passe, en haut à droite de cette page
Si vous n'avez pas de login / mot de passe, vous devez vous inscrire ici.
FAIRE UN DON