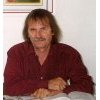Quand la finance internationale se soucie de l’économie interne des familles d’Afrique de l’Ouest
par Michel J. Cuny et Issa Diakaridia Koné

Au-delà des échanges commerciaux internes à l’Afrique de l’Ouest, le Rapport demandé en 2006 par l’USAID (charité états-unienne) à Carana-Corporation (spécialiste de la mobilisation de la pauvreté mondiale à travers le développement de la compétitivité), il existe un autre circuit dans lequel les Occidentaux aimeraient beaucoup pouvoir faire intervenir le système bancaire…
« Dans la majorité des cas, comme dans d’autres régions du monde, les migrants ouest-africains envoient des fonds à leurs proches. » (page 16)
Mais ils ne le feraient pas de la bonne façon…
« Très peu de ces migrants ont des comptes bancaires. » (page 16)
Les auteurs du Rapport ont donc mobilisé des agents sur place, de façon à pouvoir prendre une mesure aussi précise que possible de la dimension de ces échanges qui se font en espèces, c’est-à-dire à l’abri de tout contrôle et, en particulier, de celui des banques :
« Les entretiens avec près d’une cinquantaine de migrants au Ghana, au Mali, au Nigéria et au Sénégal l’ont montré dans l’ensemble : ils envoient tous de l’argent en proportion de leurs revenus. » (page 16)
C’est une première information… Allons plus loin…
« La majorité de ces migrants ont vécu en moyenne six ans dans le pays d’accueil, mais sont des individus relativement jeunes, âgés de vingt à quarante-cinq ans. Ils envoient de l’argent à leurs proches – principalement des parents et dans une moindre mesure des épouses. » (page 16)
Nous sommes déjà à l’intérieur des familles… et de la vie quotidienne de celles-ci… Veut-on quelques précisions sur les fréquences d’envoi ? En voici :
« Dans les quatre pays où les entretiens ont eu lieu, les migrants ont déclaré envoyer de l’argent chaque fois qu’ils en avaient les moyens, mais en général, ils remettent en moyenne trois fois par an. » (page 16)
Les enquêteurs sont même en mesure de nous fournir des chiffres assez précis :
« À deux exceptions près, où le montant envoyé était bien supérieur à 2 000 $ US, le montant moyen envoyé à chaque fois était de 157 $ US. Les migrants au Mali ont tendance à envoyer moins de 100 $. » (page 16)
Compte tenu du nombre de migrants, de la fréquence d’envoi, et des montants concernés, cela finit par représenter des sommes considérables à l’échelle de l’Afrique de l’Ouest… Autant d’argent et autant d’informations qui échappent aux banques… En effet :
« Les deux méthodes d’envoi les plus utilisées sont les amis qui voyagent ou les chauffeurs qui transportent des marchandises à travers différentes frontières ouest-africaines. Une troisième méthode utilisée était de remettre personnellement l’argent lors de la visite à la famille. » (page 16)
Carana Corporation n’aura pas lésiné sur les moyens pour en savoir plus…
« Ce projet comprenait une enquête nationale sur 500 migrants ouest-africains vivant au Ghana. » (page 18)
Voici une pluie d’informations… Elles nous donnent une idée de celles qui pourraient être collectées par les banques sitôt que la « bancarisation » des pauvres serait un fait accompli :
« Les expéditeurs migrants au Ghana envoient en moyenne environ 140 $ US à chaque fois à leurs proches dans d’autres pays d’Afrique de l’Ouest. Environ 58% envoient moins de 200 $ US et près de 10% envoient plus de 800 $ US. Ces migrants envoient de l’argent en moyenne trois fois par an. Cependant, vingt pour cent envoient de l’argent plus de cinq fois par an. Trente-cinq pour cent d’entre eux ont vécu au Ghana jusqu’à quatre ans, tandis que trente-sept pour cent ont vécu au Ghana de cinq à huit ans. » (pages 18-19)
À quand l’époque où les citoyens et citoyennes ordinaires pourront contrôler, de la même façon, les transferts familiaux d’argent et d’autres biens matériels au sein des grandes familles de la finance internationale ?
Ils entreraient alors dans des détails du genre de ceux que voici dans le cas de l’observation des « pauvres » :
« Comme dans d’autres pays, le principal bénéficiaire des envois de fonds est un parent immédiat. Plus important encore, quarante-deux pour cent des bénéficiaires sont la mère ou le père du migrant, et vingt-deux pour cent sont des frères et sœurs. » (page 19)
Or, dans le cas des 500 migrants ouest-africains au Ghana, répertoriés dans cette grande enquête, tout échappe aux diverses autorités tout autant qu’aux banques :
« La plupart des mécanismes utilisés pour envoyer de l’argent sont informels. Les résultats montrent que 65% des migrants envoient de l’argent par le biais d’un chauffeur ou prennent l’argent sur eux-mêmes. » (page 20)
Si maintenant nous quittons la sphère des seules manipulations d’argent, nous pouvons aller plus loin encore dans l’intimité des vies…
« En plus de rester en contact en visitant leurs compatriotes, les migrants contactent également régulièrement leurs familles par téléphone ou par courrier. En fait, quatre-vingt-six pour cent des migrants ouest-africains au Ghana utilisent le téléphone pour rester en contact avec leur famille, et quinze pour cent déclarent également envoyer des lettres. » (page 21)
Quelle peut être la fréquence de pareils contacts ?
« Vingt-deux pour cent appellent leurs proches au moins une fois par semaine et seulement un petit pour cent déclare appeler très peu. » (page 21)
Mais, nous apprenons surtout qu’il existe déjà des instruments technologiques qui sont dans la poche des « pauvres », et qui pourraient servir à espionner, de façon très discrète, ce système de transfert d’informations et d’argent qui s’est installé au cœur des familles :
« Une constatation très importante montre que soixante-deux pour cent des migrants ouest-africains au Ghana, expéditeurs et non-expéditeurs, ont un téléphone portable. » (page 21)
Comment les banques pourraient-elles obtenir d’être présentes, elles aussi… dans les téléphones portables et dans les produits technologiques qui s’y rattachent ?
Et à quel titre obtenir cette faveur ? Mieux : comment y venir en tant qu’invitées par les pauvres eux-mêmes ? C’est-à-dire : en tant qu’elles pourraient presque devenir des amies pour eux ?… Des amies qui, certes, auraient de grandes oreilles et des yeux bien ouverts, mais qui pourraient leur rendre quelques services pour pas cher ?…
NB. La suite immédiate est accessible ici :
https://remembermodibokeita.wordpress.com/2020/05/06/une-afrique-de-louest-que-son-passe-de-colonie-de-loccident-continue-a-diviser/
Ajouter une réaction
Pour réagir, identifiez-vous avec votre login / mot de passe, en haut à droite de cette page
Si vous n'avez pas de login / mot de passe, vous devez vous inscrire ici.
FAIRE UN DON