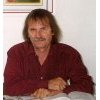Quand les communistes erraient loin de Jean Moulin
Alors que, dans le rapport sur le projet de Constitution présenté le 6 avril 1946, Pierre Cot avait affirmé que "l’Assemblée élue par le suffrage universel est évidemment la pièce maîtresse, la clef de voûte de tout le système", Charles de Gaulle rétorquait, dans le discours prononcé à Bayeux le 16 juin suivant, par un hymne à l’État, un État doté d’une "souveraineté réelle", et par une mise en question du suffrage universel à travers son instrument d’expression nécessaire - l’expression partisane :

« Bref, déclare De Gaulle, la rivalité des partis revêt chez nous un caractère fondamental, qui met toujours tout en question et sous lequel s’estompent trop souvent les intérêts supérieurs du pays. Il y a là un fait patent, qui tient au tempérament national, aux péripéties de l’Histoire et aux ébranlements du présent, mais dont il est indispensable à l’avenir du pays et de la démocratie que nos institutions tiennent compte et se gardent, afin de préserver le crédit des lois, la cohésion des gouvernements, l’efficience des administrations, le prestige et l’autorité de l’État. »
Assemblée issue du suffrage universel et État : nous retrouvons bien l’opposition entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif.
Dans la pratique, comme nous l’avons vu, bien que premier parti de France lors des élections du 21 octobre 1945 pour l’Assemblée nationale constituante (pouvoir législatif et pouvoir constituant provisoire), le parti communiste n’avait pu accéder qu’à des strapontins à l’intérieur du Gouvernement (pouvoir exécutif). Reprenons les propres termes de Charles de Gaulle, dont il faut redire qu’il n’était pas, lui‒même, un élu du suffrage universel. L’Assemblée nationale constituante ne l’avait choisi, pour la présidence du Gouvernement provisoire, qu’après que les socialistes ‒ qui détenaient la majorité avec les communistes ‒ eurent décidé de refuser l’investiture au communiste Maurice Thorez, puis au socialiste Félix Gouin, en totale opposition avec les indications fournies par le suffrage universel.
Dans ses Mémoires, De Gaulle écrit :
« Je notifiai à Thorez que ni les Affaires étrangères, ni la Guerre, ni l’Intérieur, ne seraient attribués à quelqu’un de son parti. À celui‒ci, j’offrais seulement des ministères "économiques". » (Mémoires de guerre, III, page 275)
Ensuite, De Gaulle se paie le luxe de jouer le pouvoir exécutif (désigné par l’Assemblée nationale constituante) contre cette Assemblée (expression directe du suffrage universel) elle‒même :
« Contraindre l’Assemblée nationale à me donner raison contre l’extrême‒gauche marxiste, c’est à quoi je voulais aboutir. Le 17 [novembre 1945], j’écrivis donc au président de la Constituante que, ne pouvant constituer un gouvernement d’unité, je remettais à la représentation nationale le mandat qu’elle m’avait confié. » (page 275)
Et le lendemain, à la radio, il développe la thématique des pouvoirs régaliens de l’État, c’est‒à‒dire de ce qui doit échapper à tout contrôle de la part de la population :
« J’annonçai que, pour de claires raisons nationales et internationales, je ne mettrais pas les communistes à même de dominer notre politique, en leur livrant "la diplomatie qui l’exprime, l’armée qui la soutient ou la police qui la couvre". » (page 275)
De fait, la victoire personnelle de Charles de Gaulle ne serait que momentanée : deux mois plus tard, il démissionnait lui‒même (20 janvier 1946). Mais, dans l’immédiat, les communistes ne disposaient encore que de strapontins dans un gouvernement tripartite pratiquement inchangé.
Ils ratifiaient ainsi le démenti infligé, par leurs "alliés" socialistes, à l’expression du suffrage universel, démontrant ainsi que, dès la création du Conseil de la Résistance, Jean Moulin avait pris sur eux une avance historique qu’ils ne devaient plus jamais combler…
C’est qu’en France la force de l’État, à nous en tenir aux trois domaines évoqués, à l’instant, par De Gaulle : armée, police, diplomatie, est un concentré de l’histoire politique de notre pays : monarchies, empires et républiques conservatrices.
Sur ce point, lisons Karl Marx :
« Le pouvoir centralisé de l’État, avec ses organes partout présents : armée permanente, police, bureaucratie, clergé, magistrature, organes façonnés selon un plan de division systématique et hiérarchique du travail, date de l’époque de la monarchie absolue où il servait à la société bourgeoise naissante d’arme puissante dans ses luttes contre le féodalisme. » (La guerre civile en France 1871, Éditions Sociales 1972, page 39)
Et encore :
« Ce pouvoir d’État est, en fait, la création de la bourgeoisie ; il fut l’instrument qui servit d’abord à briser le féodalisme, puis à écraser les aspirations des producteurs de la classe ouvrière vers leur émancipation. Toutes les réactions et toutes les révolutions n’avaient servi qu’à transférer ce pouvoir organisé ‒ cette force organisée pour maintenir en esclavage le travail ‒ d’une main à une autre, d’une fraction des classes dominantes à une autre. » (pages 211‒212)
Et c’est ici qu’il faut y insister : à l’encontre de tout État doté d’une "souveraineté réelle", dès le 27 mai 1943, date de sa première réunion sous la présidence de Jean Moulin, le Conseil de la Résistance était porteur de la souveraineté du peuple résistant de France, souveraineté à valoir jusqu’aux premières élections générales d’après la Libération. D’où la nécessité, pour De Gaulle et ses soutiens, de la faire disparaître aussitôt, en livrant Jean Moulin à Klaus Barbie vingt‒cinq jours plus tard (21 juin 1943).
(Cf. mon blog : http://souverainement.canalblog.com)
Mais pourquoi un tel silence du parti communiste d’aujourd’hui sur ce point ?
26 réactions à cet article
Ajouter une réaction
Pour réagir, identifiez-vous avec votre login / mot de passe, en haut à droite de cette page
Si vous n'avez pas de login / mot de passe, vous devez vous inscrire ici.
FAIRE UN DON