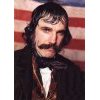Ramadan à Stamboul - nostalgies ottomanes ?

Sous les portraits souriants du photogénique Mustafa Demir, maire du district de Fatih (qui comprend le centre historique d’Istanbul), une véritable kermesse du Ramadan se tient sur l’antique Hippodrome depuis bientôt un mois. Deux rangées d’une centaine d’étals, logés dans des répliques en carton-pâte de mosquées façon Aladin de Disney, proposent repas d’Iftar, patisseries, glaces, sorbets à l’ancienne, thés, cafés turcs. Prix modérés pour les repas complets (chorba, ragoût, dessert, boisson), plus tapés pour le café qu’on prépare sur la braise. Au centre de la place, des dizaines de tables de camping en bois ainsi que les pelouses sont déjà prises d’assaut par les milliers de piqueniqueurs. Sur les estrades se produisent des musiciens soufis en fez et en veste noire, des récitateurs de Coran, des derviches tourneurs. Depuis quelques années, en effet, l’emblématique danseuse du ventre, reléguée aux boîtes de nuits louches d’Aksaray, a été détrônée par le derviche. Le derviche, lui, est partout, cafés, restaurants ; on en oublierait même que sa danse, le semah, étant une véritable cérémonie religieuse, c’est un peu comme si on appréciait une bonne messe en latin entre la poire et le fromage... En tout cas, les Turcs n’y voient aucun inconvénient, se pressant par milliers, joyeux, d’excellente humeur dans ce véritable mélange de bazar et de fête foraine. Une foule nombreuse et compacte, où l’on guetterait en vain la moindre bousculade, le moindre accrochage. Rien à voir avec nos Champs Elysées ou Champ de Mars, en proie aux déprédations alcoolisées dès que tombe la nuit. Une sono bien réglée, ni trop forte, ni trop faible, remplit d’une musique d’ambiance orientale les intervalles entre les concerts. Depuis l’hémicycle byzantin qui borne ce vaste terrain au nord, la fanfare des Janissaires, vêtus de leurs uniformes chamarrés et coiffés de leurs célèbres bonnets blancs, remplit la nuit de leurs percussions, cuivres, voix martiales, interprétant des marches militaires que la foule reprend en connaisseuse. Naguère il fallait se déplacer jusqu’au Musée de l’Armée et s’engouffrer dans un sombre amphithéâtre pour les écouter.
D’autres irruptions plus insolites et aléatoires surviennent comme si elles ne provenaient pas d’un programme de festivités établi à l’avance, mais, plutôt, comme si le tissu du temps, usé par endroits, laissait passer au travers de ses déchirures des scènes d’un passé trop récent encore pour sentir la reconstitution. On entend un roulement de tambours et voici tout un détachement de pompiers ottomans, en tunique blanche, coiffés du fez rouge, qui fend la foule en traînant sa pompe à eau. On croise de charmants couples, elle, en robe de couleur pastel à falbalas, lui, en complet veston noir, coiffé de ce fez, ou tarbouche, jadis proscrit par Atatürk et relégué aux accessoires de fakir, qui fait un come-back remarqué – y compris sur la tête d’un acrobate monté sur échasses qui parcourt la foule, tutoyant l’obélisque pharaonique témoin de tant de siècles meurtriers depuis que Constantin l’a arraché à sa terre natale pour le planter au centre de sa nouvelle capitale. Notons l’ironie qui veut que l’on arbore en signe d’une Turquie traditionnelle le couvre-chef que les modernisateurs du XIXe siècle avaient inventé pour remplacer le turban.
Et c’est là sans doute l’ambiguité de cette kermesse qui, exubérante à souhait, déborde largement les limites de l’At-Maidan (hippodrome) pour occuper en force les jardins fleuris qui s’étendent entre la Mosquée bleue et Aghia Sophia. La foule festive n’est animée d’aucune crispation rigoriste. Certains n’attendent pas l’heure fatidique pour rompre le jeûne – pour autant qu’ils l’aient jamais intégralement observé. Le puissant appel à la prière lancé du haut des minarets de la mosquée impériale (les muezzins d’une telle mosquée-cathédrale sont certainement triés sur le volet – celui de la prière du matin est un ténor dont la voix peut faire monter des larmes aux yeux, me rappelant le vers d’Iqbal, « l’appel du matin me remue au plus profond de mon être ») n’entraîne aucune ruée sur la salle de prières. Mais il est indéniable que pour l’essentiel la foule qui se presse là, souvent venue de loin en s’entassant dans les wagons du tramway ou en provoquant d’immenses embouteillages avec l’équivalent de nos « cathomobiles » n’est pas la même que celle qui fréquente les meyhane, ou bars à vin et restaurants chics d’Asmalimescit, de l’autre côté du Pont de Galata. Dans ce sens, remonter le « tünel » qui relie en cinq minutes la place de Karaköy et la grande rue de Péra c’est passer d’une Turquie à une autre. Partisans des partis laïques, buveurs de raki, contre forcenés de l’et mangal (l’emblématique barbecue familial de la Turquie populaire) votant AKP ? Dans la foule de l’hippodrome beaucoup de foulards (la mode cette année c’est le motif printanier et fleuri ; il y a deux ans le rouge écarlate et satiné prédominait), même une quantité non-négligeable de tcharchafs noirs à l’ancienne, l’équivalent turc du tchador iranien. Mais aussi beaucoup de femmes « en cheveux ». Une écrivaine peu suspecte de complaisance envers l’intégrisme, l’étonnante Elif Safak, nous explique que toutes ces tendances peuvent coexister harmonieusement dans la même famille. Quand il y a effectivement le choix. La vraie interrogation est peut-être ailleurs.
Dans cette joyeuse kermesse qui, faut-il le rappeler, est un phénomène récent, lancé délibérément par la municipalité AKP, le portrait d’Atatürk se fait rare. Il est vrai que l’inlassable référence au père fondateur de la Turquie moderne avec son cortège de défilés martiaux et la reproduction à l’infini de ce noble visage, tantôt sévère, tantôt bienveillant, a pu confiner la nation turque et la maintenir dans un culte de la personnalité stérile. La Turquie ne se limite pas à Atatürk, tout comme la France ne se limite pas à 1789. Or cette Turquie traditionnelle qui semble faire son retour n’est pas celle de Soliman et de Roxelane, à vrai dire assez lointaine pour ne jamais être passée de mode, mais celle de la Belle époque, avec robes à froufrous à peine complétées d’une voilette pour les Hanums de bonne société et tarbouche, chapelet, canne et costume noir de belle coupe pour les Beys-Effendis ; où l’on jeûne, certes, mais pour mieux apprécier les plaisirs de la table ensuite (il est à noter que si l’on veut bien se passer d’alcool, les restaurants où l’on est sûr de la qualité des produits sont tenus par des familles très pieuses – mention spéciale pour le foie d’agneau du Konak de Büyük Ada, digne d’une grande table parisienne) En somme, l’Empire ottoman des derniers sultans-califes, comme cet Abdul-Hamid II, déposé en 1908 par les « Jeunes Turcs ». Une époque et ses signes extérieurs que le kémalisme a balayés. Et ce Ramadan, à peu de choses près, rappelle celui décrit par Pierre Loti en 1910 dans Suprêmes visions d’Orient : "les cafés regorgeront de monde ; avec de bons rires et des appétits robustes, on se pressera autour des rôtisseurs en plein vent (...) il y aura partout des concerts (...) et au-dessus de cette explosion de joie naïve, très haut dans le beau ciel nocturne, il y aura la féérie des illuminations aériennes, les versets du Coran comme inscrits sur le vide en lettres lumineuses et toutes les bagues de feu encerclant les innombrables minarets qui ont l’air de pointer vers les étoiles".
Peut-on parler de folklore ? Pas seulement. Jetez un oeil sur les vitrines du quartier des libraires tout proche – un nombre croissant de traités de religion et de jurisprudence islamique voisine avec des biographies de ce ’dernier empereur’ qu’était Abdul-Hamid, ou des traités sur l’art de gouverner des Ottomans. Sur les barrières qui protègent le chantier de restauration du Palais de Justice on a placardé une explosition consacrée au "Ramadan à l’époque ottomane". Et les ouvrages de l’énigmatique Fethullah Gülen ont même droit à une grande tente sur l’Hippodrome.
Tout cela ne témoigne pas d’une évolution à l’iranienne. Au « gouvernement du docte » (velayat-e-faqih) on préfère largement le sultan-calife ou son équivalent moderne, le très érudit et onctueux Abdullah Gül flanqué d’un premier ministre (j’allais dire vizir) plus rude, plus « seldjoukide, » en la personne de Recep Tayip Erdogan. On dit qu’Abdul-Hamid admirait les Etats-Unis – son organisation fédérale l’intéressait, tout comme son réseau d’universités, et le rôle qu’y jouait la religion (à la fin du XIXe siècle) lui semblait compatible avec son idée du califat. Il est intéressant de noter que certains leaders de l’AKP, malgré toute l’antipathie que leur inspirait Bush, se reconnaissent plutôt chez les Républicains américains que chez les chrétiens-démocrates européens. Un aveu de taille.
Alors cette grande kermesse du Ramadan est certes une manière de rendre la religion festive (c’est d’ailleurs ce caractère festif, « unitaire, fraternel et amical » qui est mis en évidence sur les bannières). Mais elle traduit aussi la volonté de replacer la religion au centre de la vie quotidienne. Pour le meilleur (pour le moment, c’est ce qui en ressort) et pour le pire. Mais le pire (comme on dit) n’est jamais certain.
56 réactions à cet article
Ajouter une réaction
Pour réagir, identifiez-vous avec votre login / mot de passe, en haut à droite de cette page
Si vous n'avez pas de login / mot de passe, vous devez vous inscrire ici.
FAIRE UN DON